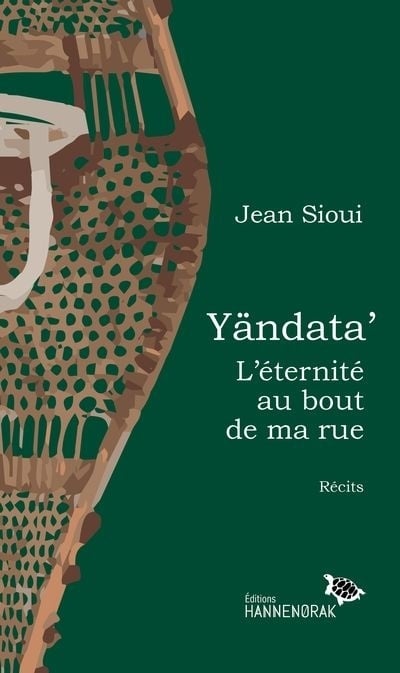J’arrive en avance, évidemment, par peur d’arriver en retard. Les rues de Wendake, dès qu’on s’éloigne un peu du boulevard Bastien, sont encore plus étroites que les sens uniques du Vieux-Québec. Je dois me tasser dans une entrée de garage pour laisser passer un camion, puis un autre. Je me disais que si j’étais un peu en avance, je roulerais dans le quartier historique, en attendant de revenir à l’heure prévue, que j’irais faire un tour à la Librairie Hannenorak, tiens pourquoi pas, le dernier roman de David Clerson me fait de l’œil sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. J’ai du temps devant moi, n’est-ce pas? C’est l’histoire de ma vie, ça, non? Avoir le temps devant moi. Arriver en avance de peur d’arriver en retard.
Mais en passant devant la grande maison de Jean Sioui, je l’aperçois en train de pelleter. Je le vois qui lève la tête et qui me spotte au volant de la voiture. J’ouvre la fenêtre et lance, d’un ton jovial : « J’suis zélé. Veux-tu que je revienne plus tard? » Il me répond par une boutade, tout en posant sa pelle : « Prends pas de risque, tu pourrais tomber sur des imprévus: la réserve, les barricades, tsé… » Il me fait signe de m’en venir, me fait signe de me stationner, juste là. Puis il me guide vers l’entrée du sous-sol en précisant que la maison est un vrai chantier et qu’il veut m’éviter ça.
Alors on rentre par en bas.
Je m’installe sur sa chaise de bureau, les pantoufles en phentex me gardent les pieds bien au chaud. Jean, lui, s’est assis sur le canapé de cuir. C’est comme si j’avais eu le réflexe de m’asseoir « à sa place », pour me placer tout de suite « dans ses pas », pour voir à sa hauteur. On se met aussitôt à ressasser quelques souvenirs communs. Ça fait presque une décennie qu’on se connaît. On s’est rencontrés lui et moi dans les Maritimes, on a fraternisé le temps d’un long voyage en train. C’est une longue histoire. Quelqu’un avait organisé ça, un projet de fou : écrire un roman collectif, en vingt-quatre chapitres, en vingt-quatre heures, d’Halifax jusqu’à Toronto, pour commémorer les 400 ans de l’arrivée de Samuel de Champlain en Ontario. Il y avait des écrivain.es français.es, acadien.nes, franco-ontarien.nes. Il y avait aussi Jean Sioui, poète wendat, et Virginia Pésémapéo Bordeleau, artiste crie.
— Ah, notre cher Champlain, me dit-il, avec la même ironie douce-amère qui se retrouve dans chacune des phrases du texte qu’il avait écrit à l’occasion, soit le chapitre 21 du roman, qu’il avait intitulé « Dernier voyage en Ontario ».
C’est vrai qu’on ne l’avait pas ménagé, notre « cher Champlain », dans ce collectif ayant d’abord été conçu comme un hommage et qui avait un peu viré au déboulonnement métaphorique de la statue de l’explorateur. De mon côté, je venais de lire la thèse de doctorat de Mathieu d’Avignon, Champlain et les fondateurs oubliés, qui n’est pas tendre avec le monsieur, et j’avais écrit un texte où cet homme plus grand que nature s’avérait en réalité un petit être médiocre qui puait de la bouche et où le sieur Dupont-Gravé était le véritable meneur.
Dans son chapitre, Sioui évoquait le génocide autochtone, la dépossession de la Huronie, l’instauration des pensionnats, avec cet humour moqueur qu’on retrouve souvent chez les poètes et les romanciers et romancières des Premières Nations. « Champlain, qui pourtant a eu la chance de visiter de part en part le pays wendat, ne relève que la nation des Attignawantans, la plus nombreuse et l’une des plus anciennes nations à avoir occupé le Wendake, l’autre étant les Attignéénongnahacs. Il y avait aussi les Arendahronons et encore les Tahontaenrats. Et même les Ataronchronons. Une chance que Champlain n’ait pas connu toutes ces nations, car on peut facilement imaginer tous les noms desquels il les aurait baptisées, quand on sait qu’il ne savait même pas prononcer le mot wendat1. »
Jean Sioui, c’est le sourire en coin qu’il a toujours déboulonné les statues érigées autour de lui et de sa communauté. Contrairement à moi qui m’amusais à faire de Champlain quelqu’un de tout petit, malgré les tentatives répétées pour le dépeindre en héros fondateur, Jean a passé sa vie à devenir quelqu’un de très grand, malgré les tentatives répétées de les écraser, lui et sa nation. Bien calé dans son canapé de cuir, il me raconte certains épisodes clés de la communauté wendat, dont certains me reviennent en tête parce qu’il en parle dans son dernier livre, un recueil de souvenirs intitulé Yändata’/L’éternité au bout de ma rue, que les Éditions Hannenorak, fondées il y a plus d’une décennie avec son fils Daniel, viennent de publier. Il me raconte les Quarante Arpents, les revendications territoriales, les clans alliés qui finissent par s’haïr, l’époque de Max Gros-Louis et du renouveau de l’artisanat et de la vente de bébelles aux touristes français, l’étroitesse de cet univers, de ces rues où, contrairement à aujourd’hui, « il n’y avait rien ». Quand il était jeune, la ville de Québec n’avait pas encore grugé le territoire jusqu’à enclaver Wendake entre deux ou trois banlieues, ce n’était que des champs, des forêts, des dompes, partout aux alentours.
Ici, sur la rue Chef Aimé-Romain, on se trouve au cœur de ce petit espace alloué en 1697 aux quelques centaines de Wendat rescapés des guerres et des épidémies qui avaient décimé leur territoire ancestral dans la région des Grands Lacs. Les familles Sioui, Picard, Gros-Louis, Bastien ont au fil des ans perdu des terres, en ont racheté au gouvernement, ont mis sur pied des institutions, ont bourlingué, ont fait des enfants. À l’époque où Jean Sioui est né, déjà plus personne ne parlait wendat dans la communauté. Et aujourd’hui, c’est à partir des Relations des Jésuites qu’on tente de faire renaître la langue des ancêtres. Ça fait partie des nombreux programmes de revitalisation de la culture et des traditions que bien des Premières Nations ont créés afin de contrer les effets néfastes de la colonisation et de l’assimilation forcée. À l’époque où Jean Sioui grandissait, dans la « réserve », on allait à l’école chez les frères catholiques, on s’habillait propre, on priait en latin. Et on ne parlait que français.
— Mais, écrivais-tu déjà, dans ce temps-là? Étais-tu un grand lecteur?
— Pantoute, l’écriture est arrivée bien plus tard. La lecture aussi.
Oui, bien plus tard, parce que Jean Sioui, avant d’être le poète célébré qu’on connaît maintenant, qui a publié presque une dizaine de recueils, qui a voyagé un peu partout dans le monde pour présenter ses œuvres et partager ses mots, avant de se faire poète, Jean Sioui a habité sur une fermette pendant une quinzaine d’années, achetée sur un coup de tête. Le grand terrain est devenu une maison, un milieu de vie, il y a vécu sa passion pour les chevaux. Je lui demande s’il gagnait son pain avec les produits de la ferme. Il me répond, encore une fois : « Pantoute, j’ai été informaticien pour la Communauté urbaine de Québec jusqu’à ma retraite. » Alors, il a commencé à écrire quand, et où? Et comment?
— Soyons clairs : j’ai toujours aimé écrire. Dans le sens que, quand on avait une carte de fête à composer, c’est moi qui faisais ça, mettons. Mais jamais je n’aurais imaginé faire ça, publier, tout ça. J’ai publié un peu par hasard. À la crémerie qu’on avait achetée ici à Wendake, ma femme et moi, je me suis mis à vendre des rondelles de tronc d’arbre pyrogravées avec des pensées, des poèmes, des petites choses. Et un jour, un ami m’a dit : « Pourquoi tu ferais pas un livre avec ça? » Alors j’ai rassemblé mes affaires dans une boîte et, sur l’heure du lunch, au bureau dans le Vieux-Québec, je suis allé cogner chez Le Loup de Gouttière avec ma boîte de feuilles volantes. J’avais trouvé l’adresse dans le bottin, dans la section « Maison d’édition ».
Depuis ce jour-là, où l’éditrice lui a expliqué que ce n’était pas comme ça que ça marchait, qu’il y avait un processus à respecter pour soumettre un manuscrit, il en a vu d’autres, Jean Sioui, le monde de la littérature lui réservait bien des surprises. Des bonnes et des moins bonnes. Ce jour-là, elle a soupiré, comme pleine de compassion, et a ajouté : « Bon, vous savez quoi? J’ai le goût de lire quelque chose de différent en fin de semaine. Laissez-moi ça là, je vous rappelle. » Et le reste appartient à l’histoire, comme on dit.
Il en a vu d’autres, Jean Sioui, depuis cette rencontre à la fois fortuite et comme prédestinée avec une éditrice bienveillante et passionnée, et bien de l’eau a coulé sous les ponts : Le Loup de Gouttière a fermé, avant d’être racheté par Michel Brûlé, qui a créé Cornac avec le catalogue de la maison; Cornac a fermé; les Écrits des Forges se sont intéressés à ses poèmes, puis Mémoire d’encrier; il a fondé la maison d’édition Hannenorak, du nom d’un personnage important de l’histoire wendat. Il est retourné à l’école, il a vu du pays et il est devenu, aux yeux de tous et toutes, un poète et un aîné.
La maison centenaire où est né le père de Jean Sioui se voit de son bureau. Son dernier livre parle de ça, en quelque sorte, de cette vue qu’on a par la fenêtre. L’éternité au bout de ma rue, c’est l’histoire de son enfance, d’une enfance autochtone, mais c’est aussi l’histoire d’un retour dans l’écriture : naître à Wendake, quitter (s’enfuir de) Wendake, revenir à Wendake et écrire sur Wendake, sur les rues étroites et l’incommensurable territoire ancestral, là-bas et ici dans la tête et dans le cœur.
Mais on n’écrit pas qu’avec le cœur, dit-il. Alors après avoir sorti un premier livre, il s’est inscrit à un baccalauréat multidisciplinaire, à l’Université Laval. Y a-t-il eu des événements, à cette époque, qui ont été des déclencheurs de son identité d’écrivain? Oui. Par exemple, quand un vieux prof, du haut de sa bonne vieille logique coloniale et paternaliste, lui a dit : « Jean, t’as du talent, mais arrête d’écrire tes affaires d’Indien, tu vas te confiner là-dedans. » À partir de là, c’est devenu une évidence. L’important, c’était de faire avancer la cause de la littérature des Premières Nations : l’avenir est à venir et il faudra l’inventer à mesure. « J’étais à ma retraite, j’avais rien à prouver à personne. C’est pour ça que ça m’a pas fait un pli quand il m’a dit ça. Mais j’avais maintenant une mission. »
Jean évoque souvent cette notion de « mission » pour parler de son rôle, de sa place, du mandat qu’il s’est donné à lui-même. Après l’université, il a été approché par les instances subventionnaires fédérale et provinciale pour organiser des résidences d’écriture pour les Premières Nations, à Banff et ailleurs. Sa (deuxième, troisième?) carrière s’amorçait sur les chapeaux de roues. Il avait un but : faire en sorte que plus personne, jamais, ne puisse dire à un écrivain autochtone en devenir ce que ce prof lui avait dit, à lui.
Il a eu plusieurs vies, ce Wendat, et il n’en regrette aucune. Ni les changements survenus lors des soirées de poésie, où selon lui une certaine performance tape-à-l’œil a pris le dessus sur le simple amour des mots; ni les choix qu’il a faits ou pas, les sentiers de traverse qui l’ont mené là où il est aujourd’hui. Ces jours-ci, il travaille sur un recueil de textes en prose, évoquant les souvenirs du Nionwentsïo, le territoire ancestral de la nation wendat, sorte de pendant forestier à son Yändata’, qui signifie « village ». Quelle forme ça prendra exactement? Il ne le sait pas trop encore, il se laisse porter par l’écriture et la mémoire.
Il ne regrette rien? Ce n’est pas tout à fait vrai. Parfois, Jean Sioui regrette d’avoir répondu quelque chose qui ne lui ressemblait pas. Il me le démontre ce soir-là en m’écrivant, plusieurs heures après mon départ de Wendake. Je reçois son courriel alors que je suis assis sur mon fauteuil, un café sur la table, un livre à la main. Les enfants jouent autour de moi, Manu dessine, Viviane ravaude. Jean m’envoie ces quelques lignes : « Kwe Daniel, ce PM tu m’as demandé si j’avais des projets d’avenir et je t’ai répondu qu’à l’aube de mes 75 ans ce n’est peut-être plus possible. Cette réponse ne me ressemble pas et me désole. J’ai cette ambition qui peut paraître irréaliste mais qui m’anime depuis quelques années. Je rêve de la création d’une faculté universitaire à Wendake avec des programmes d’histoire des Premières Nations, de langues, de culture, d’art, de littérature, etc. Ces facultés existent dans l’Ouest, en Ontario et peut-être aussi dans d’autres provinces. C’était déjà mon projet quand j’étais chef responsable de la culture au conseil de bande de la nation. Bonne soirée! »
J’ai souri en lisant ça.
Oui, ce n’est pas tout à fait vrai qu’il ne regrette rien, Jean Sioui. Il regrette de m’avoir laissé croire, l’espace d’une seconde, qu’il ne lui restait pas encore mille vies à vivre.

Depuis qu’il a fait son entrée sur la scène littéraire en 2012 avec Malgré tout on rit à Saint-Henri, un recueil de nouvelles qui fait montre d’une grande humanité, Daniel Grenier — qui est également traducteur — n’a cessé de faire de chaque ouvrage publié un nouvel opus d’importance dans les lettres québécoises. Le roman L’année la plus longue et l’essai La solitude de l’écrivain de fond ont tous deux été finalistes aux Prix du Gouverneur général. C’est aussi lui qui, une année durant, n’a lu que des livres écrits par des femmes et en a colligé ses réflexions dans le magnifique Les constellées. En 2018, il publiait Françoise en dernier, l’histoire d’une journaliste allant à la rencontre d’une femme qui, il y a trois décennies, avait survécu dans la forêt au Yukon après un écrasement d’avion. Pour son plus récent roman, Héroïnes et tombeaux (Héliotrope), il met en scène la même journaliste, cette fois au brésil. On plonge alors dans un roman d’aventures qui explore les dessous de l’Amérique, traite du mouvement anthropophage et aborde le pouvoir des fabulations et la force des sectes. [JAP]
Photo de Jean Sioui : © Jean-Louis Régis
Toutes les autres photos : © Daniel Grenier
Photo de Daniel Grenier : © Julia Marois
—————–
1. Sioui, Jean, « Dernier voyage en Ontario », dans coll., Sur les traces de Champlain, Sudbury, Éditions Prise de parole, 2015, p. 231.