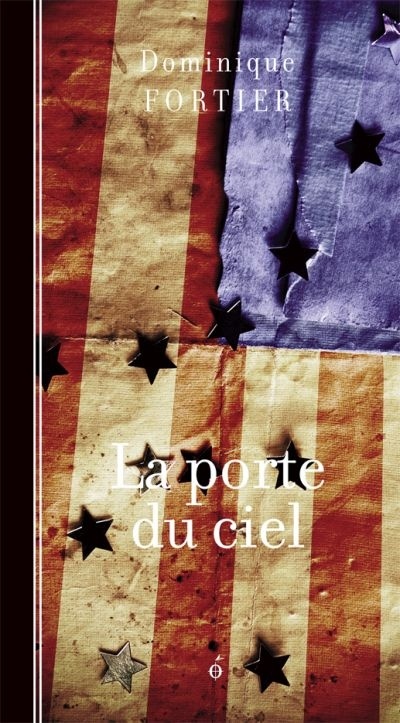Ceux de Dominique Fortier auront semé des pistes — autant de formes brillantes et mobiles, comme si j’avais regardé dans le kaléidoscope d’Emily Dickinson, dans Les villes de papier. Dans quelle maison, imaginaire ou réelle, se trouve ce lourd grillon de métal, devant quelle demeure existent cette mère et sa fille, bébé, dans une poussette? À qui appartiennent vraiment les gestes que Lavinia enchaîne, sans hésiter, dans sa cuisine? Y a-t-il ici des bateaux pris dans les glaces, des ouvrages jetés du haut d’une falaise? Et la mer, est-elle aussi dans Outremont?
Quand un chien m’accueille en jappant, ses yeux doux dans un carreau à la hauteur de mon visage, je sais que j’ai sonné au bon endroit. Je n’aurais pas imaginé le fidèle compagnon de Dominique autrement.
Au crépuscule
Je ne voulais pas me replonger dans une lecture scolaire de ses œuvres avant d’aller à sa rencontre. J’ai fait remonter les images laissées par ses romans. De la même manière, je cherche comment écrire ce texte. Le tourbillon des fêtes est passé — ma maison tranquille retourne à ses espaces dégagés.
La veille de ma visite, à quelques jours de Noël, j’ai lu Quand viendra l’aube. L’écrivaine a rédigé son essai avant le lever du soleil; moi je l’ai traversé alors que la noirceur s’installait. Hors du quotidien, les mots existent d’eux-mêmes.
La semaine précédente, à la librairie, ma fille de 3 ans et moi étions accroupies entre le E et le G. M’interrompant dans l’alphabet, elle m’a demandé : « Quand on meurt, maman, est-ce qu’on amène toutes nos choses avec nous? »
Ce soir-là, j’ai refermé le livre de Dominique comme on respecte le silence accompagnant une confidence.
De la texture sous les doigts
Elle nous mène à la cuisine, me fait sentir un thé qu’elle nous prépare ensuite. J’essaie de tout capter.
Sirius s’appuie contre ma cuisse, réclame des caresses. Je me tiens sur mes deux pieds pour ne pas perdre l’équilibre. Son poil est comme du velours, quand il vient d’être toiletté, me dit Dominique. Oui.
Du velours sous les doigts, l’arôme du thé un peu sucré qui flotte, une conversation qui pourrait avoir emprunté son rythme à des mésanges. Beaucoup de lumière, celle des après-midi d’hiver. Le carrelage, puis des marches qui mènent à la salle à manger et sa table qu’on dirait faite de bois flotté, où nous nous installons.
Je n’ai presque rien préparé. En traversant le pont Jacques-Cartier, j’ai souhaité me délester de la fatigue de mon livre enfin envoyé à l’impression, de la correction des dissertations de mes élèves. Assise à cette table, j’aimerais simplement déployer ce qui existait dans ma tête quand j’ai lu Du bon usage des étoiles, puis Au péril de la mer. Reconstruire l’émerveillement que j’ai ressenti au contact de ces univers. Comment dire tout ça à une personne qu’on ne connaît que sur papier? Dès les premières minutes?
Maladroitement, peut-être, je parle de regard, de posture et de rapport aux sensations dans l’écriture. Je cherche les mots en les disant. Dominique, les yeux ancrés dans les miens, n’a pas l’air de se demander quelle sorte de fille perdue elle a laissé entrer chez elle.
Faire confiance à sa boussole
Dominique Fortier s’est entourée de livres, avant d’en écrire elle-même. Elle a travaillé en bibliothèque, en librairie, dans le milieu de l’édition comme correctrice, est traductrice depuis longtemps… Mais nous parlerons très peu de ce pan de sa vie: c’est moi qui ne l’y guide pas, par choix d’abord inconscient. Je veux entendre l’écrivaine. Celle qui expérimente le monde de cette manière si sensible.
L’écriture la terrifiait, mais l’appelait à la fois. Dominique s’y est risquée à la mi-trentaine, dix ans après s’être inscrite au cours de création littéraire d’Yvon Rivard, à l’université McGill. Une autre rencontre déterminante est celle de François Ricard, à qui seront confiées plus tard les premières versions de ses livres. Jusqu’à son décès, il aura toujours accompagné son travail. François Ricard pointait l’endroit exact où le lecteur décolle du récit, ces passages qu’intuitivement on reconnaît quand on se relit, mais dans lesquels on ne sait pas trop par quelle porte retourner.
Et maintenant? Antoine Tanguay, chez Alto, a aussi ce regard limpide.
S’accrocher au réel — suivre le soleil
Le bureau aménagé au deuxième ne lui sert plus tellement. Pareille à un tournesol, Dominique suit le soleil, d’une fenêtre à l’autre. Avec son cahier et son stylo, jouant à ne rien faire d’important ou de décisif. Elle glane des phrases comme elle ramasse les coquillages au bord de la mer.
Quelques pages sont déjà écrites, pour un livre à venir, peut-être, me glisse-t-elle. Des scènes récoltées au retour des marches sur le mont Royal avec Sirius. C’est en descendant qu’elles se précisent, deviennent des lieux habitables.
Un peu de la même manière, parfois les rêves laissent des images sur l’oreiller.
Jamais ne me viendrait l’idée de demander ce que ces pages racontent ni où elles se passent. Il y a des univers encore si fragiles que le moindre souffle pourrait tout défaire. Du moins, nous en avons l’impression.
Percées
Quand j’ai lu Les ombres blanches, ces passages où les poèmes d’Emily recouvrent les tables dans l’attente d’être rassemblés, j’ai été certaine que Dominique travaillait ainsi.
J’ai vu des tables, des planchers couverts de feuilles, pour que l’écriture devienne tangible. Une femme au milieu, la main tendue, qui cherche à remonter le courant.
Impossible de trouver des mots plus justes que les siens, dans Quand viendra l’aube : « Ensuite, j’imagine, c’est comme pour composer un bouquet de fleurs ».
— Est-ce que c’est de la confiance, de l’insouciance, de l’abandon?
— C’est un travail de poète, me répond Dominique. Il faut trouver le chemin d’un texte à l’autre pour faire un recueil. Comme un voyage?
L’après-midi s’étire, je bois une gorgée de thé. Sirius se fait gratter derrière les oreilles.
Nous avons un pied sur le sentier ou la plage, l’autre dans le territoire de l’écriture.
Du chemin parcouru
— Chaque livre a son temps, contient un « toi » différent.
Une sorte de vertige me gagne. J’entrevois la tâche accomplie. La présence, la patience, mais l’audace aussi. Comme celle d’envoyer un manuscrit outremer sous un pseudonyme fleuri, juste pour voir ce que le livre peut faire comme chemin, de lui-même.
Le processus éditorial des Villes de papier s’est donc fait en parallèle, en France et au Québec. Emily Dickinson, réinventée par Dominique, aura eu plus d’une vie. Sans compter les traductions en anglais, en mandarin, en allemand… Au-delà des cultures et des époques, ces œuvres permettent à leurs lecteurs d’y rêver, de s’y poser. Elles existent maintenant comme en dehors de leur créatrice, continuent de s’ouvrir à des inconnus, qui, un jour, envoient une lettre à l’éditeur parisien ou viennent en glisser quelques mots à Dominique, dans les événements littéraires.
Il y a parfois beaucoup de monde dans la maison.
L’autre moitié d’un livre
Dominique m’assure que notre guide intérieur se précise, s’affine avec les années. Seul le sentiment d’urgence d’écrire s’est posé. Le désir de se surprendre soi-même perdure.
Les recherches, exhaustives au temps du Bon usage des étoiles, ne concernent maintenant que ce qui est essentiel pour permettre à l’écriture d’avancer. Le travail se fait encore d’instinct, sans plan. Jusqu’à la toute fin du processus, des morceaux de textes bougent; ce qui n’est pas absolument nécessaire est retranché.
Nous parlons longtemps de ces blancs laissés dans le texte, qui permettent au lecteur, on l’espère, d’entrer dans le récit, de s’y inscrire.
J’y repense pendant que ma fille, assise à mes côtés, couvre chaque millimètre d’une carte postale de couleurs, en appuyant fort sur ses crayons de bois.
La page n’est plus lisse, mais pleine d’aspérités, comme ces objets qui tiennent dans la main, auxquels on ne fait pas toujours raconter une histoire — mais qu’on laisse être.
Maille par maille
Faut-il s’étonner que Dominique noue de la laine, cachemire ou mohair, patiemment, avec ses aiguilles à tricoter, et que naisse un châle, puis deux?
Je connais la régularité des gestes, qui est aussi, un peu, celle du corps en marche. L’attention portée sur les mains qui travaillent et en même temps la tête qui erre… le temps qui s’arrête, dorénavant rythmé par ce vêtement qu’on tire de l’informe, une maille à la fois.
Écrit-on autrement? Ramenée à ce qui tombe des aiguilles, par cette sorte de magie?
Faut-il s’étonner que le texte soit mobile? Que les mots soient comme des mailles — c’est de les mettre ensemble qui fait apparaître le motif.
Yvon Rivard disait à Dominique : « Le plus petit contient le plus grand. »
Du lieu où écrire — bruit blanc
Dans le bureau, la bibliothèque couvre deux pans de murs, mais ces cahiers serrent l’épine sur une tablette. Dominique en tire quelques-uns, les feuillette — ses mains papillonnent, les ouvrent et les referment aussitôt. Ils contiennent ces phrases plus tard retranscrites à l’ordinateur. Avant cette étape, déjà une réécriture, les idées sont des choses volatiles, qu’il ne faut pas trop laisser exposées à l’air libre.
Je resterais dans cet espace foisonnant des heures que je n’arriverais pas à en faire le tour. Il y a des broderies d’Eliane Ste-Marie, dont on retrouve les créations sur Pour mémoire : Petits miracles et cailloux blancs, coécrit avec Rafaële Germain. Au mur, deux œuvres en papier découpé de Charles-Étienne Brochu, et, empilés sur le sol, des romans de Dominique en traduction, arrivés du bout du monde, par-dessus une pile de feuillets imprimés. Je m’extasie devant la couverture cousue de la traduction tchèque. Les yeux de Dominique brillent. C’est comme si une partie de l’histoire nous était racontée, avant même d’ouvrir le livre.
Ils sont sur le point de déménager, m’explique-t-elle. C’est pourquoi le grand tableau Aube, de Stéphanie Robert, l’illustration en couverture de son essai, est posé contre le mur dans son emballage de carton.
Je ne suis pas de ces auteurs qui peuvent écrire partout, au café du coin au milieu de la vie qui bourdonne. Dominique non plus. Elle ne sait pas si la nouvelle demeure conviendra. Elle peut créer dans cette maison, où elle habite depuis vingt ans, et au bord de la mer, l’été. Dans les arrivées et les départs des visiteurs, Dominique ferme la porte de sa chambre et s’oublie dans le bercement des vagues.
Là aussi, il y a une fenêtre. Les mots viennent par bourrées fébriles.
Un arbre, un oiseau
Dominique a tout fait pour le garder, mais l’arbre devant la fenêtre a fini par tomber sur la maison. Il a fallu le couper. C’était un érable.
Je capture une dernière collection, un monticule de cailloux à rayures. Grosseur de galets, qu’on peut tenir dans la main, mais aux formes plus libres. Des pierres à vœux.
Je ris en soulignant que je suis certaine que les trésors ne sont rassemblés que selon les lieux de leur cueillette, pas autrement. « Évidemment! Le verre poli du Mexique n’a rien à voir avec celui du Maine! », s’exclame Dominique, avant que je remette mes bottes, mon manteau, pour regagner le Centre-du-Québec.
Au-dessus de la porte, un petit oiseau rouge s’accroche, tête à l’envers, et me souhaite bonne route.
La récolte
C’est une maison pleine de vie, comme je les aime. Je comprends qu’on puisse y créer. Toutes les traverses de fenêtre sont habitées. Des plantes, des livres empilés. Des morceaux de verres polis par la mer au creux d’un terrarium, du sable dans une bouteille, et ces coquilles, peintes par Dominique et sa fille, cerclées d’or.
Un bord de plage miraculeux.
Virginie Blanchette-Doucet
Virginie Blanchette-Doucet a fait paraître 117 Nord (2016), un premier roman campé dans son Abitibi natale qui a reçu un bon accueil auprès du public et s’est hissé au rang de finaliste aux Prix littéraires du Gouverneur général et dans la première sélection du prix France-Québec. On a ensuite pu lire des textes de l’autrice dans les collectifs Stalkeuses (2019, Québec Amérique) et Prendre pays (2021, Du Quartz). En février 2023, elle publie le très beau roman Les champs penchés (Boréal), nous entraînant cette fois-ci au cœur de la Nouvelle-Zélande où les liens filiaux, enchevêtrés par les fantômes du passé qui ont laissé de profonds stigmates, sont rudement mis à l’épreuve. [IB]
Photo de Dominique Fortier : © Carl Lessard
Toutes les autres photos : © Virginie Blanchette-Doucet
Photo de Virginie Blanchette-Doucet : © François Couture