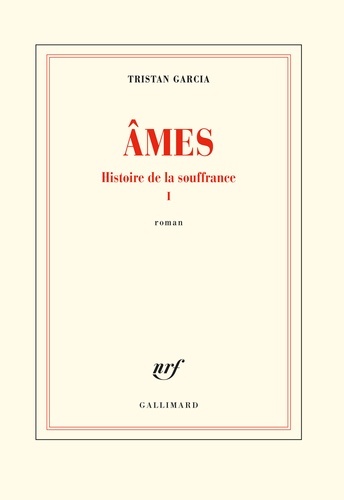Sans pouvoir choisir entre la fiction et la philosophie, le Français Garcia mène de front deux œuvres prolifiques, protéiformes et exigeantes. Il y a toujours dans ses essais beaucoup d’histoires et dans ses romans beaucoup d’idées. En 2019, il a inauguré un cycle romanesque d’une ambition folle intitulé Histoire de la souffrance. Quatre âmes y transhument à travers les lieux et les époques depuis les premiers balbutiements de « la vie, simple fracas régional dans le chaos général » jusqu’à des formes plus élaborées d’existence (et donc de souffrance). Du bal inaugural des protozoaires à la funeste rencontre de Néandertal et d’Homo sapiens, en passant par l’Inde légendaire du Mahabharata et les méditations d’un stoïcien précédant de peu le Christ dans la mort, vous devinez que le voyage ne sera pas de tout repos. Dans Âmes, ce premier tome s’échelonnant jusqu’au IXe siècle, les âmes qui nous occupent ne font sensiblement que subir la douleur inhérente à la vie (humaine mais pas que, puisqu’il arrive que le romancier nous pousse à nous intéresser à la vie intérieure des arbres ou à celle de quelque plumitif observant le monde depuis les hauteurs du ciel). Dans Vie contre vie, le deuxième tome, après des millénaires de torture toujours plus raffinée, le vivant amorce la riposte en élevant d’abord faiblement le bouclier du savoir, puis en brandissant l’épée nouvellement forgée du progrès (du temps où elle pouvait encore prétendre à la semblance du tranchant).
Jeune prodige des lettres, Garcia poursuit son entreprise de pillage vertueux des grands récits du patrimoine mondial. Bardé de documentation comme un thésard, loin de thésauriser comme la pie voleuse, il thaumaturgise ce qu’il a emprunté pour le restituer en quelque chose d’encore plus vivant, d’encore plus significatif. Chaque chapitre de ce tome adopte son propre langage, sa forme choisie avec soin et pourtant, l’ensemble est à des lieues d’un recueil de nouvelles disparates, tissant une cohérence qui force l’admiration. Les héros et héroïnes de Garcia sont discrets et rendent service à l’humanité présente et future sans que les livres d’histoire retiennent leur nom. Le premier héros oublié est un chirurgien arabe de Cordoue, disciple d’Abu Al-Qasim. Pour soulager la douleur de l’enfantement, il va de soi qu’il doit d’abord la comprendre. Sans solution alternative moins moralement répréhensible, il en est réduit à fouiller les monceaux de cadavres de condamnées à mort afin d’ausculter dans le secret de son cabinet les matrices encore chaudes. La suivante est aux yeux des uns une sorcière sanguinaire et lubrique, à ceux des autres, la seule aide que peuvent espérer trouver les femmes violées ou celles qui ne pourront tout simplement pas nourrir une bouche supplémentaire, n’en déplaise aux ardeurs du mari. Le dernier est un savant du XVIIIe siècle qui a compris la nature électrique du réseau nerveux.
Tous connaîtront une fin peu enviable, et pourtant, plusieurs miracles technologiques de la modernité n’auraient jamais été possibles sans eux. Le progrès se juche-t-il bien sur les épaules des géants ou bien serait-il plus juste de dire qu’il se fait la courte échelle à même la clavicule blanchie des damnés de la terre? Le troisième et dernier tome de cet incroyable cycle (au titre et à la date de parution encore inconnus) devrait nous donner une idée de l’avis de Garcia sur la question en nous projetant non seulement jusqu’à l’anthropocène mais aussi (qui sait?) au-delà.
Faire fleurir la prison
Le sujet du nouveau livre de Lauren Groff, Matrix, est aussi l’une de ces héroïnes dont l’Histoire n’aura pas daigné retenir la vie. Était-ce parce que Marie de France était une femme révolutionnaire dans un Moyen Âge qui les préférait cloîtrées? C’est du moins la thèse admirablement mise en fiction par Groff. Bien qu’il soit tout à fait permis d’en imaginer d’autres (puisque tout ce qu’il nous reste de Marie de France sont ses Lais et ses Fables et que même leur maternité ne fait pas tout à fait l’unanimité), l’histoire de la romancière américaine est à la fois séduisante et extrêmement puissante. Comme la postérité n’a rien retenu de sa vie, il est permis de l’imaginer! Un terrain de jeu que Groff fait sien avec une maîtrise qui explique aisément les louanges que Barack Obama lui adressa pour son précédent roman, Les furies.
Issue de la noble famille des Pantagenêts, la Marie de Groff est une femme colosse au physique disgracieux, mais à l’intelligence prodigieuse. Amoureuse de la reine Aliénor d’Aquitaine, elle qui a pourtant fait partie de sa cour rapprochée en est brutalement exclue à l’aube de l’âge adulte. D’intime de la reine, elle est devenue gêneuse, entachant l’éclat de sa grâce. À son grand malheur, elle est envoyée dans une abbaye froide, pauvre et crasseuse du fin fond de l’Angleterre. D’abord éplorée, l’éconduite retrouve sa véritable nature de battante et décide de transformer sa prison en paradis terrestre. Grande réformiste, Marie saura d’abord conquérir le cœur sinon le respect de ses moniales avant de pousser toujours un peu plus loin ses visées de prospérité.
Peu à peu, sa toile d’influence s’étend, la richesse du monastère croît et ses libertés se font plus grandes. Hors de la vie domestique et de l’enfantement, ce lieu offre une solution de rechange aux femmes de son époque et prend assez vivement des allures d’utopie féministe. Là, les femmes peuvent être autre chose que belles ou mères. Depuis son fief de plus en plus imprenable, Marie en vient à défier le patriarcat du clergé, transformant le mysticisme de ses visions en un plan pour l’avenir, trouvant l’amour sinon le réconfort auprès d’autres femmes. Dans son sillage comme dans celui d’autres femmes visionnaires dont le passé reste à dévoiler ou à réinventer « se poursuivent les travaux et les jours » en un insupportable mouvement lent de sac et de ressac. « Les oripeaux anciens tombent, on les laisse au bord du chemin pour que la jeunesse les ramasse et à son tour les endosse. »