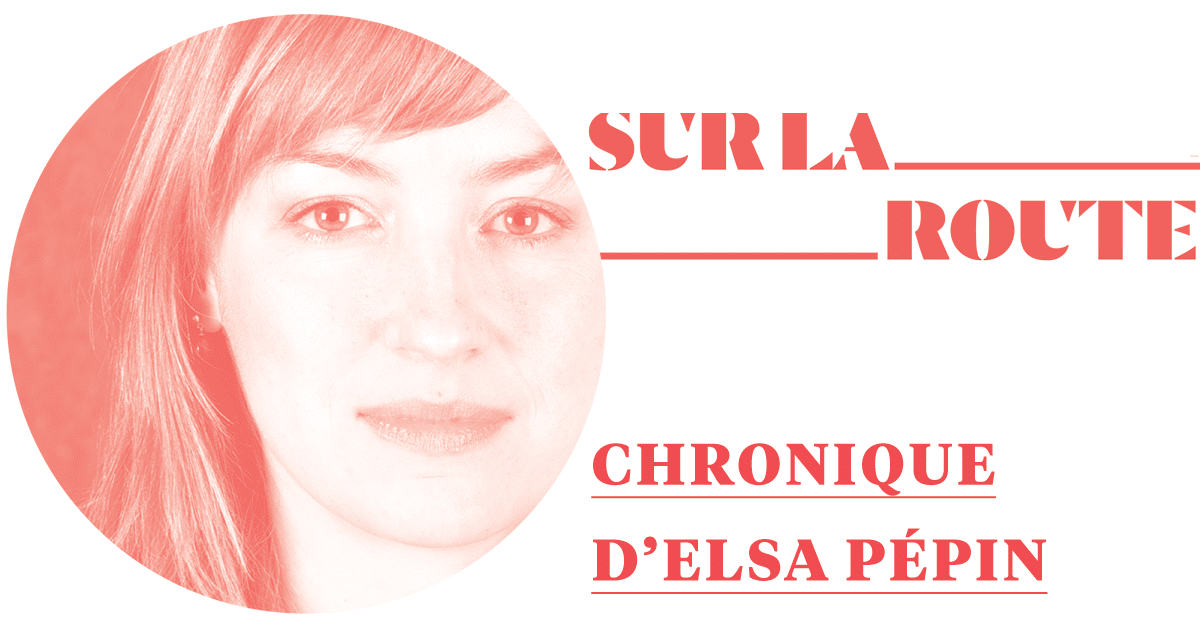Dans un roman à teneur autobiographique comme il a l’habitude de les faire depuis L’adversaire, Emmanuel Carrère raconte dans Yoga la relation qu’il entretient avec le yoga, la méditation et le taï-chi depuis trente ans. Ce projet coïncide avec une période heureuse de sa vie, alors qu’il s’étonne d’être, depuis dix ans, capable d’aimer et de travailler, ce qui correspond à la définition de la santé psychique selon Freud, nous rappelle-t-il. Un sursis accordé dans une vie marquée par des épisodes dépressifs.
Le livre s’ouvre sur une retraite Vipassana : dix jours de méditation intensive qui ont pour but de faire le ménage dans la tête. L’auteur s’essaie à définir la méditation : « rester assis, immobile et silencieux », puis observer les pensées qui s’entrechoquent dans la tête et « voir les choses comme elles sont ». Or Carrère se voit forcé d’interrompre sa retraite : un ami a été tué lors des attentats de Charlie Hebdo. La vie le rattrape, suspendant son exercice de contrôle des vritti (fluctuations mentales), revenues en force.
Le livre relate ensuite la plongée de Carrère dans une dépression sévère qui l’a conduit jusqu’à un séjour à l’hôpital Sainte-Anne où il sera remis sur pied à coups d’électrochocs. Sans que l’événement soit raconté comme tel, on devine qu’une rupture amoureuse a contribué à cette rechute. Rappelons que l’ex-conjointe de Carrère, la journaliste Hélène Devynck, a demandé à l’auteur de retirer le passage sur leur divorce, refusant d’apparaître dans ce livre qui, selon elle, tronque la réalité pour « servir l’image de l’auteur ». La cause est légitime, mais il me semble que la frontière entre le vrai et le faux importe peu au lecteur, sachant que l’auteur réécrit et réarrange de toute façon la réalité. Il est vrai toutefois que l’ellipse de la rupture amoureuse laisse un étrange angle mort au livre. La force se trouve ailleurs. Malgré un début un peu mou et un passage un brin forcé où l’auteur raconte sa guérison auprès de réfugiés aux vies plus tragiques que la sienne, Yoga s’avère d’une percutante vérité dans le portrait que l’auteur nous livre de sa bipolarité. Alors que la transformation du « livre souriant sur le yoga » en autobiographie psychiatrique peut d’abord paraître incongrue, on découvre qu’au fond, rien n’est moins lié.
Après avoir célébré l’harmonie méditative, Carrère se voit rattrapé par sa nature profonde, cette grande loi de l’alternance à laquelle il est soumis et se révèle être l’obsession autour de laquelle tous ses livres tournent : « le yin naît du yang, du yang, le yin, et on reconnaît le sage à ce qu’entre un pôle et l’autre il se laisse en douceur porter par le courant. […] On reconnaît le fou à ce qu’au lieu d’être porté il est emporté par le courant, balloté d’un pôle à l’autre avec le plus grand mal à tenir la tête hors de l’eau, et à ce que le yin et le yang ne sont pas pour lui complémentaires mais ennemis, tous les deux acharnés à sa perte. »
Mêlant confession intime et essai philosophique et spirituel, Carrère se révèle dans toute sa fragilité, peinant à laisser se dissoudre son ego. Il avoue que le seul véritable enjeu de la vie, l’amour et la capacité à aimer, lui a échappé, use d’autodérision, raconte la mort de son éditeur en 2018, Paul Otchakovsky-Laurens, avec qui il a publié toute son œuvre, et par qui le livre va en quelque sorte résoudre l’énigme posée au départ, à savoir si la méditation peut s’inscrire dans le réel plutôt que de le fuir. « La joie pure est aussi vraie que l’Ombre », conclut Carrère, rappelant qu’aspirer à l’harmonie est impossible sans faire face au chaos qu’est la vie.
L’art de la dissociation
« Danser c’était apprendre à dissocier. Pieds poignards et poignets rubans. Puissance et langueur. Sourire en dépit d’une douleur persistante, en dépit de la nausée, un effet secondaire des anti-inflammatoires. » Dissocier : l’image est forte pour raconter l’histoire de Cléo, qui a eu la vie brisée à l’âge de treize ans, un âge où la notion de consentement est trop floue pour être comprise, où il vaut mieux mettre à distance le souvenir honteux.
Naïve, assoiffée de merveilleux et issue d’une famille modeste, Cléo est remarquée par une certaine Cathy, apparue à son cours de danse, qui l’appâte en lui promettant une bourse d’études de la fondation Galathée qui finance des projets d’exception. Celui de Cléo — devenir danseuse professionnelle — est retenu. On lui ouvre alors les portes d’un monde inconnu, inaccessible : les grands restaurants, les cadeaux. Cléo se laisse conduire jusqu’au jury, des hommes dans la cinquantaine réunis dans un appartement, qui, entre deux attouchements, lui diront qu’elle doit se détendre et faire preuve de plus d’« audace » et de « maturité ». Victime d’un réseau pédophile, Cléo sera aussitôt récupérée pour recruter elle-même d’autres victimes, devenant ainsi le centre d’intérêt de ses camarades d’école mais aussi bourreau à son tour.
Construit par la multiplication des points de vue sur elle, le roman raconte Cléo par touches, révélant la complexité de cette jeune fille qui aura « treize ans pour l’éternité », sa vie défaite, assaillie par une culpabilité, une honte innommable. Devenue danseuse de music-hall snobée par l’élite, Cléo se construit à partir de cette blessure, disparaît derrière le costume, le maquillage et le visage souriant, anonyme, s’effaçant derrière cette seconde peau enfilée comme une armure. « Tout était faux, là résidait la beauté troublante de ce monde » où les filles dissimulent derrière les paillettes les cicatrices, les rides, la souffrance.
S’inscrivant dans la foulée du mouvement #MeToo, Chavirer aborde les terribles répercussions d’agressions sur des mineures et la complicité des adultes à une époque (les années 80) où on ne dénonçait pas les hommes mûrs qui sortaient avec des mineures. Les temps ont changé, mais du chemin reste à faire et le roman arrive à point, cernant avec force et justesse la relation trouble et maudite de ces enfants avec leurs corps brisés. Combien de ces vies ont chaviré à jamais pour satisfaire le désir d’ignobles pervers? Sans se faire vindicative ni moralisatrice, Lola Lafon traque avec finesse de son écriture précise et inventive le rapport au corps des danseuses qui, à coup de contrôle, vont chercher à cacher des blessures. Devant les projecteurs, la danseuse brille pour mieux éteindre ce qui la terrorise, pour se dissocier de ce qui fait mal.