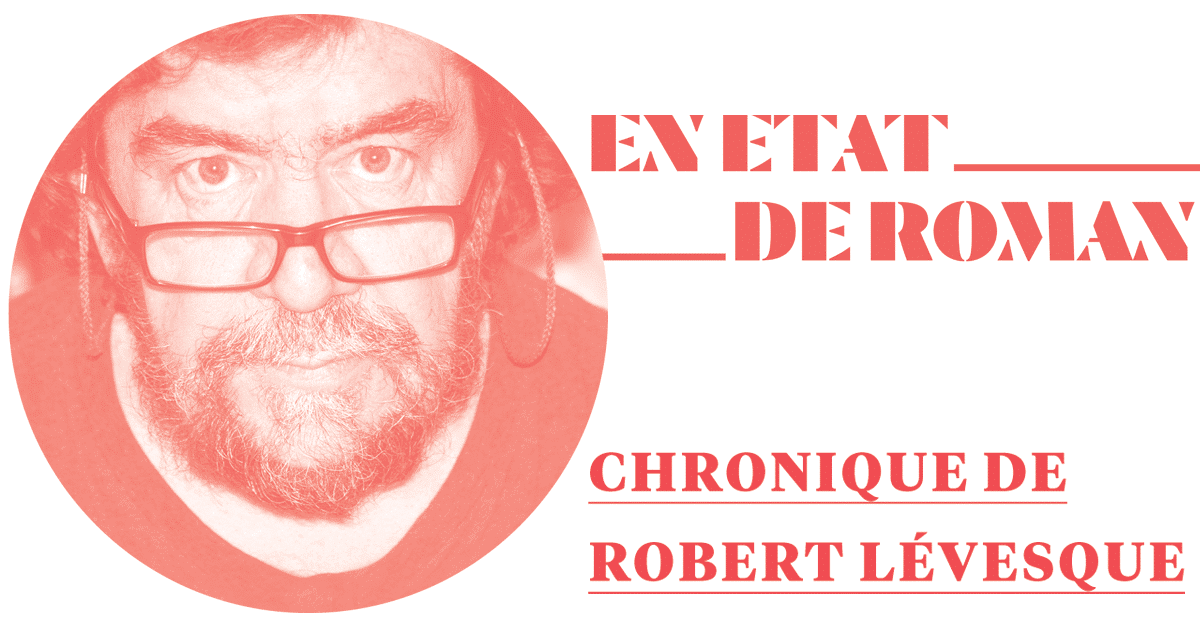Dans ses Souvenirs littéraires, Maxime du Camp, son exact contemporain qui lui voua un temps « une indestructible amitié », disait de Flaubert qu’il était « une sorte de chirurgien des lettres disséquant les passions et faisant l’autopsie du cœur humain ». Zola, lui, a écrit de son aîné de vingt ans qu’il « reconstruisait les êtres avec des fragments d’os ». Il n’était donc pas tant un paresseux, comme l’animal par lui évoqué (le bradype), qu’un minutieux, comme tout chirurgien digne de ce nom, ce que furent son père et son frère à Rouen.
Convaincu dès le lycée que sa vie se ferait dans la littérature, Flaubert apparaîtra aux gens de lettres qu’il fréquentera comme un minutieux, certes, mais aussi comme un anxieux, ce qui n’arrangea pas les choses pour sa production littéraire. Flaubert n’aura pas la force de travail qu’aura après lui un Zola. Il est lent, même dolent, l’ami Maxime du Camp moquait son côté casanier, et leur solide amitié viendra à se disloquer au moment de la publication de Madame Bovary dans la revue qu’il a fondée, Maxime s’exaspérant des corrections à n’en plus finir de Gustave et Gustave accusant Maxime d’effectuer des coupures pour mettre au plus vite sous presse.
Ce Flaubert de l’indolence inquiète, pour ne pas dire de la déprime, un écrivain français né en 1982 vient d’en brosser un portrait remarquable, d’en faire une saisie superbe. Alexandre Postel, avec Un automne de Flaubert, a choisi (et réussi) d’entrer dans la vie du grand écrivain quand, à 53 ans, en septembre 1875, vingt ans après Madame Bovary, il passe quelques semaines en Bretagne, à Concarneau, l’âme fatiguée, le cœur lourd, la plume lasse, aux prises avec une panne d’inspiration et des ennuis financiers. Sa relation fougueuse avec Louise Colet est terminée depuis un an. C’est un célibataire qui a des problèmes de santé, un surpoids. Il a l’air, comme il le décrit à un de ses épistoliers, « d’un vieux cabotin et d’un vieux boucher ». Postel, qui possède bien son Flaubert, a le toupet de le décrire assis nu sur le bord de son lit regardant « son sexe mou comme un navet bouilli ».
« Comme on se souvient d’un chien perdu, c’est ainsi qu’il pense à la littérature. Il cherche à se convaincre qu’il en est débarrassé, que la vie sans elle serait plus douce et plus facile », écrit Postel. Flaubert, à ce moment-là, vient de laisser en plan le manuscrit de Bouvard et Pécuchet entamé il y a trois ans, il ne sait pas s’il reviendra à son histoire de bonshommes idiots. « Ce chien de livre, peut-être au fond n’est-il pas faisable? », se permet d’écrire Postel qui a traversé lettre à lettre le volume IV de la correspondance de l’écrivain (les années 1869 à 1875).
S’il a choisi Concarneau, ses pluies, ses odeurs de sardine, c’est qu’il y a un ami qui n’a rien à voir avec le monde de la littérature, Georges Pouchet, zoologue, qui dirige un vivier-laboratoire, dissèque les poissons, étudie leurs tissus nerveux, un savant du piscicole, célibataire comme lui, républicain convaincu, britannique par sa mère. Ils vont faire des promenades, prendre des bains de mer, vider des plateaux d’oursins, crevettes et palourdes. Pouchet lui fait du bien. Et la servante à l’auberge Sergent lui apparaît comme un cœur simple…
Dans le tréfonds de sa détresse, qu’il combat, Flaubert aspire à sortir de lui-même. « Avec un ami cher, écrit Postel, il serait tenté de se livrer, d’ouvrir les bondes de son chagrin; en présence d’un importun, il se refermerait comme une huître et s’enfoncerait dans sa morosité. Pouchet se situe à distance idéale : c’est un bon compagnon, pas un intime que l’on tutoie. Flaubert sait qu’il aura plaisir à le fréquenter, mais qu’en sa présence il sera contraint de se tenir, et c’est ce dont il a besoin, non de la proverbiale épaule pour pleurer. » « Étrange loi, ajoute le portraitiste du Flaubert de 53 ans, qui veut que les êtres les plus à même de nous consoler soient rarement les plus proches de notre cœur. » Accordons à Postel que sa remarque, si juste, aurait pu se lire sous la plume de Tchekhov.
Ses habitudes s’installent, sommeils de douze heures, promenades de fins d’après-midi avec son savant des poissons, tentatives d’écrire des lettres à sa nièce Caroline à qui il a servi de père, étonnements quand Pouchet lui montre un petit homard en train de muer dans un grouillement affolé de pattes et d’antennes, petits-déjeuners apportés par la fille de l’auberge qu’il se prend à nommer « mon petit ange », et absolu silence, inviolé par l’ami, sur ses œuvres, Bovary, Salammbô, L’éducation sentimentale…, comme s’il n’était pas, comme s’il n’était plus le grand Flaubert.
Puis un matin, après avoir vu Pouchet disséquer une raie, lui revient un souvenir d’enfance, son père aperçu en train de disséquer calmement le cadavre d’une femme : « le voilà, écrit Postel, qu’il se penche sur la morte; son expression ne trahit aucune émotion particulière. » Flaubert rentre à l’auberge, s’étend, prend un livre, le repose, se relève, va à la fenêtre, le port est désert, le vent charrie les odeurs de sardine. Postel écrit : « Quand il descend déjeuner une heure plus tard, il a commencé à ébaucher, sur une large feuille de papier écru des papeteries Canson, le plan d’un conte médiéval. »
Ce sera La légende de saint Julien l’Hospitalier. Un fond de tiroir. Il a entrepris ce texte à 20 ans, à la vue d’un vitrail de la cathédrale de Rouen illustrant un roman du XIIIe siècle. À 32 ans, il s’y est remis, effectuant des recherches sur le Moyen Âge. Là, à 53 ans, dans son automne concarnois, repiqué, il termine cette légende sur un garçon aimant dès l’enfance tuer des animaux, et qui (selon la prédiction que lui fit un grand cerf lors d’un massacre) tuera son père et sa mère, effroyable homme finissant sa vie, sanctifié, dans les bras d’un lépreux…
Lui, Flaubert, il lui reste alors cinq ans à vivre.