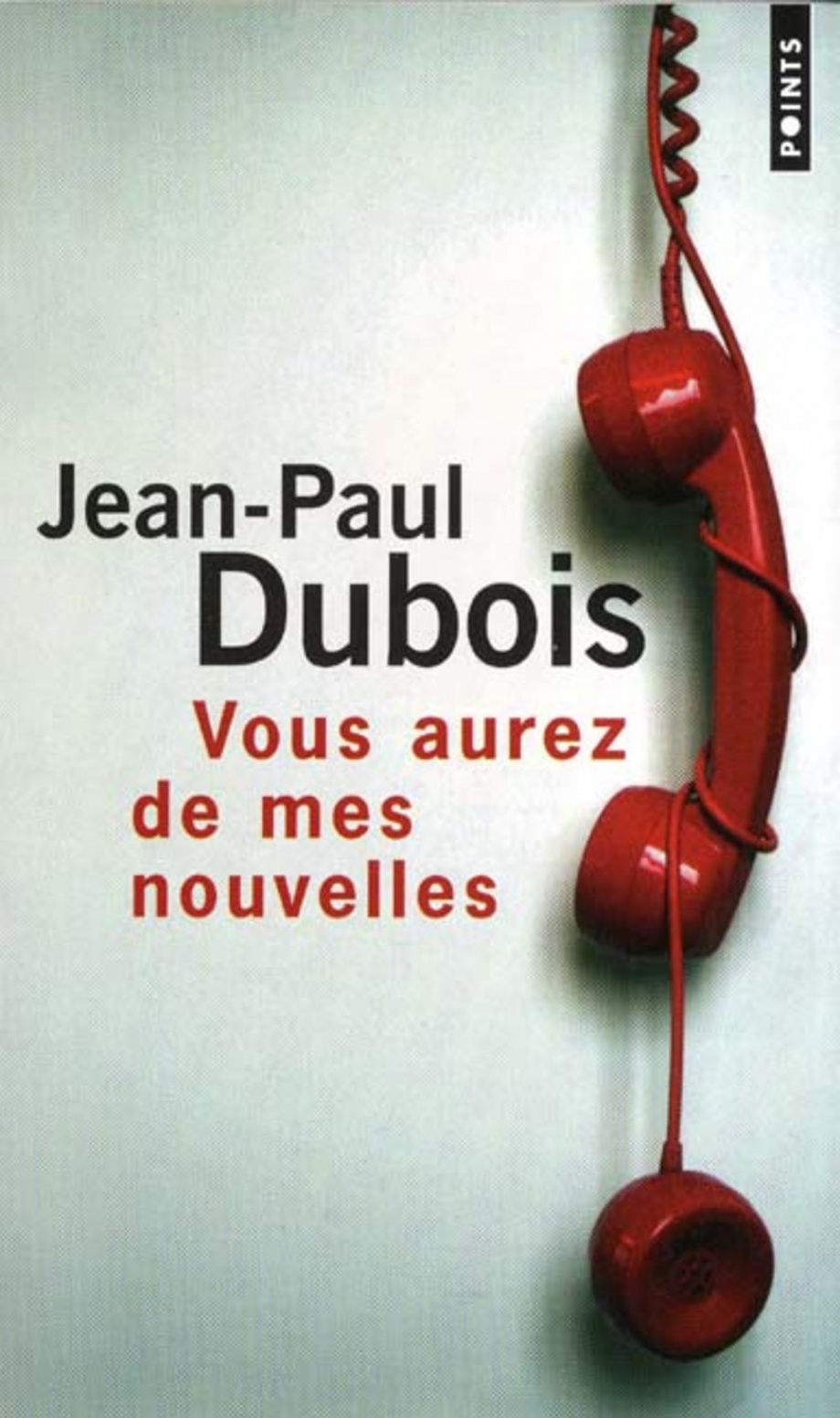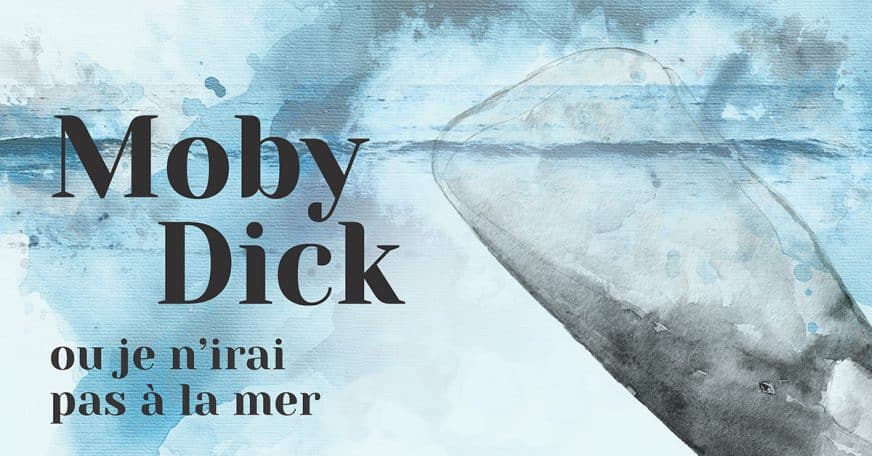À mi-chemin entre l’humour pince-sans-rire de Christian Oster et l’intelligence narrative de Paul Auster, on retrouve la manière et le style de Jean-Paul Dubois, le plus américain des Français. Doté du don peu commun qu’est celui de la pertinence dans l’impertinence, Dubois cultive depuis longtemps une prose tout en finesse, où la drôlerie côtoie l’admirable et le sarcasme, la sympathie. Retour sur trente ans de présence littéraire.
C’est en 1984 que paraît pour la première fois un livre écrit par Jean-Paul Dubois. Compte-rendu analytique d’un sentiment désordonné, obscur petit polar aujourd’hui introuvable, racontait l’histoire de l’inspecteur de police Rasmussen à la poursuite d’un tueur en série nommé Sénèque. De cette entrée en littérature par la petite porte noire, Dubois ne gardera que la couleur de l’humour. Trois ans plus tard, sera publié Éloge du gaucher dans un monde manchot, un essai qui recense les miscellanées de la senestre vision du monde en un pot-pourri d’anecdotes et de digressions dont la teneur annonce déjà ce qui sera la marque de commerce de Dubois : un point de vue légèrement champ gauche.
Avec Tous les matins je me lève, Jean-Paul Dubois cesse de tourner autour du pot et plonge dans le roman. À la fois pénétrant, ironique et tendre, ce premier essai romanesque est une vraie réussite et pose les jalons d’une œuvre dont le meilleur reste à venir. Paul Ackerman, premier d’une série de personnages polymorphes qui porteront tous ce prénom, porte en lui la saveur acidulée d’un quotidien ronronnant fait de petits touts et de grands riens. Poursuivant dans la même veine mais en plus tordu, Maria est morte accorde une place plus importante aux lubies de son auteur, notamment et surtout les voitures, prétextes à de nombreuses et abracadabrantes métaphores filant à toute allure (sic). Viendra ensuite Les poissons me regardent, récit claustrophobe et paranoïaque où Emmanuel Zimmerman, journaliste sportif au moral plombé, doit composer avec la réapparition d’un père disparu depuis des années. Le pessimisme de ces trois premiers romans est heureusement contrebalancé par l’écriture de Dubois, cynique au possible, inventive dans sa perspicacité, attendrissante dans ses émois puérils d’hommes fatigués aux personnalités moites.
C’est toutefois avec Vous aurez de mes nouvelles, Grand Prix de l’humour noir 1991, que Jean-Paul Dubois prend véritablement le taureau par les cornes. Vingt-huit historiettes disparates peuplent ce livre hétéroclite au charme puissant. L’audace de Dubois déride, l’énormité de certaines propositions frôlant parfois la provocation pure, pour notre plus grand plaisir. Toujours avec cette morosité typiquement nord-américaine, qui d’une certaine façon le rapproche des Contes de la folie ordinaire de Bukowski, les nouvelles de ce recueil cultivent le malaise et sèment le trouble, laissant derrière elles de petites traînées d’acrimonie douce-amère. Plus émouvant que drôle en dépit de son titre, Parfois je ris tout seul, qui sort l’année d’après, regroupe 123 chroniques tenant le plus souvent en un seul paragraphe. Le ton intimiste de plusieurs d’entre elles et la sincérité limpide qu’on y perçoit en font un petit chef-d’œuvre de concision et de justesse. Qu’il y soit question d’accident de voiture, de couple, de chien, de manœuvres de réanimation sur un chantier de construction, du bonheur, de la tristesse ou de la mort d’un frère, Dubois réussit chaque fois à capter l’essence de quelque chose, échantillons concentrés d’éléments épinglés dans toute leur intensité minimaliste.
Suivent ensuite Une année sous silence, Prends soin de moi et La vie me fait peur, trois autres romans où Dubois continue de peaufiner différentes incarnations du personnage de Paul. Dernières franches incursions du côté d’un humour de moins en moins noir et de plus en plus jaune, ce trio de romans laisse percer la profondeur navrée de ceux à venir. Délaissant progressivement l’ironie rutilante de ses débuts, Dubois se fera plus introspectif dans son écriture, assumant davantage, dirait-on, une sensibilité jusque-là tenue en respect par une tendance marquée pour l’autodérision. Kennedy et moi illustre bien cette inversion des rapports d’autorité entre émotivité et cynisme, celle-ci cessant d’être invalidée par celui-là pour au contraire en devenir le prolongement naturel, la conséquence logique.
Huit ans séparent la parution de ce roman et celle d’Une vie française, qui fait de Dubois une superstar du monde littéraire. Entre-temps, deux recueils de chroniques sur l’Amérique pour le compte du Nouvel Observateur et deux romans finissent de concrétiser la scission entre Dubois le chroniqueur et Dubois le romancier.
La suite du parcours de Jean-Paul Dubois, dont la réputation n’est plus à faire, voit le rythme de ses publications s’espacer, notre homme préférant de loin la vie à l’écriture. Désormais très à l’aise avec le fait de ne pas écrire, il annonçait déjà, lors de la parution des Accommodements raisonnables, en 2008, que ce pourrait fort bien être son dernier livre. Heureusement pour nous, il n’en fut rien, Dubois réapparaissant en 2011 avec Le cas Sneijder, que l’on vient d’ailleurs tout juste de porter à l’écran.
Après cinq ans d’absence, on peut depuis quelques semaines se remettre le nez à l’intérieur d’un livre signé Jean-Paul Dubois. La succession, qui met en scène les tribulations d’un nouveau Paul, Katrakilis cette fois-ci, semble voué à un bel avenir, notamment grâce à sa présence au sein de la première sélection pour le prix Goncourt 2016. On aurait tort de s’en priver.