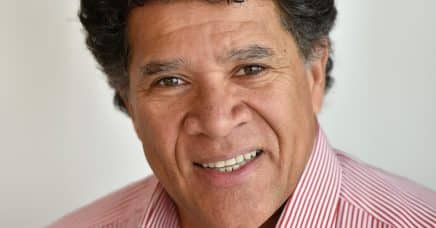Vous avez fait vos premières armes dans le métier en 1994 comme designer graphique puis comme directeur artistique en France. Au Québec depuis 2001, que notez-vous comme différences entre les cultures? S’adresse-t-on de la même façon par l’image à un Québécois qu’à un Français?
C’est un peu difficile de répondre à cela, car mon marché est devenu principalement québécois. Il y a quelques années, j’aurais répondu sans hésitation qu’en communication, l’approche était différente. De mon expérience dans les affiches, je trouve que c’est plus difficile de sortir une image très forte graphiquement en France. Il y a de très bons studios et graphistes qui le font, mais j’ai l’impression que c’est un vrai combat avec le client pour réussir à sortir des chemins conventionnels. La France est parfois freinée par le poids de sa culture. Un risque doit toujours être très encadré et mesuré, alors qu’ici, la prise de risque semble presque normale. Oser essayer et accepter de se tromper. Depuis que je vis ici, je travaille beaucoup plus avec « mes tripes » et parfois sans filet. Lorsque je me retiens, c’est parfois même le client qui me demande de me lâcher plus. C’est libérateur et je suis encore parfois étonné des possibilités. Il y a aussi les phénomènes de mode qu’il faut considérer. Les tendances ne sont pas toujours synchronisées de chaque côté de l’océan. Des styles d’illustrations, de graphisme ou parfois même d’images en général (photo versus illustration). Lorsque l’on sort de la communication, dans les livres illustrés par exemple, je pense que c’est beaucoup plus ouvert et libre, car un livre ne s’impose pas aux autres (contrairement à une affiche). On le choisit, on l’ouvre et on le referme. En communication, c’est différent, car le but est d’être vu et donc de s’imposer à la vue de tous.

En 2016, la Librairie Gallimard a fait peau neuve en vous engageant pour refaire l’habillage de ses murs, la signalétique, l’enseigne. Qu’avez-vous aimé dans ce mandat, et quel a été le plus grand défi?
En 2016, c’était un défi purement de designer graphique. Je suis parti de choses existantes propres à la librairie (couleurs et typographies) avec lesquelles je me suis amusé, tantôt de façon invasive (mur noir rempli de typographies et de citations), tantôt très sommaire pour contrebalancer (signalétique épurée). Il fallait marquer l’espace, mais laisser également vivre les couvertures de livre. Gallimard a toujours été très ouvert aux propositions. Depuis, j’interviens également à titre d’illustrateur pour leurs campagnes Folio, pour habiller la librairie ou pour leurs communications.
Dans la collection « Les grandes voix » aux éditions Les 400 coups, vous avez illustré J’en appelle à la poésie, un texte de David Goudreault. Une fois de plus, on retrouve votre lecture intelligente du sujet et une mise en images qui en propose une vision éclatée, profonde et percutante. Comment arrivez-vous à trouver le juste équilibre entre le texte littéral et une vision originale qui peut également en émaner?
J’essaye toujours de partir du même principe, que cela soit en communication graphique ou en illustration, avec cette idée que le meilleur service à rendre à un client est de ne pas lui donner exactement ce qu’il veut. En d’autres termes, j’essaye d’aborder les choses par un autre angle. Je fais rebondir les idées entre elles pour qu’elles m’amènent ailleurs ou qu’elles se complètent. J’accueille les flashs que cela suscite en moi et j’essaye de les comprendre (ou pas). Excepté lorsque je fais des illustrations très didactiques où je dois illustrer ce qui est mentionné, j’aime interpréter l’émotion et/ou en créer une avec ce que j’ai lu. Pour le livre de David Goudreault qui part d’un slam, cela a été un peu particulier. Ce n’est pas la lecture qui m’a inspiré, mais l’écoute. J’ai lu plusieurs fois le texte reçu par mon éditeur, sans parvenir à le réinterpréter en images. Puis, j’ai tassé les feuilles de texte et j’ai simplement écouté le slam, plusieurs fois. Là, tout est sorti extrêmement vite. J’ai décidé d’aborder le texte avec la même vigueur que David, et j’ai jeté sur papier tout ce qui me venait, sans correction ou retenue. Il y avait une démarche un peu punk que David et mon éditeur ont aussitôt accueillie à ma grande joie.
Vous utilisez régulièrement la technique du collage. Qu’aimez-vous dans cette approche? Quels autres médiums privilégiez-vous?
Les collages que je fais actuellement sont principalement des papiers découpés de texte (de type journal). Parfois, il m’arrive d’intégrer des objets, mais c’est plus rare. J’utilise le texte découpé comme une matière à part. En plissant les yeux, c’est du gris. En y regardant d’un peu plus près, les lignes de texte nous donnent du mouvement dans les formes. Une dynamique se crée. Encore plus près, on peut y déceler du contenu. Par ailleurs, j’aime le fait que le papier vient casser ou se positionner dans la structure globale de l’illustration, entre les formes pleines, vides et les traits. Il apporte une dimension supplémentaire et palpable. J’ai longtemps travaillé en traditionnel (carnets de croquis, encre, papier, peinture) que je numérisais pour assembler et retravailler sur ordinateur. Depuis trois ou quatre ans, je continue d’aborder mes projets dans mes carnets pour dégrossir les idées, mais je passe très vite à la tablette graphique. Cela dit, j’évite de me perdre dans les effets et les tonnes de possibilités graphiques qu’offre le numérique pour rester fidèle à mon approche.

Vous avez signé et illustré Le guerrier massaï, une superbe histoire de marin, d’horizon, de rêves, de voyages, de filiation. On y lit de remarquables phrases d’ailleurs, telles que « J’étais là où l’on met en marche le moteur des possibles ». Il s’agissait de votre premier livre. Était-ce un pas de côté dans votre parcours artistique ou vous aimeriez reproduire l’expérience? Qu’est-ce que la fiction vous permet qu’une commande d’agence ne vous permet pas?
Je souhaite vivement poursuivre cette démarche. Depuis longtemps, j’écris de petites phrases qui viennent parfois accompagner mes images, mais c’était la première fois que je partais dans un récit. Peut-être que je n’aurais pas osé si mon éditeur (Les 400 coups) ne me l’avait pas suggéré. Le guerrier massaï est un récit autobiographique en grande partie, même s’il part dans l’onirisme. Pour une première expérience d’auteur, cela facilitait la tâche en permettant d’aller puiser directement dans mes souvenirs (et ceux de mon père) pour construire les bases du récit. Ensuite, j’ai eu beaucoup de plaisir à manier les phrases et travailler avec ma directrice littéraire (May Sansregret). Le fait d’être aux commandes de l’histoire et de l’image permet de jongler entre les deux mondes pour qu’ils se répondent au mieux. Rien n’est figé. Si quelque chose coince, on peut remanier la structure, changer les mots ou les images pour chercher l’équilibre et la bonne dynamique. Il y a eu beaucoup de changements entre la première mouture de l’album et la version publiée. Des ajouts, des coupures, des transformations, autant visuelles que textuelles. Je travaille actuellement sur un autre projet de livre en tant qu’auteur (et illustrateur). Une fiction structurée en cases et sans texte qui devrait s’étendre sur 120 pages. Une nouvelle expérience qui permet d’explorer différemment le récit.
Vous avez illustré trois des recueils de poésie de François Gravel, aux 400 coups, le plus récent étant Ça marche! Et autres poèmes sportifs. Ce sont des poèmes rigolos, qui jouent avec les mots et qui font la part belle aux rimes. Le public cible est le jeune lecteur. Comment vous appropriez-vous les poèmes et figures de style de Gravel, pour ensuite en donner des images qui attireront l’attention des plus jeunes lecteurs, à la fois sur l’image, mais aussi sur le texte?
Les textes de François sont toujours très imagés et il faut donc que je m’éloigne aussitôt de la première idée qui me vient en tête, ou que je la détourne. J’essaye de prolonger l’humour de François en gardant des mots-clés et un ton. Même s’il s’agit d’un jeune public, je ne veux pas rester collé au texte ou changer mon approche. J’aborde ses poèmes comme un jeu de cadavre exquis : avec ce qu’il me donne, où est-ce que je peux aller? Lorsque je sens que je n’apporte rien de plus au texte, je recommence. Ce sont Les 400 coups qui nous ont réunis et qui ont donc formé notre duo. Cela aurait pu paraître improbable, car je n’avais encore jamais illustré pour un jeune public.
Qu’est-ce que le livre propose que les autres supports (télé, affiche, etc.) avec lesquels vous travaillez au quotidien dans votre compagnie Le studio Laurent Pinabel n’offrent pas?
La pérennité et la transmission. Je crois qu’au fond de nous, on a tous envie de faire un livre, non? À l’ère du numérique, le livre est encore plus symbolique. Il est concret, physique, a une odeur, un poids, il se prête, s’offre, se partage, se découvre… C’est un objet qui va nous emmener quelque part en tant que lecteur ou auteur. La couverture, c’est l’équivalent de l’affiche d’un spectacle dans la rue. Ensuite, on ouvre le livre comme on entre dans la salle pour découvrir le spectacle en question. Et là, on se lance. On veut que le spectacle nous marque, qu’il soit bon, sensible, beau et rythmé. Et s’il n’est pas tout ça, qu’il soit du moins authentique. Un livre restera toujours quelque part, mauvais ou génial, dans une bibliothèque ou oublié au fond d’un grenier. Et j’adore cette idée.

Photo : © Sophie Lecathelinais