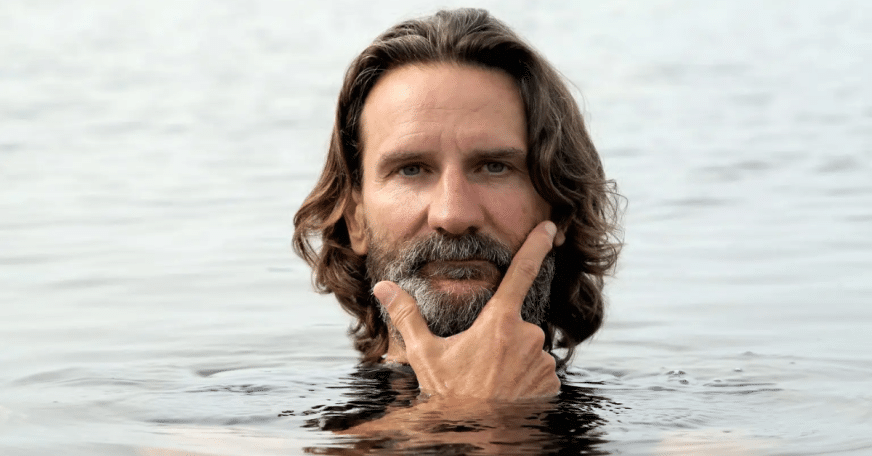Votre roman, sous des auspices apocalyptiques, possède un indéniable élan poétique, nous invitant à considérer notre connexion à nous-mêmes, à recréer nos relations aux autres, à réapprendre nos liens avec la nature et à endosser un rythme moins frénétique. Y avait-il au départ de l’écriture cette ambition d’une exhortation à l’éveil ou était-ce autre chose?
Au départ de l’écriture, il y a la volonté d’écrire une histoire pour se rassembler, se réchauffer. Ma petite sœur m’a dit un jour que rêver, elle ne savait pas à quoi ça ressemblait, elle ne s’était jamais souvenue de ses rêves. Ça m’a fait froid dans le dos. Je trouve qu’on vit une époque qui ne fait pas de cadeau aux rêveurs. Nous avons des vies pressées, des mini-ordinateurs greffés dans nos poches qui nous demandent de répondre dans la seconde, et non seulement la pollution est partout, mais nos téléphones nous le rappellent en permanence… Pas facile dans ces conditions de s’abandonner à l’insouciance que demandent les rêves. Mais La disparition des rêves n’est pas un livre sur la fin du monde, au contraire, c’est un livre sur comment on peut faire ensemble pour que ce ne soit pas la fin du monde. Il y a une phrase d’Italo Calvino que j’aime beaucoup, elle est citée dans le livre : « Chercher et savoir reconnaître qui et quoi, au milieu de l’enfer, n’est pas l’enfer, et le faire durer, et lui faire de la place. »
Par plusieurs aspects, votre livre met en garde contre le désir d’immédiateté, l’envahissement des images et l’accélération de la cadence de nos vies. Les gens dans votre roman ne rêvent plus; or, pour rêver, il faut du temps, retrouver l’importance de l’« inutile » et contempler parfois le vide. Sachant cela dans le monde qui est aujourd’hui le nôtre, comment arriver à rejoindre, individuellement et collectivement, la sphère onirique?
Le livre est une enquête pour tenter de répondre à cette question. Il propose une sorte de liste à la Prévert : on peut s’éloigner des écrans, se soustraire à la réaction qu’ils réclament, se rapprocher des océans et de l’eau, souffler, voyager aussi, tant le mouvement fait partie de la cure… Et danser, ne pas oublier de danser avec les autres, et de jouer, de se faire des forces ensemble. Nous vivons une révolution technologique sans précédent qui nous a tous pris de court. Mais la séparation de nos vies, le relatif isolement que nous imposent nos façons de faire modernes, n’est pas un mal incurable. Je suis d’un pessimisme enthousiaste : je crois que les mains ne cessent pas de se tendre, que nous avons vissé au corps le désir de nous retrouver, il s’agit seulement de prendre le temps de lever les yeux de nos journées trop morcelées. Ce n’est pas facile, mais je crois que la poésie de nos vies vaut le coup qu’on s’y attelle, qu’on se batte pour elle.
La disparition des rêves donne matière à réflexion. Pourquoi avoir pris le pari du roman au lieu d’adopter la posture de l’essai par exemple?
C’est encore une histoire de rêve! À plus d’un titre : j’ai fait des études de philosophie (d’ailleurs, Spinoza occupe une place non négligeable dans le livre, autour de l’idée d’une certaine « brigade de la joie »…) mais j’ai toujours rêvé d’écrire un roman. Mais surtout, il me semblait que la fiction, plus fortement qu’un essai, a ce pouvoir de faire rêver, d’embarquer dans un monde parallèle, pourquoi pas onirique. La place que nous accordons aux récits est par ailleurs un des thèmes importants du livre. Est-ce qu’ils sont en train de disparaître eux aussi? Comment faire pour se fabriquer des récits communs, des mythes qui nous rassemblent? Comment se raconter encore des histoires? La disparition des rêves est une enquête, un polar existentiel. La narratrice Camille Dutilleul doit résoudre un problème tout à fait sérieux : si les rêves disparaissent, où sont-ils? Il faut répondre…
On a tendance à qualifier les rêveurs d’idéalistes dont les vues s’incarnent difficilement dans le monde réel. Pourtant, à la lecture de votre livre, on comprend bien que les rêves sont le germe d’une matérialité concrète puisqu’avec l’espoir dont ils sont porteurs, ils figurent à l’origine de grandes réalisations. Selon vous, pourquoi reconnaissons-nous si peu le pouvoir des rêveurs?
Les humains sont de drôles d’animaux! Des animaux qui croient peut-être un peu trop qu’ils sont raisonnables? Ou qui aimeraient le penser et qui rejettent donc ce qui leur échappe, et les rêves en font partie. Encore une fois, pas facile de vivre en poète. Mais c’est pourtant ce qui compte le plus et peut amener au meilleur. Cependant, il faut des forces et on ne peut sans doute pas y arriver seul. Un autre titre possible était Le communisme des rêves. Le livre fait le postulat que nous rêvons ensemble. Imaginez un peu… et si c’était vrai? Alors ce serait normal et plutôt bon signe qu’on se méfie : cela confirmerait que les rêveurs ont bien des pouvoirs, notamment, on peut rêver, celui de transformer le monde.
Photo : © Francesca Mantovani / Gallimard