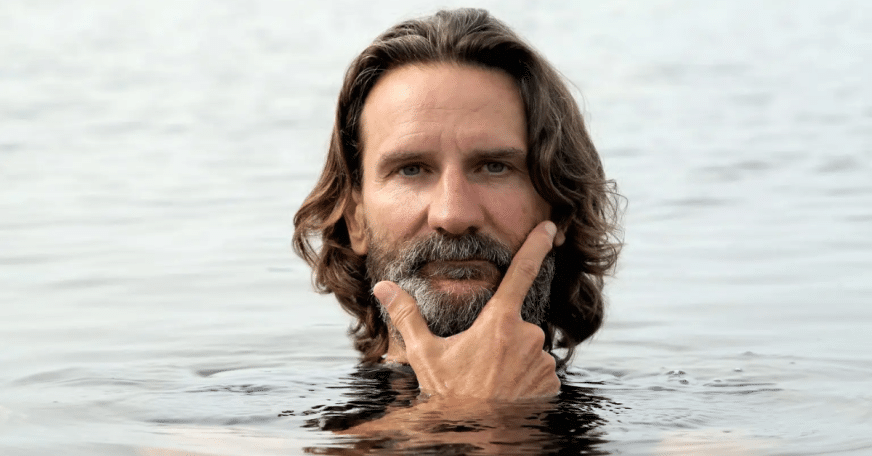En janvier 2017, vous affirmiez sur les ondes d’Arte essayer, dans vos livres, de «trouver une façon simple et forte de dire la relation que les gens entretiennent avec le paysage qui les entoure». Cinq ans plus tard, force est de constater que cette phrase résume à merveille Zizi Cabane. Qu’est-ce que ce livre vous a permis d’explorer dans ce dire l’humain et son milieu?
Votre question touche à l’essentiel de mon travail ces dernières années. Les paysages déployés dans Zizi Cabane sont ceux dans lesquels j’ai grandi, et l’histoire de Zizi/Odile se révèle finalement assez proche de la mienne (tout en étant très largement réinterprétée). Ce que j’ai donc fait tout au long de ce livre, c’est explorer le lien très fort qui existe entre histoire intime et paysages. Que devient mon histoire d’orpheline et de mère quand je la confie aux territoires de mon enfance et à ceux découverts plus tard? Une longue course-poursuite amoureuse et géologique, dans laquelle je ressens un immense soulagement à déposer tous types d’émotions au creux des paysages. Évidemment, au quotidien, cette attitude de mise à distance des émotions serait une discipline très difficile à tenir; mais dans l’écriture d’un roman, cela devient une expérience très plaisante, voire salutaire.
Impossible de passer à côté de l’animisme/onirisme qui se déploie dans vos livres. Née contente à Oraibi et De pierre et d’os approchaient justement cette relation avec les esprits, ancrés tous deux dans un contexte autochtone largement documenté. Cette dimension spirituelle s’est-elle imposée d’emblée au moment d’écrire Zizi Cabane?
Sans doute ne puis-je plus écrire sans cet arrière-plan spirituel et onirique, que j’ai rencontré/retrouvé chez les Hopis, les Inuit et d’autres peuples racines. Je dis «retrouvé», car mon élan vers ces cultures s’est fait à partir de mes propres inclinations au rêve, à l’interprétation « extrapersonnelle » des événements individuels, familiaux, collectifs. En gros, j’aime bien l’idée que nos destins puissent être mus par des puissances invisibles (ancêtres, animaux, végétaux, éléments) — ce qui n’est finalement rien d’autre que la conscience que les hommes ne sont ni seuls au monde, ni à part dans le cosmos.
Chez les peuples autochtones, une tradition ancienne guide les humains dans leurs rapports avec ces forces invisibles. Chez nous, une telle tradition n’existe pas — ou plus. Pour appliquer le même rapport au monde, je dois dès lors réinventer cet abandon. Dans Zizi Cabane, la mère disparue revient par le ruisseau qui traverse le jardin familial: en devenant d’abord la source jusqu’ici inconnue de ce minuscule cours d’eau, en se déployant ensuite dans la vallée, jusqu’au fleuve, jusqu’à la mer et aux profondeurs océaniques — tel un esprit de l’eau partout présent. Comme les humains ont la manie d’aller partout, il est facile pour ses enfants de la suivre dans ce déploiement — même s’ils ne comprennent pas tout de suite par quoi ils sont mus.
Je m’en voudrais d’oublier le souffle de vie qui traverse votre œuvre. La figure de la mère y est partout présente et tout spécialement pour la famille d’Odile. Quels sont les parallèles que vous dressez entre la maternité et la création littéraire?
Qu’il s’agisse d’un enfant ou d’un texte, leur survenue garde une irréductible part de mystère. Dans les deux cas, il faut accepter de se laisser traverser par ce qui vient aussi bien que par ce qui ne vient pas. À l’époque de De pierre et d’os, la maternité se refusait à moi. La découverte de la culture inuit, avec ses innombrables exemples d’extraparentalité (adoptions en tous genres notamment), m’a aidée à surmonter une certaine tristesse, un vertige même, et à imaginer d’autres liens. Dans Née contente à Oraibi, c’est la question du deuil dans l’enfance qui m’animait. Et Zizi Cabane, à son tour, explore cette éternelle question de l’absence/présence à soi, aux autres. Plus que la question de la maternité, je dirais que c’est celle des forces invisibles qui me taraudent : comment ce qu’on ne voit pas (un défunt, un enfant à venir) peut être l’aiguillon d’un éveil au monde. En quête de ce qui n’est pas ou plus sous leurs yeux, mes personnages se lancent à la découverte de nouveaux territoires et finissent par capter d’autres signes que ceux qu’ils cherchent. Là est leur vraie consolation.
À lire aussi
Le Tripode : Les surprises du réel
Photo : © Le Tripode
———————–
1. Au moment d’écrire ces lignes, un album jeunesse intitulé Le Roi de la lune et le robot zinzin est toujours à paraître aux éditions 2024, de même qu’Oraison bleue, un essai littéraire sur le deuil attendu aux éditions Musée des confluences/Cambourakis.