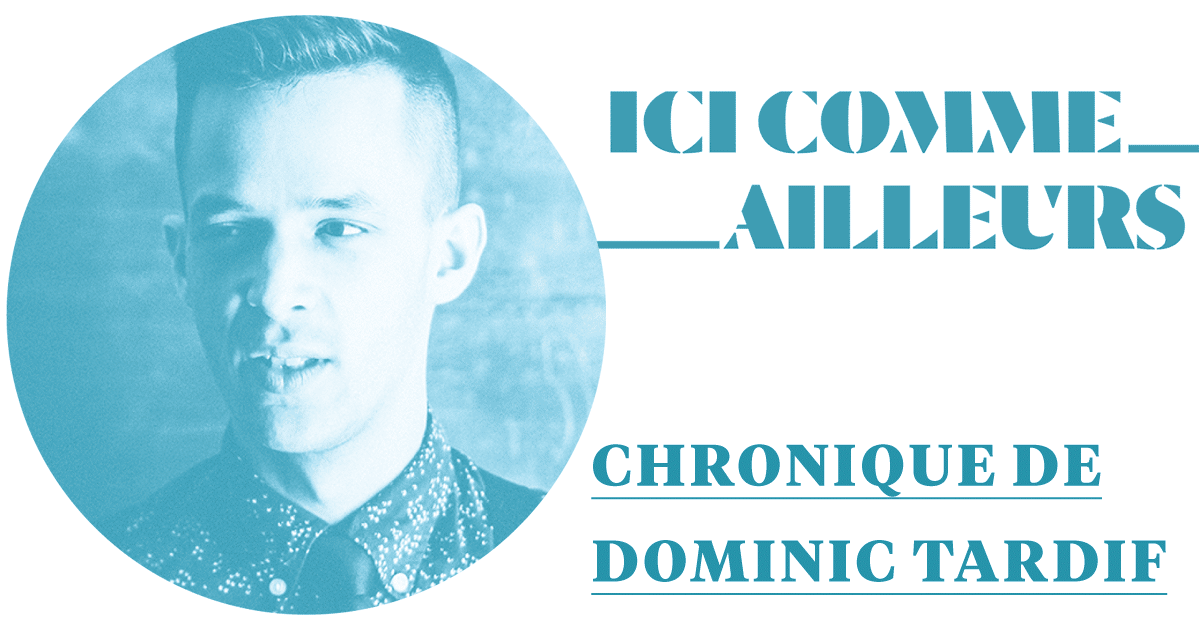Le vrai sujet des bons livres — j’entends par là ceux qui grandissent longtemps en nous — se situe souvent juste un peu sous leur surface. Je ne vous apprendrai rien si j’écris que Moby Dick n’est pas seulement une histoire de pêche ou, pour employer un exemple vaguement plus récent, que l’œuvre de Jean-Philippe Baril Guérard parle au moins autant de santé mentale que du milieu du droit, des startups ou de l’humour. J’aime quand les livres procèdent par détours et subterfuges, m’invitent à regarder là-bas, pour mieux continuer de construire ici un édifice dont l’architecture complète ne me sera révélée qu’en tombée de rideau, voire plus tard, lorsque les phrases, la poésie et les personnages auront bien sédimenté dans un coin de ma mémoire.
J’aime lorsque les livres font mine d’ignorer ce qu’ils souhaitent dire ou ceux qui, à mesure qu’ils se déploient, semblent découvrir des choses à propos d’eux-mêmes. Je les aime parce que c’est ainsi que se comportent les gens. Un ami te confie sa tristesse que son chanteur préféré soit mort et, soudainement, après plusieurs minutes, c’est l’évidence : ton ami te jase en fait de sa propre peur de la mort.
Avec sa trilogie 1984 (Hongrie-Hollywood Express, Mayonnaise, Pomme S), Éric Plamondon est passé maître dans l’art d’écrire des livres nourrissant une obsession presque monomaniaque pour un sujet en particulier (nommément les vies de Johnny Weissmuller, de Richard Brautigan et de Steve Jobs), tout en élaborant, comme en sous-main, un autre livre dans lequel un homme (son narrateur Gabriel Rivages) cherche à comprendre ce que cela signifie que de bien vivre, en se mesurant à des exemples (ou à des contre-exemples) extrêmes.
Dans Aller aux fraises, Éric Plamondon s’éloigne certes de ce modus operandi faussement documentaire, mais continue de raconter une chose pour mieux en raconter une autre entre les lignes, ou au détour d’un paragraphe. Si la nouvelle qui ouvre ce bref recueil de trois textes est indéniablement la chronique de l’entrée dans l’âge adulte d’un certain Plam, c’est lorsque le personnage du père fait son entrée que l’écrivain commence à révéler son jeu, à savoir qu’il espère autant consigner dans ce livre des bouts de sa relation avec son paternel que des bouts de son adolescence. Voilà une ruse d’écrivain digne de la finesse d’un magicien.
Éric Plamondon se remémore donc sa première blonde, son bal des finissants et ses brosses homériques, mais aussi, surtout, comment il a un jour compris que le calme légendaire de son père n’était pas un trait inné, plutôt une sorte de retranchement du cœur, aménagé à force de travail sur soi, par un homme dont la colère, lorsqu’elle se déclenchait, menaçait de tout emporter.
Puis il apparaît encore plus clair dès la deuxième nouvelle que ce livre est également l’occasion pour Éric Plamondon de célébrer le plus précieux héritage de son père, celui de son goût pour les anecdotes échevelées, celles-ci ayant toutes en commun de porter en creux une certaine foi en la vie — la vie qui finit toujours par placer un miracle sur le chemin de ceux qui s’y engagent pour vrai, pour peu que ceux-ci sachent infléchir un peu leur destin (quitte à étendre les cendres de leur ami sur une route glacée).
À l’instar de son père, qui n’était jamais aussi heureux que lorsqu’il racontait sa jeunesse à Saint-Basile, Éric Plamondon raconte la sienne, entre Donnacona et Thetford Mines, avec aux lèvres un sourire un peu mélancolique, l’air de se dire que tout ça — son accident de voiture, son trajet dans la tempête, sa rencontre avec un orignal blanc — aura valu la peine d’être vécu, ne serait-ce que parce qu’il a aujourd’hui la chance d’en faire une histoire.
Le pari de la vie
Le territoire sauvage de l’âme, premier roman de Jean-François Létourneau, n’avait au premier abord rien pour me charmer. Le gars allergique à la nature que je suis n’est généralement pas trop remué par les histoires de bois et de grands espaces. Ce livre m’a pourtant beaucoup ému parce qu’il pose lui aussi la grande question de la transmission. Chez Jean-François Létourneau, comme chez Éric Plamondon, le plaisir de raconter est un héritage paternel.
Professeur en sabbatique, Guillaume érige derrière chez lui une tente de prospecteur, sous laquelle il relatera pour ses enfants son ancienne vie d’enseignant à Kuujjuaq, chez les Inuit. Sa maison, sise pas loin de la ville, à l’ombre d’une prucheraie, s’apprête à être cernée par un de ces nouveaux pôles immobiliers de faux palaces tous identiques : « Les pruches et les cèdres seront remplacés par la charpente des bungalows, et ses enfants devront apprendre à tout perdre. »
C’est un monde qui s’envole en même temps que son père, un modèle pour son fils, le genre d’homme solide comme un chêne qui sera parvenu à corder lui-même son bois jusqu’à son dernier souffle, et pour qui il suffisait, pour être heureux, d’« aimer les choses telles qu’elles sont, sans vouloir les changer, sans vouloir se changer. Juste être là et rien demander de plus ».
Sous son apparente exaltation d’un certain passé, Jean-François Létourneau n’épargne pourtant aucun de ses personnages, surtout pas ce Guillaume indigné que l’on vienne lui arracher son petit morceau de forêt, alors qu’il a lui-même abattu une magnifique pruche afin d’apaiser ses assureurs et de pouvoir goûter à son petit bonheur. Et puis, à bien y penser, celui qui se rend enseigner chez les Inuit pendant quelques années et qui en repart le cœur rempli de sourires d’enfants, ne se comporte-t-il pas, d’une manière infiniment plus bienveillante mais néanmoins égoïste, comme le colonisateur extractiviste?
Le territoire sauvage de l’âme est un roman de résistance face à un monde de vitesse et de croissance économique à tout crin. C’est d’abord ce que Guillaume aspire à transmettre à ses enfants, ce courage d’emprunter d’autres chemins que l’autoroute. Mais Jean-François Létourneau, par le biais de son personnage principal, semble aussi vouloir rappeler que quiconque n’a jamais un jour été en contradiction avec lui-même n’a sans doute jamais réellement vécu. Guillaume dit à ses enfants qu’il faut, malgré ce risque, faire le pari de la vie.