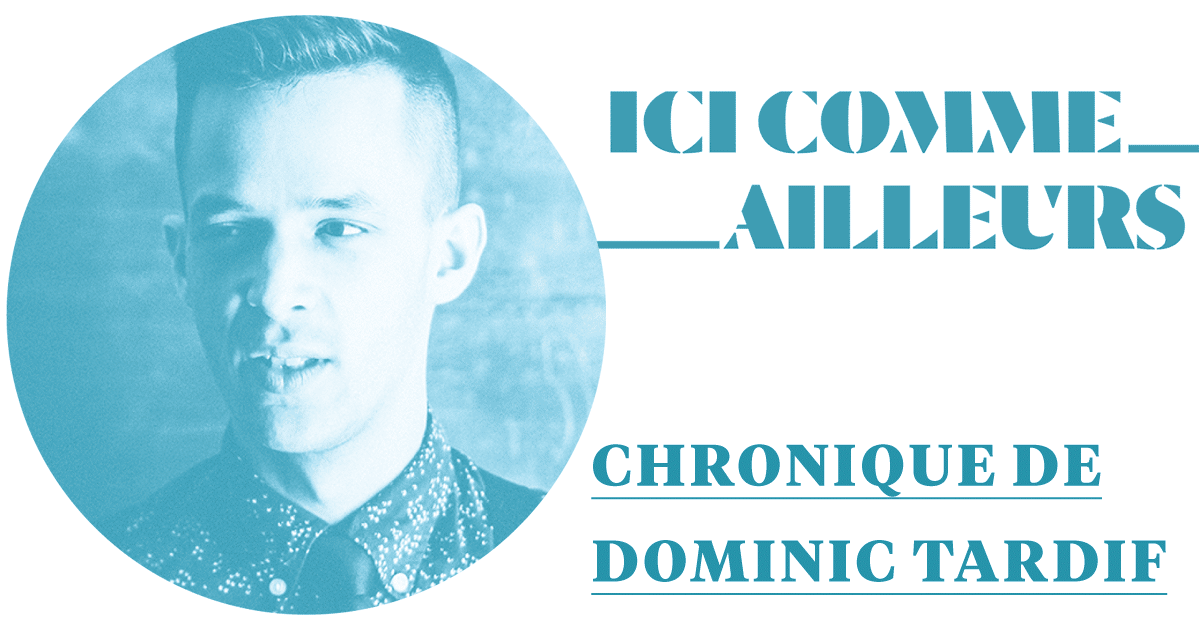J’aime les livres qui résistent à leur propre mise au monde, qui se méfient constamment de leur élan et de l’utilité de leur apport à la vie des idées. Aux livres qui se présentent en bombant le torse, fiers d’eux-mêmes et sûrs de l’ensorcellement qu’ils exerceront inévitablement, j’ai toujours préféré ceux qui arrivent dans la lumière sur la pointe des pieds, le regard fuyant, portant déjà en eux le regret d’avoir osé quitter l’obscurité, d’avoir cru qu’ils étaient dignes d’être lus.
Oui, bien sûr, tout livre existe grâce au soutien de quelqu’un d’autre (ne serait-ce que d’un éditeur ou d’une correctrice d’épreuves), mais j’aime tout particulièrement ces livres qui ne seraient demeurés qu’à l’état de manuscrits, n’eût été ce salutaire sauveteur, convaincu qu’il ne fallait pas que ces phrases meurent dans le silence d’un tiroir.
Colette Brossoit écrivait chaque jour quelques pages avant de se rendre superviser les activités de L’Express, ce bistro de la rue Saint-Denis vite devenu dès son ouverture en 1980 le chaleureux refuge de choix du milieu théâtral montréalais. « Si Nadine accepte, mais qu’elle se sente absolument libre de refuser, elle pourra lire ce que j’ai écrit et voir s’il y a lieu de choisir quelques extraits pour publication… » En quelques mots, celle qui avait toujours refusé de se risquer au grand dévoilement de la publication donnait la permission à son amie Nadine Marchand de tirer un livre des quelque 2 500 pages laissées derrière elle après sa mort, en mai 2014.
Ne regrette pas ce qui se dérobe, premier livre de Colette Broissot, paraissait il y a quelques mois dans une discrétion à l’image de l’écrivaine sans cesse animée par les remises en question — mais toujours tournée vers la vie — que révèlent ces « carnets ». Née à Beauharnois, la jeune Colette fuit l’asphyxie de son petit milieu pour étudier la littérature à Ottawa, puis le jeu à Montréal. Composé de fragments de souvenirs, de notes de lectures, de réflexions sur des spectacles et sur l’art de la restauration, ce livre posthume est d’abord et avant tout le journal du tiraillement d’une femme entre son appétit de vivre — ce « noir désir de flamber » — et sa vigilance presque maladive face aux miroitantes promesses de l’écriture et d’une existence qui l’avait trop tôt trop déçue.
Je la cite : « Vouloir écrire où il y a cri, où il y a rire, où il y a surtout le silence plus plein que n’importe quelle parole. Parole qui ne serait que la voie d’écoulement d’un silence ne pouvant plus se contenir, un mince filet canalisant son débordement, la valve d’échappement d’une cafetière espresso l’empêchant d’exploser et permettant au café de monter. Faire de mon impuissance à écrire ma force, l’objet même de mon écriture, est-ce folie, déréliction? Courage ou lâcheté? » J’ajouterai : mais que vaut vraiment l’écriture si elle ne doute pas minimalement de sa raison d’exister?
Un affront à la tristesse
J’écris cette chronique devant ma bibliothèque, dans laquelle la lecture du livre de Colette Brossoit me permet d’entrevoir la mémoire de tous mes voyages, petits ou grands, qui s’y trouve logée. Et je mesure soudainement mieux que jamais à quel point il ne me reste souvent d’un voyage qu’une odorante poignée de souvenirs de librairies et de restaurants visités.
Tout au bas, grosse tranche rouge : mon exemplaire des Collected Poems d’Allen Ginsberg, glané chez un bouquiniste archétypalement bordélique du Lower East Side, me remémore un plat de pâtes avalé dans la noirceur touffue d’une trattoria de Little Italy, durant un même séjour à New York. En haut à droite : La vengeance de la pelouse, des nouvelles de Richard Brautigan, livre de poche acheté dans une lumineuse librairie de Rouyn-Noranda pendant un Festival de la musique émergente, dont je me rappelle quelques spectacles, mais surtout ces sandwichs poulet-pesto rouge que je tente depuis de recréer dans ma cuisine. J’ai mangé de l’africain à quelques pas de la minuscule librairie de Belleville où j’ai dégotté ce curieux essai explorant la symbolique des lunettes noires. Je pourrais continuer pendant plusieurs paragraphes.
« Parfois, c’est vraiment comme si ce dont on avait besoin s’offrait et qu’il n’y avait qu’à le saisir », écrit Colette Brossoit qui, j’en ai l’impression, aurait bien compris cet étrange télescopage mnémonique entre lecture et nourriture dont ma caboche est le théâtre. « Après une journée laine minérale, je suis entrée à la librairie, j’ai fureté et déniché au hasard juste le livre qu’il me fallait, qui m’a remplie de joie au premier contact, en lisant la première page, avec le petit dessin simplissime de sa couverture. »
En fondant L’Express avec son compagnon Pierre Villeneuve, Colette Brossoit rêvait « d’un restaurant qui ne soit ni kitsch ni crado, je le voyais comme une place publique où tous se sentiraient à l’aise, les jeunes comme les vieux, les solitaires, les couples, les familles avec enfants et grands-parents, les Montréalais et les voyageurs de l’étranger ».
Bien que je n’aie jamais mangé à L’Express, ces mots ne pourraient mieux décrire ma conception du restaurant idéal, mais aussi de la librairie idéale. J’écris cette chronique alors que ne m’a jamais autant manqué ce plaisir consistant à perdre mon temps dans une librairie où je serais entré avec la confiance d’y découvrir ce prochain écrivain sans lequel je ne saurais désormais plus imaginer ma vie (les librairies auront peut-être rouvert leurs portes au moment où vous lirez ces lignes, mais l’idée d’y flâner sans crainte me semble à réenchanter). J’écris cette chronique alors que ne m’a jamais autant manqué le temps long d’une table au fond d’un restaurant, où la conversation entre amis se laisserait prendre au jeu des emballements et des confidences.
Il y a dans Ne regrette pas ce qui se dérobe comme un affront à la tristesse qui m’émeut d’autant plus que Colette Brossoit y raconte avec franchise au prix de quel effort elle a chaque jour tenté de tourner le dos au désespoir, en ayant le courage de vivre pour vrai, malgré la méfiance que la vie lui inspirait. Colette Brossoit semblait puiser ce courage au creux des livres et au hasard des discussions que son restaurant rendait possibles. J’écris cette chronique pour dire que j’aime les livres qui reconnaissent ce qu’ils doivent aux autres livres, et aux autres tout court, au point de parfois trop douter d’eux-mêmes.