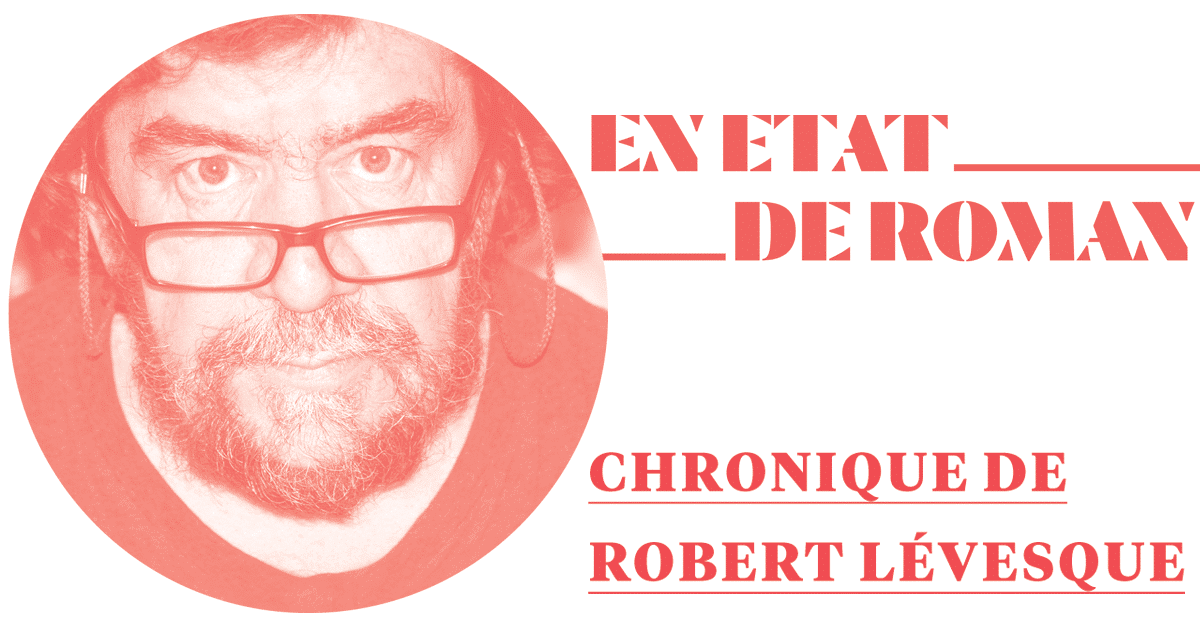À Ann Jefferson, une spécialiste américaine de son œuvredoublée d’une amiequi l’avait crânement avertie qu’elle lui en écrirait une après sa mort, Sarraute, lors d’un entretien accordé à Archives du XXe siècle, avait fait passer le message : « Je suis contente de savoir que je ne la lirai pas. Je suis sûre que tout sera faux ». Elle était du côté de Proust, celui de Contre Sainte-Beuve.
Vingt ans après sa mort, voici une biographie de Sarraute (la seconde, mais la première en 2003 ne valait pas tripette), une brique avec illustrations, la maison natale à Ivanovo dans la Russie tsariste, la petite Juive photographiée avec son père à 5 ans, à 23 ans en expédition avec des amis au mont Blanc, sa fausse carte d’identité de Nicole Sauvage (mêmes initiales) pendant la guerre 39-45, l’octogénaire portant une chemise Pierre Cardin en offrant son « visage buriné d’Indien, une noblesse de Sioux » comme la décrivit son amie Agnès Varda, etc.
Les connaisseurs de cette œuvre majeure de la littérature française du XXe siècle, les amateurs de celle qu’on a qualifiée de papesse du Nouveau Roman (alors qu’elle était antipapesse, refusant toute association, tout regroupement, aux Temps modernes elle détesta Beauvoir – qui le lui rendit en disant que Sarraute écrivait « comme un fer à repasser » –, elle aima l’œuvre de Beckett mais ne voulut rien savoir de lui, se méfiait de Robbe-Grillet), les admirateurs d’une démarche si rigoureuse dans l’aventure d’une écriture nouvelle, tous serons heureux d’apprendre, grâce au boulot d’Ann Jefferson, que Natalia Tcherniak, alias Nathalie Sarraute, a bel et bien eu une vie. Une telle femme qui sut garder distance, séparer le travail littéraire du métier de vivre, méritait une biographie puisqu’elle est un géant de la littérature à qui aura échappé le prix Nobel, qu’attrapèrent Beckett et Claude Simon à sa place.
Ann Jefferson avait pour elle l’amitié de Sarraute, carte maîtresse : étudiante, au début des années 1970, elle a le cran d’aller la rencontrer et la chance de se faire inviter chez elle, avenue Pierre 1er de Serbie, à compter de la fin des années 1980 elles se virent régulièrement, elle l’accompagna dans ses tournées de conférences et, en parallèle, travailla à une section des travaux pour l’édition de l’œuvre en Pléiade. Sa biographie est celle autant d’une spécialiste de l’œuvre que d’une familière de la femme, d’où sa qualité.
Si la vie de Sarraute fut du genre discrète et non engagée (seule pétition signée, celle du Manifeste des 121 pour l’insoumission dans la guerre d’Algérie, seule cause, le féminisme), c’est que, Jefferson nous le fait bien comprendre, tout se passa pour elle entre ses stylos et ses feuilles de papier, dans la détermination d’entrer en effraction, de défoncer les portes d’une littérature inconnue et qui serait bien à elle, ce qu’elle entama dès ses premiers textes écrits au milieu de ses 30 ans, refusés, mais la tardive travailleuse (qui avait fait des études en droit) se jura de ne jamais écrire comme les autres, d’explorer ce qu’elle appela des « tropismes », terme de biologie qui décrit les mouvements flous et flasques de la nature au bord de l’imperceptible et qu’elle osa traquer chez les humains, des humains débarrassés des enveloppes habituelles de ce que l’on appelle « personnages ».
Sarraute, autre cas de honte pour Gallimard. Comme Proust, comme Céline, on lui retourna sans explication son premier manuscrit (Denoël le publia en 1939 et Minuit en 1957) avant que, Sarraute reconnue par Sartre qui lui signa une préface, l’on fasse tout pour lui mettre le grappin et en faire un auteur Gallimard attaché à la maison, gloire éditoriale, célébrité internationale (en 1964, sa tournée américaine est triomphale), et aujourd’hui voilà, il y a quelques millions d’exemplaires vendus de ses livres : Martereau (où les personnages sont des taches inondées d’absence dans une histoire non organisée), Le planétarium (où une famille nous est révélée factice, monde de grattements, de pustules, de tentacules de pensées), Entre la vie et la mort (où un écrivain erre dans des étendues sans fin où il semble que personne n’est allé, cherchant quelque chose qui n’a pas de nom) et quelques autres titres (elle n’a pas été prolifique), et des textes de théâtre (Le silence, Pour un oui ou pour un non) à nuls autres pareils, un théâtre où le mot tient le rôle principal.
Nathalie Sarraute n’a jamais fait la cuisine ni le ménage, elle a eu trois filles d’un mari avocat lettré à qui elle a été fidèle tout du long, pas là de croustille biographique à croquer mais ce n’est pas ce que Jefferson recherchait. Par contre, on sait tout de sa pratique de l’écriture, sa routine, car personne n’a autant été discipliné. Tous les jours, durant trois ou quatre heures de l’avant-midi. Jamais chez elle. Sarraute avait son café libanais, avenue Marceau, où elle se rendait tous les jours de la semaine, dimanche compris, pour écrire à la même table du fond, ses feuilles volantes, ses stylos et son paquet de clopes sur la table en marbre, attentive – en état de roman – qu’à son flux d’écriture, inspirations, ratures, reprises, feuilles froissées, remplacées, recommencées, dans ce silence idéal qu’était le bruit d’un café arabe où elle ne pouvait saisir les conversations et se croire à l’étranger, dans un monde où l’araignée écrivant qu’elle était se sentait seule…
L’après-midi, après croûte et sieste, s’appelait lecture (les grands Russes, les grands Allemands et les grands Anglais lus dans leurs langues), Proust, le Gide de Paludes qui a été un déclic, et, chez ses contemporains, Blanchot, à qui elle a écrit : « Il me semble qu’écrire c’est jeter et jeter encore sa ligne pour ramener quelque chose qui glisse et se dérobe, et, lorsqu’on l’a hissé, quand c’est là, étalé au grand jour, cela meurt. Et on recommence ».
En mourant, digne veuve entourée de ses filles, elle a dit : « C’est fini ». Jefferson croit que ses derniers mots exprimaient autant l’angoisse que le soulagement. Il ne s’agissait plus d’écrire. C’était fini.