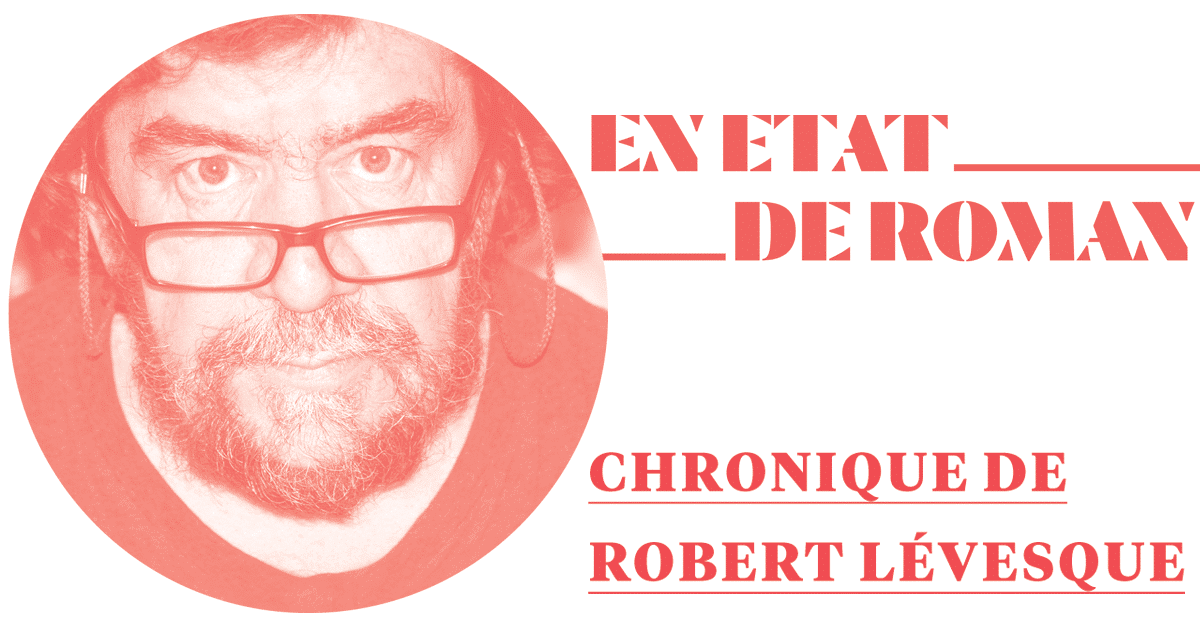Ce 27 septembre 1940, à la frontière entre la France (qu’il aime et qu’il doit fuir) et l’Espagne (d’où il veut gagner le Portugal et s’embarquer vers l’Amérique), Walter Benjamin est traqué, c’est un Juif, proustien et communiste, les sbires de Vichy et/ou de la Gestapo lui mettront tôt ou tard la main dessus et c’est ainsi que, refoulé par un alcade au poste-frontière de Portbou, il choisit, au risque de l’arrestation fatale et du convoi vers les camps nazis, un départ volontaire et définitif, avalant la dose de morphine qu’il gardait en réserve dans son sac où se trouvaient son manuscrit en cours et ce bouquin, les Maximes de La Rochefoucauld, dans lequel puiser une ultime dose d’énergie intellectuelle.
Un livre, Le chemin des Pyrénées, a raconté la fin de Benjamin en 1985 et obtenu le Grand Prix du livre politique allemand. Son auteure, Lisa Fittko, avait mis quarante ans à l’écrire. Aujourd’hui, à l’initiative du journaliste Edwy Plenel, ce livre reparaît sous le titre Le chemin Walter Benjamin. En préface, Plenel raconte que Benjamin avait dit à Stéphane Hessel durant l’été 1940 que le monde vivait le nadir de la démocratie. « Ce nadir est de retour, affirme Plenel, où que nous regardions, France incluse, nous voyons émerger, s’avancer ou s’imposer de nouveaux types de pouvoirs sous la forme de démocraties autoritaires. Ce ne sont plus les dictatures ou les totalitarismes d’antan. Leurs dirigeants ont la légitimité de l’élection, sauvant les apparences. Mais, sous leurs vernis, s’installe l’accoutumance à la régression des libertés et au déni des droits fondamentaux, tandis qu’augmentent les périls écologiques provoqués par une humanité trop confiante en sa puissance, au point d’oublier la nature qui la fait vivre ».
Lisa Fittko est celle qui a tenté de sauver la vie de Benjamin. En septembre 1940 elle a 20 ans, avec son copain Hans elle est en train de mettre sur pied un réseau clandestin pour organiser, depuis Banyuls, l’échappée en Espagne de Juifs fuyant le nazisme. Durant sept mois, le couple va réussir à gérer dans le plus grand secret cette échappatoire vers la liberté, trois fois par semaine, à raison de deux ou trois personnes à la fois. Ils ont ainsi aidé des centaines de réfugiés juifs, antifascistes, autrichiens, allemands, français, européens désespérés, à fuir l’Europe qu’Hitler tente d’envahir et d’assujettir. Or, Walter Benjamin, qui fut leur premier « client », ce 27 septembre 1940, sera le seul qui n’aura pas réussi à passer.
Je connaissais dans les grandes lignes (par l’entremise de différents témoignages) la triste fin de Walter Benjamin, son suicide à Portbou, son corps disparu, sa mort sans sépulture, le sac contenant un manuscrit jamais retrouvé. Mais la lecture du livre de Lisa Fittko, qui est la dernière personne à l’avoir vu vivant (elle est morte en 2005 à Chicago à l’âge de 95 ans) m’a bouleversé, elle y raconte ses dernières heures, son dernier jour, sa dernière nuit, son dernier matin. Il cogne à sa porte en fin d’après-midi le 26, elle décrit la politesse infinie de l’écrivain, « cérémonieux », sa grande fatigue mais sa détermination à prendre le risque de la fuite alors qu’elle lui dit ne pas être un guide expérimenté, qu’elle n’a pas encore effectué ce trajet de contrebandiers, qu’elle n’a qu’un bout de papier esquissant en gros l’itinéraire. Lui, il l’informe qu’il est cardiaque, qu’il ne pourra pas marcher vite, mais le plus grand risque pour lui serait de ne pas fuir.
Le soir venu, Lisa décide qu’ils feront le tiers du chemin en reconnaissance et reviendront dormir au village avant d’entreprendre le grand trajet à l’aube (à cinq heures, l’heure des travailleurs viticoles). Mais Benjamin, évoquant sa fatigue, décide de rester là, au tiers du chemin, de dormir dans la forêt. « Sa décision était ferme », écrit Fittko. Elle se rend compte qu’il a avec lui un sac qui semblait lourd. Quarante-cinq ans plus tard, en écrivant Le chemin des Pyrénées, Lisa Fittko se souvenait de la réponse que l’écrivain lui fit à propos de ce sac en cuir noir auquel il semblait si attaché : « Vous savez, cette serviette est mon bien le plus précieux. Pas question de la perdre. Ce manuscrit doit être sauvé. Il est plus important que ma propre personne. » Était-ce le travail en train de son fameux Paris, capitale du XIXe siècle, un ouvrage d’ampleur qui ne sera publié, inachevé, qu’en 1982?
Imaginons Walter Benjamin passant la nuit du 26 au 27 septembre 1940 seul, sans rien à manger, sans rien à boire sauf l’eau verdâtre d’une mare, épaisse de vase, puante. Le lendemain matin, Lisa Fittko, revenue, le retrouva là où elle l’avait laissé. Il avait « un sourire amical », se souvient-elle. Il y avait dix heures de marche avant d’atteindre la frontière espagnole. De plus en plus fatigué, il avait trouvé un truc pour tenir : il marchait dix minutes d’un pas lent et régulier, puis il s’arrêtait une minute, courte pause repos.
« Aujourd’hui que Benjamin est reconnu comme l’un des grands penseurs et critiques littéraires de ce siècle (écrivait Lisa Fittko à 65 ans en 1985), on me demande parfois : “Que vous a-t-il dit de son manuscrit? A-t-il divulgué quelque chose de son contenu? Y développait-il un nouveau système philosophique?”. Juste ciel! J’avais à mener mon petit monde au sommet des Pyrénées et ça me suffisait amplement. La philosophie pouvait attendre. L’enjeu était de sauver quelques êtres humains, de leur éviter de tomber aux mains des nazis. Et moi je me retrouvais avec sous ma houlette de passeur improvisé ce sacré phénomène, le vieux Benjamin, que rien n’avait pu convaincre de se séparer de son lest, cette sacoche en cuir noir. Bon gré mal gré, il me fallait traîner le “monstre” par-dessus la montagne. »
Rebaptisé Le chemin Walter Benjamin, ce livre, ce récit prenant, republié huit décennies après la mort de Benjamin, est d’une actualité manifeste. « Sa temporalité, écrit Plenel, n’est pas celle d’un passé révolu mais d’un passé plein d’à présent. »