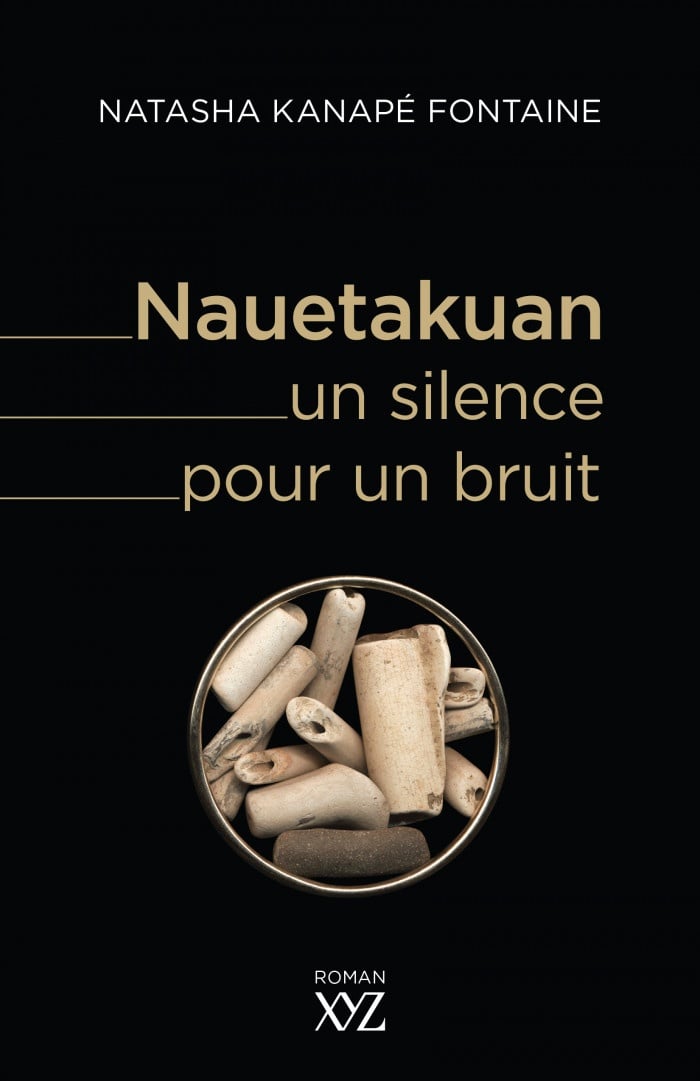La souffrance humaine et le suicide sont abordés de près et de loin dans ce roman puissant, avec une narration précise et sensible, sans détour, vraie. Une grande empathie se dégage des personnages qui veulent tant prendre soin les uns des autres, mais qui ont de la difficulté à s’y retrouver. Il y a des amours puissantes qui se détruisent par un mal difficile à cerner, celui qui nous détruit lentement, celui qui fait partie des maux insidieux qu’a engendrés le colonialisme chez les peuples autochtones. Les non-dits dans les relations amoureuses sont aussi explorés, ceux qui nous poussent vers des côtés sombres de nos êtres. C’est un livre sur la fragilité de la santé mentale, les liens qui nous unissent aux autres dans la vie et la pulsion de mort : « Ma mort ne me concerne pas moi, elle concerne tous ceux qui m’entourent. »
Niviaq Korneliussen aborde de front les tourments du mal-être par l’authenticité et la transparence de sa narratrice. On a accès à son fil de pensée profonde en même temps qu’à son fil d’actualité sur son téléphone, où on ne peut voir qu’une certaine partie des gens, où se génèrent des angoisses et où on apprend les suicides, en plus d’avoir accès aux commentaires sous les publications des mères endeuillées.
Ici, le suicide n’est pas un sujet à esquiver. C’est ce que la narratrice souligne en gras par les titres marquants de chaque chapitre. Elle trouve insupportable que les gens autour d’elle mentent au sujet des morts volontaires et les fassent passer pour des accidents. Pour elle, nier le suicide c’est nier la souffrance. Elle met donc à jour les dynamiques qui causent plusieurs formes d’affliction depuis la colonie danoise. Elle arrive à se comprendre en remarquant que la nuit polaire endort les souffrances et le soleil de minuit les montre à découvert. Il se crée un cercle systématique entre la lumière et l’obscurité, le fait de montrer ou de cacher. C’est tout là que réside le génie sensible de l’écriture de Korneliussen, qui combine les forces naturelles qui nous gouvernent et qui se recréent en nous : « Dans le noir, ta beauté est plus absente, mon corps moins exposé, nos cicatrices moins visibles […]. Sous le soleil de minuit, tu es trop belle, et je ne pourrais pas m’en empêcher, je peux aussi bien être honnête et te dire que tu serais ma mort et que je t’entraînerais avec moi au fond. » C’est un roman sur la souffrance mais surtout, sur l’amour qui à la fois nous fait du bien, nous blesse, nous détruit.
I need you like water in my lungs, lit la narratrice sur le mur des toilettes. Je frissonne. La phrase vient terminer une boucle intense créée autour des recherches qu’elle fait sur Internet et qui lui disent que les glaciers fondent autour du Groenland. Elle fournit des données statistiques de la NASA et les utilise pour expliquer son comportement et son senti : « Je suis comme la glace, je ne peux pas rester immobile. Je tombe et je tombe, j’entraîne tout avec moi. » Elle voit bien que ses états intérieurs sont le reflet de ce qui arrive aussi dans le monde.
Le récit, ultracontemporain, nous sort de l’horizon d’attente que l’on voit trop en littérature autochtone. J’ai l’impression que souvent les lecteurs s’attendent à un certain rapport à la nature, à des connaissances millénaires des ancêtres. Korneliussen montre qu’être inuk du Groenland va au-delà du rapport au passé et à la culture ancestrale : « Es-tu une fille de la nature? Trouves-tu que l’art doit inclure des motifs groenlandais pour pouvoir être appelé de l’authentique art groenlandais? », demande Nava.
Ne pas tomber dans les clichés, écrire pour montrer ce qui se passe actuellement chez les Groenlandais, sans fard, résister en affrontant le présent : un tour de force de sensibilité.
Je garde une petite place pour écrire sur Nauetakuan, un silence pour un bruit, marquée par l’évidence que j’aurais tellement aimé le lire quand j’étais adolescente! Je sais que je n’étais pas la seule dans ma communauté à me chercher, à vouloir des réponses sur mon identité et à savoir pourquoi le mal-être colonial régnait dans plusieurs sphères de ma vie. Dans Nauetakuan, on suit l’amitié nouvelle des personnages de Monica et Katherine, qui se rencontrent devant une performance filmée de l’artiste Rebecca Belmore et qui en ressortent ébranlées. C’est à partir de là que Monica, avec l’aide de Katherine, effectue un retour vers son enfance et ses histoires de famille en faisant une sorte de pèlerinage à Pessamit, sa communauté d’origine. Elle voyage et rencontre aussi des autochtones d’ailleurs au pays et dans le monde. Elle découvre que pour apprendre à s’aimer et à se guérir des cercles maudits créés dans sa lignée maternelle par les pensionnats, elle a un long chemin d’acceptation envers elle-même à faire. La rencontre avec plusieurs alliés l’accompagne dans sa recherche. George, un aîné rencontré sur la plage du village, lui enseigne une autre façon de voir ses instincts et de recommencer à vivre au rythme de sa communauté : « Quand tu vas sentir que c’est le temps, tu vas revenir, pis moi, j’vas t’attendre. » Elle apprend aussi, par ses voyages, à accepter qu’elle est sur le chemin d’une réappropriation et qu’elle peut se laisser aller dans les découvertes vers le meilleur d’elle-même, sans se sentir illégitime : « Monica, prenant graduellement conscience de la solennité du moment, se sent un peu déboussolée, craint de ne pas mériter sa place ici. Puis un déclic se fait dans son esprit : on l’a invitée, elle est la bienvenue, il lui suffit de profiter tout bonnement du moment qui s’offre à elle, entourée qu’elle est de femmes autochtones de tous les âges. »
C’est un roman moitié urbain, moitié road trip dans les Amériques et sur la Côte-Nord, où sont montrés les liens qui unissent les membres de différentes nations quand ils se retrouvent en ville, et comment le rire et le partage et la solidarité peuvent nouer des liens solides peu importe le lieu. Monica a également pour allié Nanimissu-Metshu, l’oiseau-tonnerre. Il agit comme un guide qui l’aide à persévérer et à se réapproprier son identité. Il apparaît comme être symbolique tout au long du roman.
Ces deux romans de quête identitaire touchent à des enjeux primordiaux pour les Premiers Peuples. Ils participent à la continuation de la résurgence, et à l’actualisation autochtone dans la modernité. Se libérer, être en mouvement, être libre d’être soi et de guérir, avec l’aide des générations d’avant et d’après mais surtout en transmettant les histoires du présent.