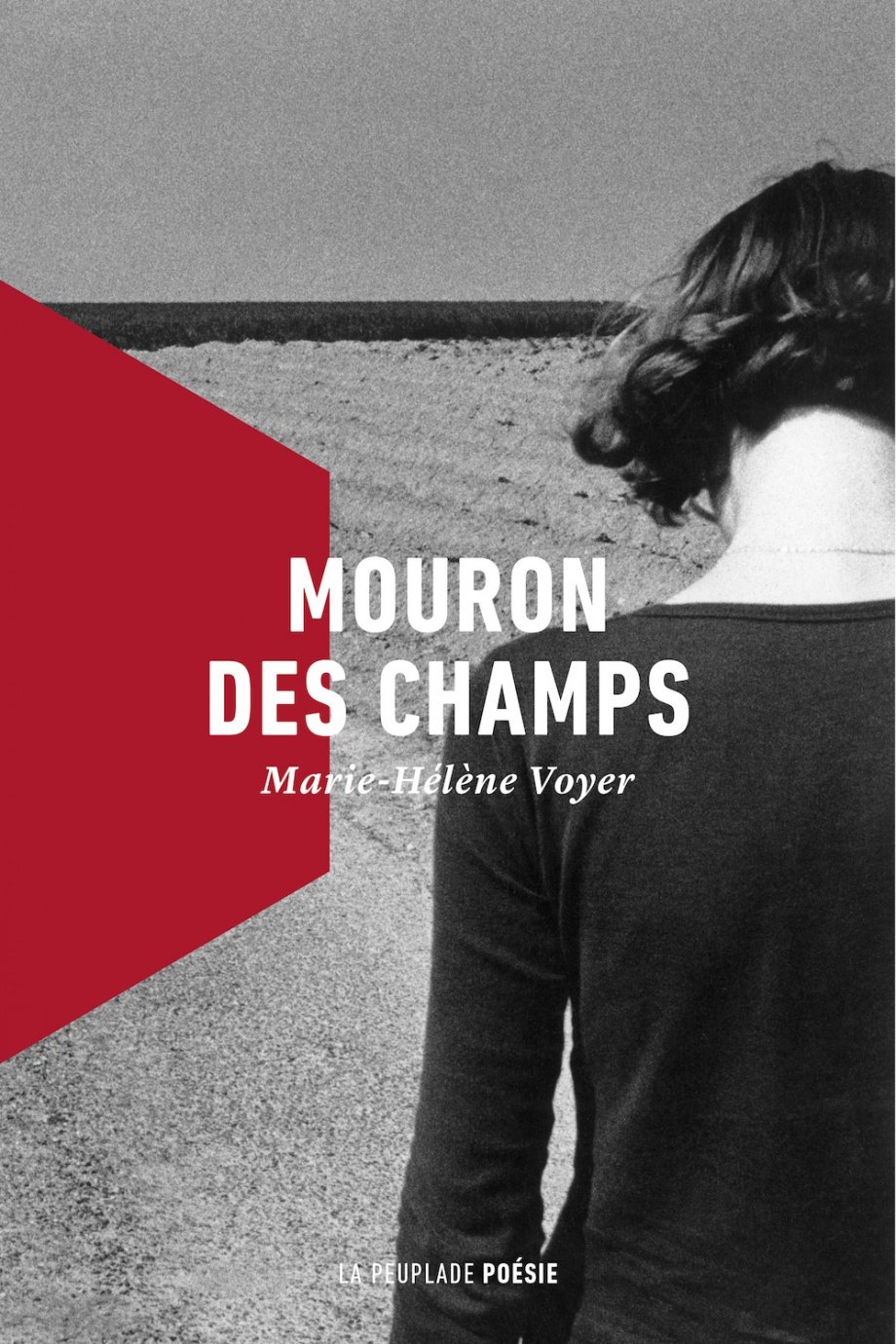J’arrive ici, comme sur un sentier déjà visité, tapissé depuis des années par Dominic Tardif, et avant par Stanley Péan. Le vertige de suivre Tardif, que j’ai tant aimé lire, cette voix forte, distinctive, le style qui s’emmaille avec le propos toujours pertinent, les chemins inattendus, surprises et bouffées d’air frais. Au cours des dernières années, sa chronique aura orienté la lumière, doucement, vers l’autre. C’est ce que je tenterai de poursuivre ici, préserver la flamme des grands vents qui nous étourdissent parfois.
C’est avec la poète Marie-Hélène Voyer, qui signe ce printemps un puissant successeur à cet Expo habitat qui m’habite encore trois ans après sa lecture, que je commence cette aventure. Voyer est une passeuse qui se nourrit des ruines et de l’ordinaire de nos vies, ombres et lumières d’un monde pas si lointain. Avec son recueil Mouron des champs, elle fait entendre l’écho de voix oubliées, éclaire « ses mortes », les « vlimeuses » et autres « petites gueuses ». Voyer mêle sa voix à ces femmes d’un passé trouble, on tangue au gré de leur entêtement, leurs désirs retenus, leur fatigue accumulée, leur quotidien pesant, le temps qui s’étire et les lendemains impossibles à rêver. Elle scrute les liens qui se construisent et se déconstruisent de mère en fille, de femme en femme. Voyer calque leurs mouvements, emprunte leur reflet, porte leur voix. Et parmi ces femmes, sa mère, figure vaporeuse, tourmentée, disparue alors qu’elle était encore jeune. La poète ose avec brio regarder les fantômes qui la hantent et livre une proposition convaincante dans laquelle on se laisse happer par ce travail de cueilleuse de mémoire. « Il faut s’échapper », écrit la poète, comme pour libérer toutes les femmes, pour se libérer elle-même, préserver la mémoire, mais s’échapper malgré tout, mettre le feu. Mouron des champs est une plante sauvage qu’il faudra cueillir pour se rappeler que l’écriture et la lecture peuvent souvent être un refuge.
Ce refuge, les poètes Louise Dupré et Ouanessa Younsi l’habitent aussi, comme le démontre Nous ne sommes pas des fées, ce magnifique dialogue poétique où l’amitié se révèle comme un puissant moteur de création. Cet échange rebondit de l’une à l’autre, les pages de gauche avec Louise Dupré, les pages de droite avec Ouanessa Younsi, puis ces envols à quatre mains en entrée et en fermeture du recueil, points d’union qui témoignent de la richesse de cette relation tissée au fil des mois. Ensemble, elles plongent dans les souvenirs brûlants de l’enfance, leurs blessures, petites et grandes douleurs, et les bonheurs, aussi fragiles et suspects soient-ils. Dupré et Younsi mêlent leur voix, deux générations en résonance, et scandent haut et fort que l’amitié et l’écriture peuvent devenir un territoire de guérison. De l’enfance, on glisse vers la maternité et la mère, « jardin, éden, prison, enfer dont on ne s’évadera qu’au moment de baisser à jamais les paupières », dit Dupré, et à la mort qui finit par prendre toute la place. Lentement, les deux écrivaines tissent une histoire commune, leurs mots comme autant de respirations libérées. Un regard partagé sur ce qui nous compose, chacune, chacun, et qui nous permet de mieux jongler avec la vie, avec la mort. Il y a des sentiers qu’on ne traverserait pas si quelqu’un d’autre ne nous tenait pas la main — Dupré et Younsi, main dans la main. « Je t’écris pour me souvenir, et pour oublier », écrit Ouanessa Younsi, écho troublant à ce « il faut s’échapper » de Marie-Hélène Voyer, quitter, bifurquer, mais garder trace.
C’est aussi dans cette collecte de traces que nous amène Catherine Voyer-Léger. Depuis son premier ouvrage, Détails et dédales, Voyer-Léger raconte/se raconte, observe/s’observe, décortique/se décortique. Nouées continue dans cette veine, en défilant trois récits inspirés de moments marquants de son existence. Le premier texte raconte son aventure dans les dédales du processus d’adoption d’une fillette placée sous la protection de la DPJ. Elle dissèque toutes les étapes de ce parcours plein d’écueils, d’incertitudes, de lenteurs, de cafouillages. L’autrice se braque devant un système vicié, inéquitable, mais qui en même temps lui a offert ce qu’elle a de plus précieux. Les deux autres récits offrent un retour en arrière, dans l’enfance de l’autrice, puis dans le début de sa vie d’adulte. L’ensemble révèle surtout une trame de culpabilité obsédante, le doute comme solution, le mal de vivre parfois, les questionnements lancinants qui prennent toute la place, nuit et jour, jour et nuit. La culpabilité transmise de mère en fille, et pourtant cette lutte vive pour s’en libérer, pour accepter que malgré tout ce qu’un parent peut donner à ses enfants, il se peut qu’ils « tombent, se blessent, se brisent ». Ce que j’aime de Voyer-Léger, c’est l’intelligence vive, la capacité à se frotter à soi et aux autres, la force de créer des liens entre les idées qui se bousculent.
Dans ces trois ouvrages, on côtoie donc au plus près les obsédantes relations mère-fille, thème également bien présent dans plusieurs parutions du printemps — Cicatrices de Sara Danièle Michaud, Le fil du vivant d’Elsa Pépin ou encore Les acrobaties domestiques de Geneviève Drolet. « Il est long le travail de vivre hors de nos mères », écrit Marie-Hélène Voyer, alors que Louise Dupré hoche de la tête en insistant qu’« on n’en a jamais fini avec sa mère ». Au-delà de ce lignage complexe, je retiens ceci de ces trois livres : la nécessité de tendre la main, d’en attraper d’autres, d’accepter d’en abandonner certaines, se souvenir et oublier, poursuivre et fuir. C’est sur ce sentier que je vous laisse, car un autre chemin m’attend, Les ombres blanches de Dominique Fortier, qui marche, elle aussi, sur les pas de ses fantômes.
Photo : © Louise Leblanc