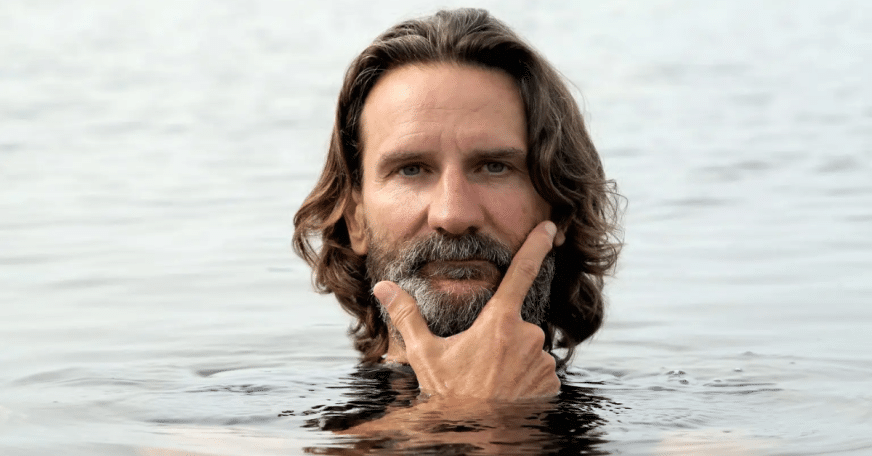« Ce n’est pas grand-chose, mais ne rien faire n’était pas un choix. »Cette phrase récoltée dans Du pain et du jasmin, le dernier roman de l’Ottavienne Monia Mazigh, pourrait très bien servir de credo à son auteure. Ses personnages, des citoyens « ordinaires », ont tous dû un jour ou l’autre affirmer leur engagement. Au fil de notre lecture, c’est au cœur de la rébellion que nous sommes attendus.
Impossible de parler de Monia Mazigh sans aborder les thèmes de justice et d’égalité. Originaire de Tunisie, elle arrive au Canada en 1991. Elle est une fervente militante des droits de la personne, elle mènera d’ailleurs un grand combat en 2002-2003 afin de faire libérer son mari, Maher Arar, accusé à tort de terrorisme et envoyé en prison en Syrie où il subira sévices et torture. Titulaire d’un doctorat en finances de l’Université McGill, elle s’est également impliquée en politique puisqu’elle a été candidate pour le Nouveau Parti démocratique en 2004. Puis, par la bouche du roman, elle continue de croiser le fer.
En utilisant les armes du roman, l’angle de visée et la force du tir sont beaucoup plus grands. Paradoxalement, la fiction permettrait d’appréhender la réalité mieux qu’elle-même ne saurait le faire. « La réalité est beaucoup plus restrictive, il n’y a pas vraiment le droit à l’erreur. Alors que nos vies sont vraiment pleines de fautes et d’erreurs », précise l’écrivaine. Avec le roman, nul besoin d’exactitude ou de preuves à l’appui, il peut soutenir à lui seul la cause de tout un peuple, porté par le pouvoir embrasé du verbe.
Le troisième livre de Monia Mazigh se passe en Tunisie, mais aurait très bien pu se situer n’importe où ailleurs. L’aspiration de ses personnages réside surtout dans leur soif de liberté, recherche insatiable de l’espèce homo sapiens qui définit sa trajectoire par son incessante quête de sens. Dans le roman, deux voix narratives s’interpellent à des époques différentes : celle de Nadia et celle de Lila, sa fille. La première concerne l’émeute du pain de 1984 et l’autre la révolution du jasmin en 2010. Elles agissent comme une sorte de miroir, l’une reflétant les idéaux de l’autre, et on imagine ainsi de génération en génération l’engendrement de multiples prismes réfléchissants qui formeraient l’image parfaite d’une humanité solidaire en marche vers une cause commune. Mais pour construire l’idéal, il faut d’abord une part d’indocilité. Après avoir dénoncé ouvertement le comportement arriviste d’une camarade et l’hypocrisie de son professeur, Nadia refuse de prononcer des excuses et est mise à la porte de l’école. Elle décidera également de faire fi du désaccord de ses parents en quittant sa patrie pour suivre son petit ami au Canada où elle pourra poursuivre son instruction. « Nadia est une fille qui a désobéi, mais selon d’autres regards, elle s’est juste libérée », explique Mazigh. Pour aiguiser son jugement et ses perceptions, l’insurrection doit d’abord être intérieure. Car les révolutions s’opèrent grâce à la force de chaque individu qui les soutient.
Des héros ordinaires
Les protagonistes dans le roman de Mazigh ne sont pas des figures de proue éclatantes. Ils sont issus de toutes les couches de la société, vont à l’école, vivent en famille. En fait, rien ne les distingue de tout un chacun. Mais lentement, par l’observation de ce qui se passe autour, des questions commencent à poindre dans leur esprit. Avec les premiers éclats qui se manifestent dans la ville, Nadia doute, relativise les prédicats, puis ajuste le foyer de sa lentille. Le soulèvement qui a lieu dans la ville ouvre les yeux de l’étudiante sur les inégalités des chances et des richesses. Maintenant qu’elles ont été éperonnées, les pensées de Nadia ne pourront plus faire marche arrière. Même si la dénonciation des mesquineries lui enlèvera le droit de passer ses examens. « Elle a commis aussi des erreurs, mais c’était de bonnes erreurs, parce que ça lui a permis d’éviter de tomber dans le moule qui s’apprêtait à la prendre », justifie Monia Mazigh.
Le devoir de conscience et d’introspection concerne autant le personnage de Mounir qui était des premiers à être sortis sur la place publique que celui de Neila qui préfère que l’eau ne soit pas brouillée par crainte que tout n’empire. « Oui, c’est dur, il y a des régimes plus difficiles, plus oppressifs que d’autres, donc on ne peut pas parler ou s’exprimer facilement, mais aussi, c’est le travail interne, c’est comment défier le pouvoir, aussi bien le pouvoir culturel et celui des traditions, que celui de la société et de la folie des gouvernements sur nos citoyens. Si on n’est pas préparé, si on ne travaille pas sur notre intérieur, sur nos capacités mentales pour défier ça, on ne pourra jamais le faire. »
Sortir de la peur
S’extraire de la peur est probablement la chose la plus difficile à faire. Mais selon Monia Mazigh, chacun de nous possède les ressources pour y parvenir. « C’est facile de dire que c’est à cause des autres, tous les gens vont dire “écoute, j’aimerais bien parler, j’aimerais bien sortir de cette oppression, mais je ne peux pas, j’ai peur, j’ai peur pour mon emploi, j’ai peur pour ma famille”, mais ça, c’est facile parce que tout le monde le dit. » Jusqu’au moment où le courage prend le dessus sur la peur. Nous est alors révélée « cette capacité de savoir à quel moment on peut dire “je n’accepte pas”, “je vais partir”, “je n’accepte plus de vivre dans la peur” ».
Le cran nous arrive petit à petit, en exerçant sa lucidité, en forgeant son esprit à la source des livres, en prenant conscience que s’ouvrir aux autres, c’est aussi faire un pas vers soi. « C’est toute cette idée de l’individualisme qui nous a été soufflée par un système. Certaines personnes disent “je ne fais pas de mal à quiconque, je fais juste ma petite vie et c’est tout”. Ce n’est pas vrai. Quand on ne parle pas, on participe. » Ainsi, malgré l’emprisonnement de Mounir et, vingt-cinq ans plus tard, l’arrestation de Jamel, les voix continuent de s’élever pour que cesse l’injustice. Sans ces appuis, l’aveuglement des citoyens et l’indifférence du gouvernement de Bourguiba, puis celui de Ben Ali, seraient restés entiers. Car ne tombons pas dans le déni; se taire, c’est aussi une forme de consentement. Comment faire en sorte que chacun se sente concerné par le bien de son prochain? Comment enseigner et transmettre le fait que le bonheur d’autrui participe au nôtre? « Se poser les bonnes questions, c’est déjà le début d’une réponse, affirme Mazigh. Est-ce que la société dans laquelle je vis est vraiment sur la bonne voie ou est-ce qu’on a tout mal foutu et que j’aimerais mieux en sortir et faire ma vie autrement? »
Surtout, Monia Mazigh croit beaucoup à l’importance des rêves. « On étouffe beaucoup nos rêves, clame-t-elle. Pour faire plaisir à nos parents, pour faire plaisir à la société, à un ami, à un mari, pour l’argent, pour un poste. » Mais elle est convaincue – c’est d’ailleurs ce qui lui permet d’espérer – que chaque personne a en elle-même un pouvoir d’évolution. Nadia a pu partir et terminer ses études, Lila a pu participer à dénoncer l’injustice. « Nous vivons dans un monde qui sous-estime beaucoup les petites actions. Il y a ce culte de la célébrité, de tout ce qui est lumineux, mais parfois sourire à quelqu’un qu’on ne connaît pas dans la rue, c’est tout simple, lire un livre, c’est tout simple. »
Tout part de soi, donc. À commencer par le changement.