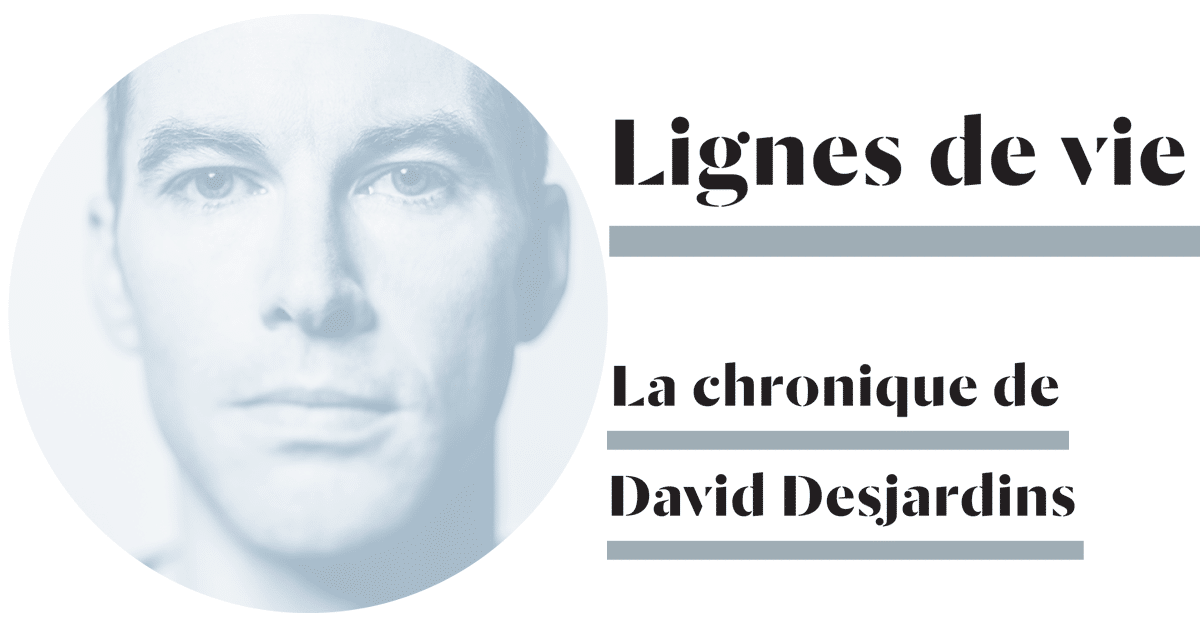La fin du monde est-elle un cauchemar ou un fantasme?
De La route à Station Eleven, en passant par tous les « Walking Dead » imaginables, si la littérature (comme la télé et le cinéma) paraît obsédée par l’apocalypse, c’est évidemment parce que nous le sommes. Y compris les ados. Ma fille consomme une ahurissante quantité de bouquins qui ont pour théâtre le déclin brutal de la civilisation. Silo, La cinquième vague, Le labyrinthe, Hunger Games…
Notre fascination pour un monde dépourvu d’organisation et de technologie doit bien vouloir dire quelque chose… Peut-être que notre dépendance à la technologie nous terrorise?
Le premier tome de la nouvelle série « Bug » d’Enki Bilal va exactement en ce sens. Dans un futur pas si lointain, les données de tous les serveurs informatiques s’évanouissent et laissent le monde en plan. Nos quotidiens sont à ce point devenus dépendants des machines que le monde s’arrête sec. Les avions tombent du ciel, l’économie s’effondre, des implants connectés cessent de fonctionner et condamnent à mort ceux qui les portent, les communications se délitent. Et voilà l’humanité devant réapprendre jusqu’à ses bases : sans correcteur automatique, les gens ne savent plus écrire et publient des journaux sur papier bourrés de fautes.
Si on reconnaît là le pessimisme du bédéiste, « Bug » constitue un énième écho aux préoccupations bien réelles d’un monde où l’on se questionne sur la véritable nature de l’humanité et sur les dérives de la civilisation.
Celles et ceux de mon âge ont passé une enfance biberonnée à l’apocalypse nucléaire comme à la dérive des machines et de l’intelligence artificielle. La culture populaire est obsédée depuis un moment par le sujet (2001, War Games, Terminator…). Notre imaginaire a été colonisé par l’idée d’un monde où la machine créée par l’homme met celui-ci à genou, ou le renvoie à l’âge de pierre. À 12 ans, mon livre de chevet était Le guide de survie de l’armée américaine. Je possédais un couteau comme celui de Rambo. Si le magazine survivaliste Prepper avait existé, j’aurais été abonné. L’Internet domestique n’existait pas, mais j’aurais pu démonter un fusil d’assaut M-16 sans n’en avoir jamais touché un.
Or, si la fin du monde tarde à survenir – et que je me suis heureusement trouvé d’autres passe-temps! –, nos errances technologiques se multiplient jusqu’à donner le sentiment que l’avenir est bel et bien advenu. Le futur est maintenant. Les intelligences artificielles parlantes sont entrées dans nos maisons (et en profitent pour nous espionner). Des algorithmes décident à notre place de ce que nous écoutons, lisons, mangeons et de notre cercle d’amis. L’agrégation de métadonnées permet de mieux nous connaître que notre psy. L’Arabie saoudite a récemment accordé la citoyenneté à un robot tandis que l’on s’inquiète des effets sur la sexualité de l’émergence d’un marché d’automates prostitués.
J. G. Ballard nous avait prévenus. Houellebecq aussi. Nous glissons rapidement et très sûrement vers ce monde qu’imagine Marie Darrieussecq dans Notre vie dans les forêts : sans doute ce que j’ai lu de plus efficace dans le genre « récit d’anticipation » depuis longtemps.
Il s’en dégage une intelligence remarquable, une manière d’entrevoir l’avenir avec cette lucidité qui danse si habilement sur ce mince fil qui la suspend au-dessus du catastrophisme qu’on ne peut qu’applaudir. Je ne peux en parler plus sans trahir les révélations qu’elle livre au compte-gouttes dans ce récit où l’on comprend rapidement que la narratrice a fui la ville pour s’installer avec quelques rebelles dans les bois. Mais je peux dire que, l’air de rien, Darrieussecq explore avec brio les conséquences d’une société qui laisse les technologies envahir toutes les sphères de la vie et s’insinuer jusque dans nos corps. Des outils de liberté devenus outils de contrôle.
Les romans d’apocalypse sont donc aussi, comme je le disais, des récits qui trahissent une sorte de fantasme.
Car nous sommes englués dans de mortifères habitudes numériques. Nous nous demandons comment décoller nos enfants de leurs écrans. Le contact social a fait place aux réseaux sociaux. Les jeunes adultes sortent de moins en moins. Le monde extérieur étant extraordinairement policé, celui en ligne est d’une violence inouïe. Une barbarie ordinaire, pratiquée avec le détachement que permet la déshumanisation par le codage et la pixellisation des individus.
Nous rêvons secrètement d’y échapper. De retourner à un monde qui ressemblerait à celui de Henry David Thoreau ou du « Unabomber » Ted Kaczynski. Une vie en dehors de la machine. Hors des obligations, des dettes, des vibrations fantômes d’un téléphone qu’on sent bouger dans notre poche même quand il ne le fait pas, tellement nous sommes conditionnés à être sollicités par l’incessant flux d’information qu’il déverse dans nos consciences sursaturées.
Nous rêvons de jardins, de villages amish, de faire notre pain et de cultiver nos patates. Notre confort nous rend misérables à force de transformer toutes les ailes que nous imaginons en boulets qui nous tiennent au sol, à force de conformisme.
Le retour à l’état de nature des récits post-cataclysmiques est une fable qui dit la véritable nature des humains : cruels, prêts à tout pour survivre. Mais aussi généreux, désireux de trouver la paix et de vivre ensemble en harmonie. Et l’éternel conflit qui existe entre les deux.
Mais ce que ces histoires expriment, avant tout, c’est qu’il faudra que survienne l’inévitable pour que cesse notre fuite en avant. Nous ne pouvons réellement envisager nos vies autrement que ce qu’elles sont. La moindre entorse à celles-ci soulève les passions, qu’il s’agisse d’investir dans le transport en commun, d’obliger à composter ou de bloquer un accès aux voitures sur le mont Royal, chaque petite modification de nos habitudes est subie comme une attaque à ce que nous sommes, à ce quotidien qui façonne notre identité.
La fin du monde nous obligerait à tout recommencer. Le truc, c’est qu’à lire tout ce beau monde, je ne suis pas certain que nous aurions appris quoi que ce soit de nos erreurs.