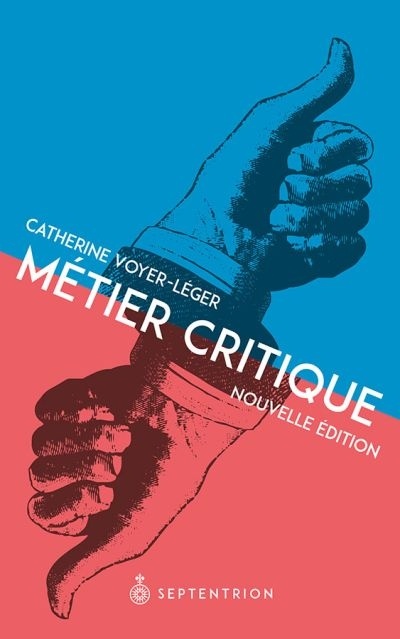Depuis plus de trente ans, de déménagement en déménagement, je traîne partout une boîte de livres pour la jeunesse que je garde pour le jour où j’aurais un enfant à qui transmettre mon héritage des années 1980 et 1990. Cette bibliothèque personnelle compte entre autres les vingt premiers ouvrages parus dans la fameuse collection « Roman + » de la courte échelle lancée en 1989 et conçue pour les adolescents. Ces livres, je les ai lus bien plus jeune que l’âge cible, comme tant d’autres bonnes lectrices (le féminin l’emporte ici, mais se veut tout à fait inclusif) du début des années 1990. On peut dire que c’est en grande partie aux « Romans + » que je dois mon imaginaire adolescent.
Récemment, en réaménageant la chambre de ma fille, j’ai sorti les livres de leur cachette, même si elle n’a que 7 ans. Elle ne lira pas du « Roman + » demain, mais elle est assez grande pour leur faire attention et c’est une façon pour moi de lui annoncer ce que l’univers de la lecture lui réserve. J’ai toujours pensé que ces livres qui ont accompagné mon enfance et mon adolescence allaient lui procurer le même plaisir.
Pourtant je devrais savoir que les œuvres vieillissent parfois plus qu’on se l’imagine. Dans le cadre d’un projet de feuilleton essayistique que je mène sur la plateforme Web Pavillons, j’ai revisité de grands pans de la culture populaire de cette époque. Arrivant au bout de l’exercice après dix-huit mois, je suis surtout marquée par la façon dont elles témoignent de tout ce qui a changé. Ce qui a changé pour moi, évidemment, puisque je ne les reçois pas de la même façon trente ou trente-cinq ans plus tard. Mais surtout ce qui a changé dans la société. Je ne parle pas tellement des détails, souvent technologiques, mais de quelque chose de plus significatif : il me semble que les œuvres parlent toujours un peu de l’époque où elles ont été produites. Elles témoignent de nos préoccupations collectives, des valeurs dominantes, de ce que nous voulons placer dans l’espace public. Les œuvres pour la jeunesse sont aussi intéressantes puisqu’elles ont la spécificité de nous raconter ce que les adultes d’une certaine époque souhaitent transmettre aux jeunes.
C’est donc avec un mélange d’excitation et d’appréhension que je me suis plongée dans la trilogie que Marie-Francine Hébert a fait paraître dans la collection « Roman + » : les livres préférés de ma préadolescence. Ces trois courts romans — Le cœur en bataille, Je t’aime, je te hais… et Sauve qui peut l’amour — racontent les bouleversements que rencontre Léa, 15 ans, et tout particulièrement sa première histoire d’amour avec Bruno « le plus beau gars de l’école ».
Léa (1990 à 1992), comme la Cassiopée de Michèle Marineau (1988 et 1989), et la Marie-Tempête de Dominique Demers (1992 à 1994) ont profondément marqué les jeunes lectrices (le féminin l’emporte clairement ici bien qu’il reste inclusif) de ma génération. Tellement que lorsqu’on en discute entre nous, on a un souvenir très précis de ces histoires. Bien d’autres quarantenaires se rappellent comme moi la scène où Léa se demande si après un baiser il faut s’essuyer les lèvres ou les laisser sécher à l’air. Il faut quand même que cette question ait quelque chose de très pertinent pour le lectorat auquel elle s’adresse pour que près de trente-cinq ans plus tard les lectrices s’en souviennent encore.
En relisant l’histoire de Léa, j’ai été enchantée de retrouver toute la magie dont je me souvenais. La façon dont Marie-Francine Hébert cerne l’adolescence — ses chambardements, ses désirs naissants, ses doutes — est exemplaire. En même temps j’ai été surprise de trouver certaines scènes qui seraient inimaginables aujourd’hui ou en tout cas qui ne pourraient pas être ainsi déposées dans un livre pour la jeunesse sans être davantage problématisées. Il y a plusieurs scènes du livre qui relatent ce qu’on appellerait aujourd’hui des microagressions, mais qui sont présentées comme des banalités. Ça va du monsieur beaucoup trop vieux qui se croit le droit de draguer une adolescente sur le mont Royal aux blagues de seins qui poussent de la part des petits niaiseux de la polyvalente.
Encore plus emblématique : le premier rapprochement d’ordre sexuel entre Léa et Bruno ne se passe pas bien et pourrait être défini comme une agression. Léa dit plusieurs fois non. Bruno ne l’écoute pas. Elle doit se fâcher et s’éloigner physiquement pour qu’il « revienne à lui ». Bien sûr, il va s’excuser et patati et patata. De toute façon, ce n’est pas vraiment ça qui m’intéresse comme le fait que pour que cette scène se retrouve ainsi dans un roman jeunesse et soit considérée comme une étape comme une autre dans la découverte de soi, de ses limites, dans la construction d’un amour, c’est que ça nous semblait « normal ». Il est plusieurs fois répété que les garçons perdent la tête, ne savent plus quand s’arrêter, etc. Le fameux « boys will be boys » des anglophones…
Je dois bien admettre que ces poncifs ont accompagné ma jeunesse et il m’a fallu déconstruire beaucoup de croyances pour comprendre que les choses ne devaient pas se passer ainsi. Qu’il était possible que ça se passe autrement parce que les garçons aussi peuvent apprendre toutes les sortes de respect. Une telle scène serait impossible aujourd’hui, du moins sans toute une contextualisation et une réparation qui est à peine effleurée en 1990.
Je ne sais pas si mes parents savaient exactement ce que je lisais quand je dévorais ces livres à 10 ans… En les relisant, je me suis demandé si j’oserais les faire lire à ma fille au même âge. Non pas qu’ils ne soient pas bons, ou pas intéressants, simplement qu’ils me semblent un peu en décalage avec certaines valeurs qui m’apparaissent incontournables aujourd’hui, pas tant par ce qu’ils disent que par ce qu’ils ne disent pas.
Mais ce décalage je l’ai aussi vécu la première fois que j’ai montré Le petit castor à mon enfant avant de réaliser, un peu médusée, que les personnages se tapent sur la gueule au moindre prétexte. Ou quand je sors ces albums jeunesse des années 1960 dont j’adore l’esthétique, mais qui cachent souvent des histoires assez beiges qui se contentent de reproduire le modèle de la famille nucléaire qui n’a rien à voir avec la vie que nous menons.
Bien sûr que je lui ferai lire la trilogie de Marie-Francine Hébert. Peut-être pas à 10 ans, mais je la lui ferai lire ne serait-ce que pour qu’elle ait une idée de ce à quoi ressemblait ma vie. À cette façon dont nous courions dans la maison pour être les premiers à répondre au téléphone sans pourtant être certains que ce serait pour nous. De cette époque où on allait à la polyvalente sans uniforme, même parfois avec des chandails tout élimés. Mais aussi de ce moment où les commentaires de tous sur notre corps (nos copains d’école, les messieurs croisés dans la rue, parfois même les adultes en position d’autorité) nous apparaissaient aussi indélogeables que les moustiques en juin. Aussi gossants, mais aussi indélogeables.
Je lui ferai lire pour qu’elle sache que certaines choses ne changent pas — les papillons dans le bas-ventre, les doutes qui nous dévorent l’intérieur, le sentiment d’être seule même entourée parfois. Et que d’autres changent heureusement.
Catherine Voyer-Léger
Catherine Voyer-Léger travaille dans le milieu culturel. Écrivaine, elle a publié dix livres dont Métier critique (Septentrion), Nouées (Québec Amérique) et Prendre corps (La Peuplade, Prix littéraire Jacques-Poirier — Outaouais). Récemment, elle signait Mon arbre à musique (Station T), un album illustré par Catherine Petit qui aborde l’adoption avec sincérité et amour.
Photo : © Julie Artacho