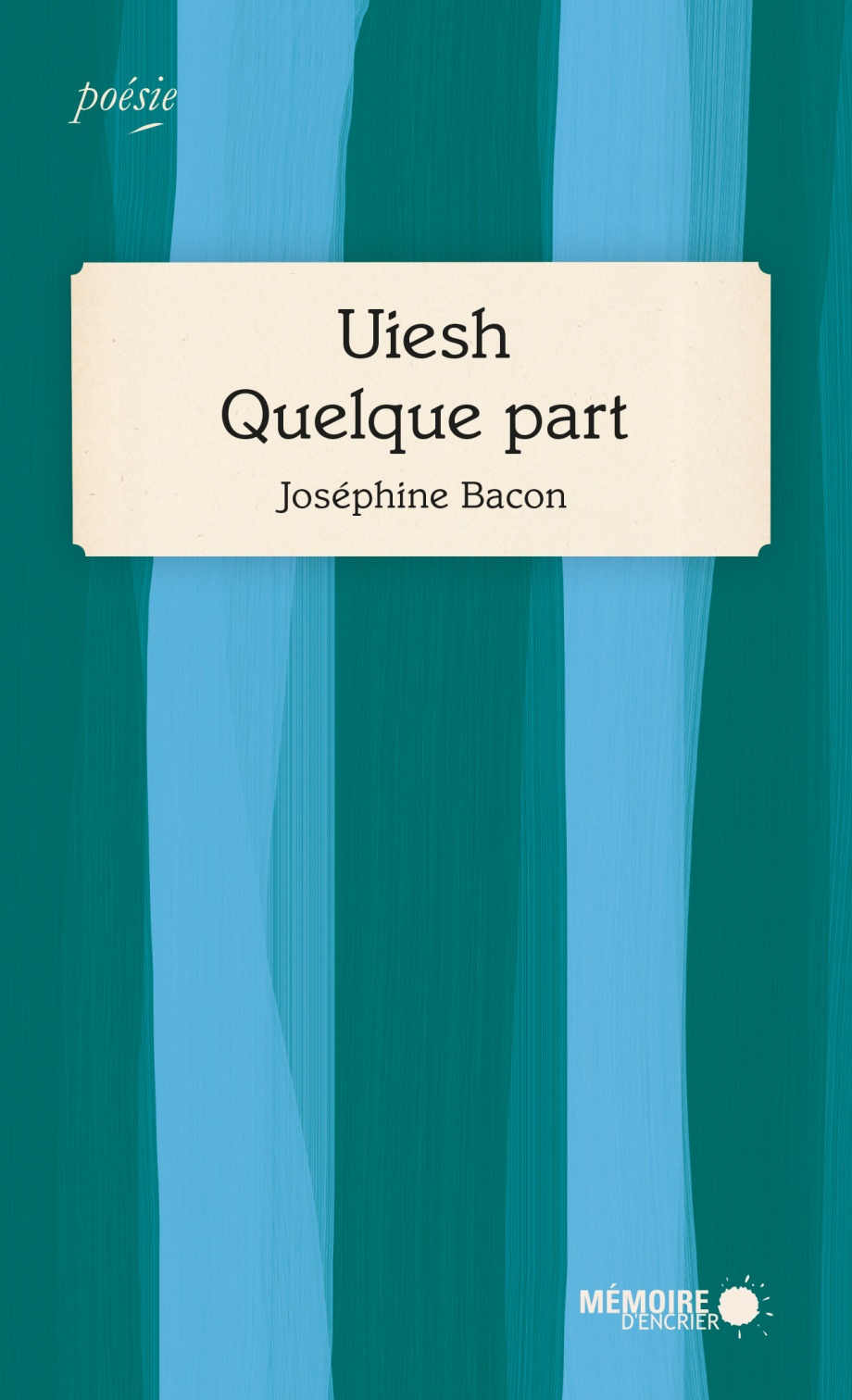– Kuei!
– Heeey Kuei kuei! Miam aa?
– Eshe miam, ek tshil?!
– Eshe miam ni mishta minupin tshia!
Énième jour de canicule. Trente-sept degrés peut-être.
Joséphine Bacon m’attend, assise au comptoir du café où elle va toujours, au coin de sa rue, discutant avec la propriétaire. Ce café est asile de paix. C’est un lieu familial, c’est un couple qui le gère, les enfants sont autour. Depuis qu’elle est arrivée dans le coin, qu’elle le fréquente, elle y a construit des liens d’amitié avec les plus fidèles et surtout les maîtres de la place. Elle dit qu’elle peut y réfléchir et y méditer, que c’est un endroit tranquille. Et elle ajoute, une lumière dans l’œil, le doigt en l’air : « Et quand je suis fauchée, ils me font quand même une facture que je leur remets plus tard! » Nous avons ri un bon coup.
Je me souviens de la première fois que j’ai terminé le recueil Bâtons à message – Tshissinuatshitakana. Je l’avais déposé sur une table. Je m’étais mise à imaginer ce que ce serait que de parler en innu-aïmun avec Joséphine. Que d’être souvent avec elle. D’écrire des poèmes avec elle.
Je crois que l’œuvre de Joséphine ne se résumerait pas normalement qu’à trois recueils de poèmes, puisqu’elle a presque tout fait dans sa longue vie de femme innue parcourant les villes – documentariste, cinéaste, conférencière, traductrice et, à une certaine époque, secrétaire –, et pourtant ses trois titres principaux sont chacun d’un poids qui se répercute dans nos vies. Combien de jeunes filles autochtones feuillettent les pages de ses livres en ce moment même?
Bâtons à message – Tshissinuatshitakana, vous le connaissez certainement. Enfin, j’imagine. J’ose le penser. Il a été publié en 2009 chez Mémoire d’encrier. Depuis, il n’a pas cessé de faire couler l’encre. Ce livre parcourt déjà le monde. On parle de traductions dans de nombreuses langues. En 2019, cela fera dix ans que ce livre existe. Il continue tout de même de vibrer au présent, dans l’esprit de celles et ceux qui le lisent, et de faire réfléchir sur l’héritage immatériel des Premières Nations.
La particularité de Joséphine Bacon est que ses recueils sont bilingues. Il n’est pas possible pour elle de publier des poèmes seulement en français, parce qu’elle écrit aussi dans sa langue. L’innu-aïmun n’est pas perdu, il est toujours parlé et elle en est une de ses nombreux locuteurs. Le défi de notre siècle est de préserver les langues autochtones de l’influence et de la prépondérance des langues coloniales, d’éviter leur effritement graduel au détriment de la culture, et Joséphine compte bien y aider. Parce que ce ne sont pas seulement des questions de fierté ou de résistance qui se posent là, c’est également la question de l’héritage laissé aux prochaines générations comme itinéraire dans le monde de demain.
C’est pour cela que celui-ci est important. Dans ses jeunes années, Joséphine parcourait les villages innus de la Côte-Nord et du Lac-Saint-Jean pour documenter la parole et les savoirs des aînés de son époque. Ces mémoires ne l’ont plus jamais quittée. Encore aujourd’hui, elle continue de raconter à plusieurs d’entre nous des récits du territoire et de la vie nomade de nos aïeux. Les bâtons à message, tshissinuatshitakana en innu-aïmun, étaient ces petits branchages que l’on positionnait d’une façon au bord d’un sentier pour transmettre des messages à celles et ceux qui passeraient par la suite. Famine, abondance, petits animaux au lieu de gros gibier, la direction à prendre, etc. Joséphine, en publiant de petits poèmes, posait alors de nombreux tshissinuatshitakana sur sa route. « Ceux qui viendront l’entendront ».
Au fil des petits bâtons laissés sur le sentier vers le retour à son identité, Joséphine n’aura pas oublié ses périples dans le Mushuau-Nipi entourée de ces mêmes aînés dont elle parle. Le Mushuau-Nipi est le nom traditionnel d’un pan intérieur du Labrador, dans lequel les Innus de l’Est vivaient leur vie de nomades. C’est assez haut au nord pour que ce soit la toundra, avec ces arbres rabougris. Si elle n’oublie pas, c’est bien parce que ce lieu est devenu celui de son imaginaire où elle retourne s’asseoir parfois pour méditer sur la vie. C’est ma perception, ou du moins c’est ce que semble transmettre son deuxième recueil venu comme un cadeau au monde, Un thé dans la toundra – Nipishapui nete mushuat. Ce recueil nous porte avec Joséphine vers un territoire lointain où l’espace prend beaucoup d’espace, et où le ciel semble beaucoup plus proche de la terre. C’est là-bas que le mystère puise sa source, j’en suis sûre. Et l’auteure d’Un thé dans la toundra arrive bien à donner un repos à l’hostilité par l’évocation d’éléments qui réveillent les sens, comme l’odeur du territoire, sa texture, ses sons, ses lumières, son obscurité. Je crois que nous connaissons vraiment le territoire dans sa nature lorsque celui-ci est légué directement par les aînés. Pas autrement.
Dans Uiesh – Quelque part, plus que jamais il y a cette réflexion de l’aînée par rapport à ses liens avec Nutshimit et la ville. On la suit dans ses allers et venues à Tio’tia :ke-Montréal, et dans un poème, sur un banc du parc Molson par exemple, on se retrouve vite au bord du fleuve, dans le Mamit, dans l’est de la Côte-Nord. C’est le pouvoir de celle qui voyage, celle qui évoque les mots pour donner vie à ce que l’on oublie constamment depuis la métropole : qu’il existe un vaste territoire à aimer. C’est la force du nouvel opus de Joséphine Bacon, qui sera enfin dans les librairies en septembre. Chaque nouveau livre venant d’elle est déjà d’une valeur inestimable.
Un café à Tio’tia :ke-Montréal. Bien sûr, nos conversations désormais n’oublient jamais de passer par l’évocation de la philosophie et la spiritualité traditionnelles qui ponctuaient autrefois toute la vie des Innus. C’est l’essentiel de son œuvre. Ce que d’autres appellent du chamanisme, je n’arrive pas à lui trouver un véritable nom, au-delà des connotations suspectes, des stéréotypes de l’Autochtone spirituel, de l’appropriation de nos cosmogonies par de « faux prophètes », mais surtout du bonheur qu’ont certaines gens de trouver chez nous les caractéristiques de « vraies Indiennes ». Au-delà de l’image, il y a la vérité de l’être humain témoin du vivant qui prime le reste, n’est-ce pas?
À partir du moment où nous entrons à nouveau ensemble dans Nutshimit par l’intermédiaire de souvenirs respectifs une nouvelle fois, je remarque qu’elle se met à converser presque seulement en innu-aïmun. Je me rappelle toutes les fois où elle nous a répété, à tous, que les choses les plus essentielles du territoire ne doivent être transmises qu’en innu-aïmun, par respect pour le territoire – car notre langue est issue de lui. Je me dis ceci : c’est aussi par respect pour notre langue, justement.
Elle redit ces mots que je connais par les chansons de Philippe Mckenzie surtout, ce terme précis (parce qu’il sonne comme un seul mot) : E kushpenanut. Dans les dernières années, dans mes lectures et études parsemées de l’innu-aïmun, je n’ai jamais réussi à traduire pour moi-même ce terme, qui est lié directement au concept de camper à l’intérieur du territoire ancestral. Mais il n’a pas d’équivalent en français. Les dimensions spirituelle, environnementale et humaine sont omniprésentes dans la langue innu-aïmun. Chaque mot les porte. Une caractéristique propre peut-être aux langues autochtones, sinon à toutes les langues que l’on pourrait dire « environnementales ».
Je me souviens que la veille, j’ai fait ce rêve, je le raconte à Joséphine : je retournais à Pessamit pour un pow-wow. Au moment d’arriver pour la danse des femmes, en entrant dans le cercle, un danseur du Caribou est entré parmi les danseuses, affublé de bois sur la tête. Élégant, beau, majestueux, et surtout puissant de son corps fort et de ses sabots à la place des mains.
Elle me dit net : « Si ça n’avait été des aînés que je rencontrais étant plus jeune, pour me raconter le territoire et les secrets de notre vie ancienne, je n’aurais jamais connu Papakassik, le Maître des Caribous. Si ça n’avait été de l’idée des bâtons à message, je n’en aurais peut-être jamais parlé, je n’aurais peut-être jamais parlé de ce que les aînés m’ont dit, mais pour moi c’était la chose la plus importante. Et depuis, aujourd’hui, Papakassik se révèle à toi dans tes rêves. » En imaginant à nouveau le pow-wow dans lequel je me rendais dans mon rêve, je pensais aussi à tous ces jeunes qui entreraient en contact à nouveau avec le Maître des Caribous si, un jour, un rassemblement était dédié à cet Esprit.
J’ose une question à Joséphine parce que je me dis que c’est mon devoir, le devoir de ma génération de poser cette question à son aînée : « Qu’est-ce qu’on devrait faire pour faire se reconnecter les Innus à Papakassik? »
Elle répond : « Oh, Seigneur », avec un grand soupir. Ça m’arrive souvent, lorsque je pense à notre philosophie traditionnelle, de souhaiter tant la voir se raviver partout dans les esprits, dans nos communautés. Son soupir, je l’entends. Les pensionnats ont fait tellement de ravages. Dont celui-ci. Mais pas juste ça. Les barrages hydroélectriques. Je n’ose pas y penser. Je ne veux pas mêler ni colère, ni déception, ni rancœur au poids de ma question.
Puis, en prenant une grande respiration, elle se lance :
« Il faudrait que les communautés organisent des expéditions avec des aînés dans les bois. Au moins un an. Un an. On amène les jeunes un an dans Nutshimit. Autant on leur redonnerait une raison de vivre, mais par-dessus tout ils retrouveraient une raison d’être Innus. Ils ont perdu leur identité. On ne leur donne pas la chance de connaître leur identité, la vraie, celle dont ils ont besoin. On a perdu le respect des choses du territoire. Le respect de l’environnement. Il faut leur redonner ce respect. Il est à eux. Il faudrait que le soir, après une journée d’apprentissages dans ce voyage dans Nutshimit, rien qu’après la tombée du jour, ils s’assoient autour d’un feu pour entendre les histoires anciennes. Il faut que les aînés racontent. Il faut que les générations d’aujourd’hui réapprennent à respecter les esprits, les Maîtres des animaux, parce que c’est eux qui nous ont aidés à survivre pendant des millénaires. »
Elle a répété le mot millénaire en innu-aïmun deux fois, pour peser le poids du temps. Le mot par contre que j’ai compris, il m’a échappé, parce que trop complexe pour moi. Je n’ai pas réussi à le noter dans mon petit cahier noir. J’entends tout comme un cri du cœur. Je tente de tout écrire.
Photo : © Jo Ann Champagne
« Ekuene e nutenipenitan auassat. C’est de cela que les jeunes manquent. »
« Nte nana ueshket. »
Ce qu’il y avait avant.
« Tshiashinnuat (les anciens Innus), ils pouvaient entendre les arbres leur parler. Les aînés me répétaient sans cesse : “Si tu sais écouter, tu vas entendre. Si tu sais regarder, tu vas voir.” Mais je n’ai jamais réussi à voir comme ils me disaient que je devais faire, je sais seulement, du moins pour le moment, entendre. »
« Ils connaissaient l’étoile du midi, ils connaissaient par cœur les constellations. Nous avions nos propres noms pour les constellations. Ils pouvaient facilement retourner au campement même dans le noir le plus obscur. L’Innu, c’était un grand scientifique, c’était un environnementaliste. » J’ai envie de lui dire : « Personne ne veut l’entendre. »
« Tshiashinnuat, ils connaissaient tout du territoire. À cause de qui, tu penses? C’était parce qu’ils suivaient les animaux. C’est aux animaux que l’on doit tout. »
Pouvoir retourner à l’intérieur des terres à partir de Tio’tia:ke-Montréal simplement en invoquant le ciel et la terre, les rivières et les caribous. Rien que par les mots. Le pouvoir de la mémoire immédiate. Le pouvoir du rêve.
Il y a quelques mois, je me suis réveillée un matin au milieu d’un rêve, celui-ci : c’était au lever du soleil, j’aurais passé la nuit couchée dans un sac de couchage sur le sable et des cailloux, près d’un feu encore brûlant, mais minuscule. Joséphine est là, déjà assise sur une toute petite bûche de bois. Il y a du thé dans une théière, comme c’était le cas avec mon grand-père, sur une grille au-dessus du feu. C’est elle qui l’a mise là. C’est humide après la rosée, je peux sentir l’odeur du sapin tout autour de nous. Le ciel est d’un bleu pâle, rose et orangé, comme ces matins qui existent seulement à l’intérieur de Nutshimit. Le thé est prêt déjà, et elle me demande dans notre langue si je souhaite en boire. Je lui dis oui. Elle verse du thé dans un verre, elle me le tend. Je me rends compte que des branches de sapin y baignent. Mon thé préféré.
Je ne le lui ai pas encore dit.
Natasha Kanapé Fontaine
Innue et originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, tout comme Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine, poète, comédienne, artiste en arts visuels et militante, a publié quatre recueils de poésie chez Mémoire d’encrier, soit N’entre pas dans mon âme avec tes chaussures, Manifeste Assi, Bleuets et abricotset Nanimissuat – Île-tonnerre, ainsi qu’un essai en collaboration avec Deni Ellis Béchard, Kuei, je te salue : Conversations sur le racisme (Écosociété). Elle a participé également aux collectifs Les bruits du monde et Femmes rapaillées (Mémoire d’encrier). Sa poésie puissante honore ses origines, ses racines, son histoire et le territoire. Cette femme engagée propage une parole sensible, vivante et humaniste. Sa poésie faisant écho à celle de la grande Joséphine Bacon, leur rencontre était toute naturelle. [AM]
Photo de Natasha Kanapé Fontaine : © Myriam Baril-Tessier