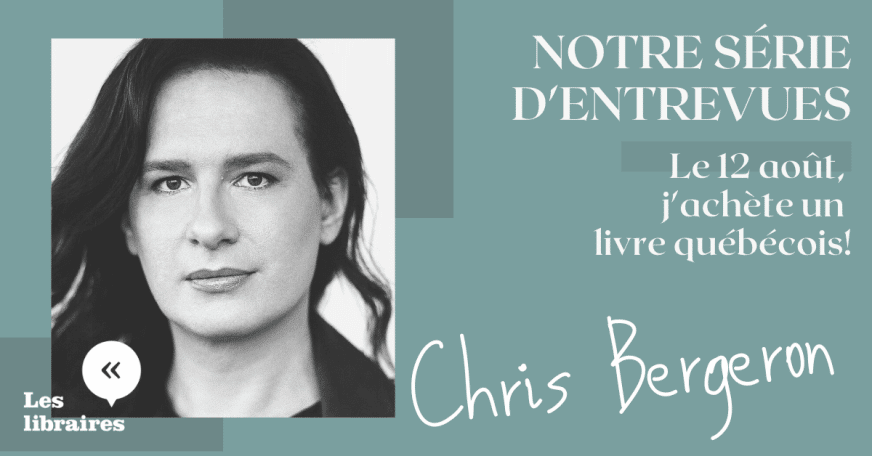Vous avez dans l’histoire de votre famille, décidément très imaginative, de nombreux membres qui ont tenté l’expérience de l’écriture. Quel a été le déclic pour vous?
Avec Stephen King. J’ai d’abord, plus jeune, commencé par faire des bandes dessinées humoristiques, très inspirées de Gotlib et de Mad, le magazine américain. Puis vers 14 ans j’ai eu le grand choc, quand un camarade de classe m’a fait découvrir Stephen King. J’ai englouti toute son oeuvre en quelques semaines, et j’ai su ce jour là que je devais écrire. J’ai commencé des dizaines et des dizaines de romans; j’écrivais à la main, comme un acharné, puis sur un vieux Commodore 64 avec un traitement de texte des plus archaïques. J’ai longtemps hésité toutefois entre mes deux passions, la musique et l’écriture, mais finalement j’ai publié mon premier roman chez Baleine, et depuis je suis sur un nuage.
Votre séjour en Angleterre vous a permis de mieux comprendre la relation particulière qu’entretiennent les Anglo-saxons avec les littératures de l’imaginaire. Quel portrait en faites-vous et comment comparer cet engouement avec celui des lecteurs francophones?
L’histoire littéraire américaine est beaucoup plus jeune que la nôtre. C’est à la fois pour eux un inconvénient (ils n’ont pas dans leur histoire ces magnifiques textes dont nous avons hérité), et un avantage. En France, les auteurs du 20e siècle ont eu à souffrir du poids énorme de cette littérature anoblie par les ans, très sage, où l’on a parfois vénéré bien plus la forme que le fond. Cela va jusqu’à certains extrêmes, où certains critiques littéraires fustigent les romans qui racontent des histoires, écrivent «contre l’imaginaire» et réclament du style, uniquement du style. Je pense, dans mon petit coin, qu’il y a de la place pour les deux. Les romans intimistes de 150 pages où chaque ligne est un joyau de langage et les thrillers de 600 pages. Dans ces derniers, ce qui prime, c’est le suspense, l’intensité dramatique, bref, ils sont la forme moderne du conte que l’on racontait au coin du feu avec pour principal souci celui de tenir son auditoire en haleine, de lui faire peur, de le faire rire ou de l’émouvoir.
Vous êtes un des rares écrivains français à évoluer dans le domaine des littératures de l’imaginaire (tout en conservant une certaine liberté) et à obtenir un bon succès. Regrettez-vous ce manque d’auteurs en France, même si la situation est plus réjouissante depuis quelques années?
En réalité, si vous regardez les deux auteurs qui ont le plus de succès en France, ce sont deux auteurs qui oeuvrent (plus ou moins discrètement) dans l’imaginaire, Bernard Werber et Marc Levy. Le premier est un véritable auteur fantastique, de talent, qui flirte régulièrement avec la science-fiction, une littérature qu’il connaît et apprécie, en grand lecteur qu’il est de Philip K. Dick. Le second a eu la judicieuse idée de faire se rencontrer deux littératures de genre très appréciées par le grand public, la comédie romantique et le fantastique. Je crois qu’il y a de plus en plus d’auteurs de ma génération qui n’ont plus le moindre scrupule à écrire de la littérature de genre, et Maxime Chattam, Erik Wietzel, Pauline Delpech et moi-même sommes, par exemple, la preuve que cette littérature est en train de s’épanouir en France.
Que retirez-vous de votre expérience de journaliste et de fondateur de la revue Science-fiction magazine? J’y ai appris la rigueur de la documentation, j’y ai découvert de nombreux auteurs, et j’ai aussi mis quelques années à me remettre de la fatigue nerveuse que procure le métier de rédacteur en chef.Au nombre des écrivains que vous dites aimer, j’ai noté la présence de Jonathan Lethem, un cas à part en littérature américaine. Qu’est-ce qui vous attire chez lui? La facilité avec laquelle il se joue, justement, des genres. Je pense qu’il est le médiateur entre les deux littératures dont nous parlions tout à l’heure. A la fois un puriste du style, et de façon avant-gardiste qui plus est, et un vrai raconteur d’histoires déjantées. Je l’ai découvert dans les années 90 avec son Flingue sur fond musical, et ce roman m’a littéralement cloué sur mon vieux canapé.
Vous avez débuté chez Bragelonne, qui sont avant tout des amis, paraît-il. Parlez-moi de l’atmosphère qui règne au sein de la maison, reconnue pour sa passion et son enthousiasme à défendre la S.F., la fantasy et le fantastique.
Tout a commencé chez Baleine avec la publication d’un polar futuriste en 1997, sous le nom de Philippe Machine. Mais c’est en effet Bragelonne qui a réellement lancé ma carrière d’écrivain. L’équipe de Stéphane Marsan et Alain Névant (à laquelle appartient d’ailleurs désormais Claire Deslandes, qui était la directrice de collection qui m’avait publié chez Baleine) incarne parfaitement cette nouvelle génération en France, qui a grandi dans l’amour des littératures de l’imaginaire, et s’est mise à en faire sans complexe, en assumant complètement les codes et les jeux du genre. L’un et l’autre sont peut-être les deux personnes les plus cultivées que je connaisse de cette génération, ils ont une intelligence rare et une intuition que beaucoup leur envient, ce qui ne les empêche pas de rester de parfaits rigolards, qui mangent des pizzas quatre fromages en regardant des navets à la télé affalés sur un canapé. Tout ce que j’aime!
Les influences entre les littératures dites populaires et littéraires (sic et re-sic) étant si nombreuses aujourd’hui, ne sommes-nous pas désormais entrés dans une époque où il faut procéder à un décloisonnement des genres?
Tout à fait. En vérité, je dois vous avouer que les questions de genres ne me passionnent plus vraiment. Je ne me pose plus ces questions (les journalistes s’en chargent à ma place) et quand j’écris ou je lis un roman, ce qui m’intéresse, ce n’est pas son genre, ce sont avant tout les personnages, ce qu’ils vivent, ce qu’ils éprouvent. La littérature, pour moi, c’est d’abord ça. Un miroir de l’homme.
Qu’elles ont été vos sources pour poser les bases de l’univers de «La Moïra»?
Pour cette première trilogie de fantasy, j’avais à l’époque envie de rendre hommage à ce genre littéraire, tout en bousculant ceux de ses stéréotypes qui me gênaient le plus. La fantasy est parfois une littérature conservatrice et souvent assez machiste. J’ai donc eu envie d’écrire de la fantasy progressiste, qui posait la question du «vivre ensemble», et où le personnage principal était une jeune fille confrontée à une société machiste conservatrice. Comme le dirait Romain Gary: je me suis bien amusé.
Le loup, animal incompris et mal aimé s’il en est, serait-il un symbole important dans votre cycle, en ce qu’il incarne l’acceptation de l’Autre, cet inconnu?
Il pose parfaitement, surtout dans notre pays, la question du «vivre ensemble». Est-il normal, en 2007, que l’homme ne soit pas foutu de cohabiter avec un animal? Certes, il serait idiot de nier les problèmes particulièrement pénibles que pose le retour de ce prédateur pour nos bergers, dont le métier est loin d’être facile, mais la beauté de l’espèce humaine ne réside-t-elle pas dans sa capacité d’adaptation? L’homme n’est-il pas magnifique quand son intelligence lui permet de s’enrichir de la diversité qui l’entoure, plutôt que de prendre un fusil et de bousiller tout ce qui bouge?
Dans un même ordre d’idées, vous abordez souvent dans vos romans l’idée de la foi, sujet glissant et menant parfois à des débats sortant du contexte de la littérature en général.
Je ne pense pas que la question de la foi sorte du contexte de la littérature. Au contraire. Finalement, dans son plus simple appareil, la littérature ne parle que de deux choses, l’amour et la mort. L’une et l’autre sont souvent liées à la foi, non?
Le fait que votre personnage principal soit une fille est en soi assez différent de ce qu’on peut voir dans le reste de la production actuelle en fantasy. Est-ce que cela vous a rapproché d’un lectorat féminin?
Sans doute. Encore qu’il serait erroné de penser que la question du droit des femmes ne concerne que celles-ci. Tous les hommes ne sont pas d’horribles machistes, et beaucoup, comme moi, sont mariés et pères de petites filles pour lesquelles ils espèrent un avenir où les hommes et les femmes seront enfin égaux, ce qui n’est malheureusement pas encore le cas.
Avec «Gallica», dont l’action se situe au XIIe siècle en France, vous vous êtes rapproché du roman historique. Au fil du temps, les liens qui se tissent entre vos romans semblent plus évidents et votre volonté d’explorer librement les genres, encore plus forte. Qu’est-ce qui motive cette exploration?
C’est pour moi ― entre autres ― une volonté d’amener à la littérature des types de lecteurs qui n’auraient peut-être jamais pensé pouvoir s’y intéresser. Beaucoup d’amateurs de romans historiques ont été attirés par «Gallica» uniquement parce qu’il est ancré dans un XIIe siècle historique, et ont alors découvert qu’ils pouvaient apprécier une littérature qui laissait beaucoup de place à l’imaginaire. Cela m’a fait plaisir de pouvoir faire un pont entre les deux.
Vous avez évoqué en entrevue avec Stéphane Marsan la possibilité d’écrire un autre roman dans l’univers de «La Moïra» et de «Gallica», et situé en 1871 à Paris. C’est un projet qui existe toujours?
Oui, Les Loups de la Commune sortira en 2008, et jamais je n’ai poussé aussi loin le mélange des genres. On pourrait, en s’amusant, dire qu’il s’agit d’un thriller «investigatif historico-ésotérique merveilleux». En voilà, un beau label!! Plus sérieusement, c’est une espèce de thriller qui se passe pendant la Commune de Paris, mais dans lequel on retrouve des éléments merveilleux ainsi que les fameux Compagnons du Devoir, qui étaient déjà les héros de «Gallica».
La transition entre l’écriture de thriller et de fantasy s’est-elle faite naturellement? Changez-vous vos modus operandi lorsque vous écrivez l’un ou l’autre?
Finalement, les deux modes sont pour moi assez proches. Mes romans de fantasy demandaient beaucoup de documentation et nécessitaient, tout autant que mes thrillers, un synopsis très détaillé où la tension dramatique était mon souci principal. Ce qui change, bien sûr, c’est le champ lexical.
Le Syndrome Copernic marque un grand coup dans votre carrière. Vous vous attaquez à la dissimulation de la vérité, entre autres. Comment s’est passée sa rédaction?
J’ai mis environ deux ans à écrire ce thriller, une écriture qui a été interrompue par un sérieux accident de moto. Lequel a sans doute, je l’espère, donné plus de profondeur à mon récit, parce que je me suis mis à me poser plus sérieusement certaines questions que j’évitais avant d’avoir vu la mort de si près.
Comme dans Le Testament des siècles, vous avez au fil de vos recherches déterré plusieurs mystères modernes pour les intégrer dans votre roman. Ici, le syndrome de la guerre du Golfe et le spectre du groupe Bilderberg, dont la dernière réunion a eu lieu ici, au Canada. Après la folie Da Vinci Code, que penser de ces groupes et de ces complots? Toutefois, la ligne est mince, non?
La grande différence entre Dan Brown et moi, en dehors du nombre de ventes (rires), c’est que je n’ai pas écrit au début du Testament des Siècles ou du Syndrome Copernic que tout ce que je racontais dans mon livre était réel. Pourtant, le Bilderberg existe vraiment (malheureusement), alors que le fameux Prieuré de Sion dont parle Dan Brown est une bouffonnerie loufoque inventée par un Français après la Seconde Guerre mondiale, et pas du tout la société secrète millénaire pour laquelle l’auteur veut la faire passer. Je rappelle sur mon site à mes lecteurs qu’il faut se méfier des informations qu’ils peuvent trouver sur le Net au sujet des «théories du complot», théories souvent relayées et amplifiées par des groupuscules d’extrême droite antisémites. Dans mes romans, je m’amuse avec ces théories, qui ne restent que des artifices ludiques, des objets littéraires, tout autant que les bijoux perdus des mousquetaires d’Alexandre Dumas.
Vous semez plusieurs passages notés dans un carnet Moleskine dans lesquels vous réfléchissez au destin des hommes. C’est un ressort romanesque très intéressant. En tant qu’écrivain et témoin de votre temps, qu’est-ce que ces carnets vous ont offert?
Ils m’ont permis de me livrer davantage dans ce roman, d’y faire apparaître mon doute perpétuel, mes questionnements. Je suis un écrivain (et un citoyen) qui croit au progrès, à la perfectibilité des hommes, mais pour qui cette croyance doit nécessairement passer par un doute perpétuel, une remise en question permanente de nos certitudes, de nos valeurs.
Que retenez-vous de vos recherches sur le cerveau faites pour la rédaction du Syndrome Copernic? Que la réalité dépasse la fiction de manière exponentielle. Plus ça va, plus la science-fiction est en retard sur ce qui se passe dans les laboratoires de recherche. Et quand les lecteurs du Syndrome Copernic y découvriront ce que la science cognitive est capable de faire aujourd’hui, je veux espérer qu’ils se poseront, comme moi, la question de l’évolution probable de notre espèce dans les prochaines décennies.
Vous utilisez aussi beaucoup les ressources du Web et, sur le site consacré au Syndrome Copernic, vous offrez des vidéos réalisées par Vigo Ravel, le personnage principal du roman. La Toile est-elle, selon vous, une extension de votre univers romanesque?
C’est un formidable pont entre l’auteur et les lecteurs, un moyen de communication extraordinaire qui nous rapproche. Mes lecteurs me tutoient, m’écrivent régulièrement, se moquent de moi quand ils estiment que je le mérite, et cette spontanéité est pour moi très rafraîchissante.
Qu’est-ce qui attend sur votre table de travail présentement?
Un thriller politique, et cette fois, je pourrai écrire: «Ce roman est inspiré de faits réels» sans tricher. Le pitch: «À partir de 300 000 morts, la vérité a un prix». Le titre: Le Supplice de Tantale. Mais il va falloir patienter un an. Le Syndrome Copernic vient tout juste de sortir!
Bibliographie :
Le Syndrome Copernic, Flammarion, 441 p., 32,95$
Le Testament des Siècles, J’ai Lu, coll. Thriller, 378 p., 37,95$