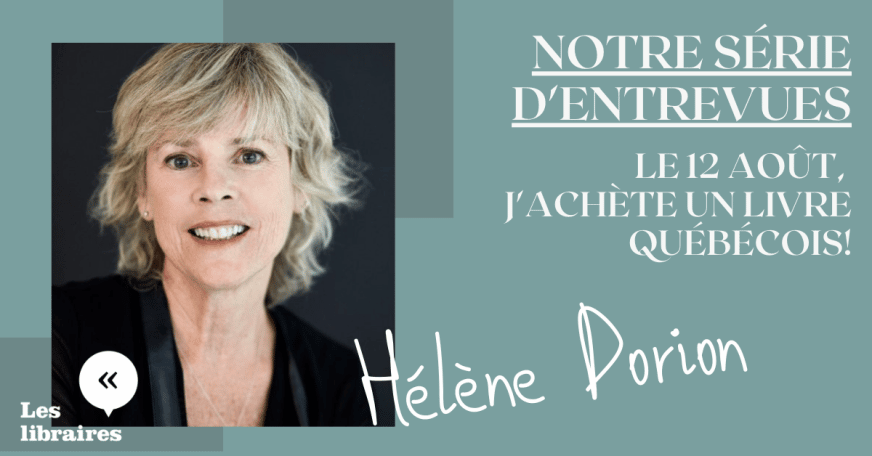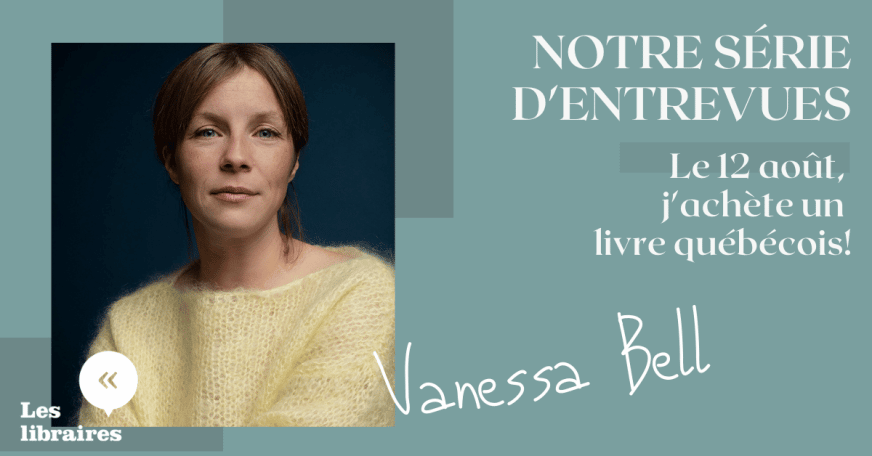On est tous plus ou moins déterminés par notre éducation, notre entourage, notre culture. D’après vous, à quel moment cesse-t-on de s’appartenir jusqu’au malaise?
De là où je parle, il n’y a pas de diplômes de psychologie, de sociologie. Il n’y a qu’une expérience du monde, du mien surtout. Parce que si ma sensibilité fait loupe, elle n’affirme que très peu les choses. C’est donc en balbutiant du senti que je me prête à l’exercice de ces réponses. Si la question de la disparition à soi-même vous interpelle, je vous conseille vivement la lecture de Disparaître de soi : Une tentation contemporaine, de l’anthropologue David Le Breton.
S’appartenir « complètement » est probablement une utopie que l’on ne peut réaliser qu’en étant capable de faire abstraction des liens qui nous unissent à « nos autres ». Parce qu’être en lien, c’est aussi faire la promesse de correspondre au rôle que ce lien impose. J’aime voir mes autres comme différentes familles auxquelles j’appartiens. Ces familles me portent, me construisent, elles sont filets en temps de chute. Mais elles peuvent aussi devenir l’espace où les possibles se flétrissent, s’étouffent. Là où « être soi » n’est plus déterminé de par l’intérieur, mais plutôt de par l’extérieur. Le malaise inscrit sa lente oppression dans le corps de celle ou de celui qui n’arrive plus à faire de choix indépendants de la dictature de sa propre construction sociale. Être « je » est une tâche dont on ne peut jamais se libérer et porter le poids d’une identité aliène silencieusement. Respirer, ne serait-ce que quelques secondes, en dehors des bordures de son « moi », devient parfois une question de vivre ou de mourir-en-vie.
J’ai vécu une expérience déterminante dans mon parcours personnel. À l’adolescence, j’ai été hospitalisée pour un trouble alimentaire grave. L’anorexie est une forme de lente disparition de soi-même. Mais c’est aussi une façon bien douloureuse d’essayer de réapparaître blanchie de la marque laissée par l’Autre. De se dissocier du monde pour contrôler les brûlures émotionnelles. Une résilience dangereuse. Lors de mon séjour à l’hôpital, j’étais enfermée dans une chambre, dépossédée de tout objet, de vêtements et de libertés élémentaires. Chaque infime prise de poids me valait un privilège – du genre « le privilège de me brosser les dents » ou « celui de me lever cinq minutes de mon lit ». Le plan d’intervention avait comme objectif premier de me faire prendre les kilos qui me séparaient de la (sur)vie. Mais, et c’est là où ça devient intéressant, l’idée derrière était de me réapprendre à faire des choix. Cet objectif peut sembler simple, mais il était, au contraire, encore plus important que la prise de poids. Je n’avais jamais appris à faire des choix. Je laissais le monde me mener sans que j’en choisisse la direction. Apprendre à ne plus dire « peut-être » a été un jalon déterminant de ma guérison.
Il y a tant de carrefours visibles et invisibles qui tracent les contours de nos existences. On cesse de s’appartenir quand on accepte que toutes nos routes soient tracées d’avance, à l’encre d’un crayon que l’on ne tient pas nous-même. On cesse de s’appartenir quand on accepte tout sans remettre en question, quand on hoche la tête à défaut de demander pourquoi. On cesse de s’appartenir quand on se regarde vivre soi-même sur une rive que l’on ne peut pas atteindre. On cesse de s’appartenir quand les jours passent sans qu’on ait fait un choix pour soi-même, libre du joug de la routine. On cesse de s’appartenir quand on accepte les couleurs déterminées d’avance.
Le personnage d’Emma, dans la pièce, souffre de cette incapacité abyssale de faire des choix par elle-même. Toute sa vie a été dictée par les autres, par son entourage. Et bien que personne n’ait voulu lui faire de mal à proprement dit, cette absence d’espace où elle aurait pu se définir par elle-même a conduit à sa perte. Une perte qui n’en est peut-être pas une, au final. Le geste qu’elle pose n’est pas un cri à l’aide qu’elle dirige vers l’extérieur. Mais plutôt une façon d’hurler dans sa propre tragédie, de prendre le rôle principal de sa vie, de se rencontrer elle-même. Elle crie à l’aide, oui, mais elle le fait à l’intérieur d’elle-même, pour elle-même.
Je voudrais vivre dans une société qui alimente la nuance plutôt que le despotisme de l’opinion. Je voudrais qu’on défasse le portrait aliénant de ce que c’est la réussite. Je voudrais qu’on se donne le droit de se transformer.
Quand notre équilibre ne peut se faire qu’au détriment de celui d’autrui, est-il courageux ou lâche de chercher à l’atteindre?
Pour moi, le mot équilibre suppose un état où toutes les facettes d’une même personne sont comblées. Un espace où tous les rôles sociaux assumés par un individu lui corresponde. Ou à peu près. Ou à peu près tout le temps. J’ai plutôt l’impression que quelqu’un qui cherche à atteindre l’équilibre parfait le fera au détriment de lui-même.
Dans la pièce, Emma ne cherche pas l’équilibre. Elle cherche à trouver une faille dans le tableau parfait érigé par le temps. Elle cherche une respiration qui lui soit propre. Elle veut raconter l’histoire à sa façon. Et on peut dire qu’elle le fait certainement en portant préjudice à sa fille, à sa mère, à son père, à son conjoint et probablement à tous ses amis. Ils porteront à tout jamais cette absence. Ils devront construire autour. Faire la vie avec ce qu’elle a de trous. Et je pense que c’est ma réponse à la question que pose la pièce. Nos vies sont ponctuées de manques. Il faut apprendre à construire autour. Ou en tout cas essayer d’apprendre.
Quand nos transformations, parfois radicales, ne peuvent se faire qu’au détriment d’autrui, est-il courageux de les assumer? Même en retournant la question, je n’arrive pas répondre. Je ne suis pas capable de porter un jugement sur la lâcheté ou le courage d’autrui. Ce que je sais, c’est que certaines personnes ne peuvent simplement pas résister à l’épreuve de l’immobile. On s’extrait tous de nos existences, d’une façon ou d’une autre. Parfois sereinement. D’autres fois violemment.
Est-ce que l’équilibre d’une relation, celle d’un adulte envers un autre adulte, repose sur le respect réciproque de nos déséquilibres?
Je cherche, je cherche…
Est-ce que pour vous le personnage d’Emma, celle qui a tout quitté pour recommencer, a fini par trouver sa place?
En cours d’écriture, j’ai souvent hésité à écrire le « après » d’Emma. J’étais moi-même curieuse de savoir si et comment elle allait réussir à refaire la mise en scène d’elle-même. Mais j’ai rapidement compris que cet après ne devait exister qu’au cœur du spectateur, du lecteur. Il est le reflet de ses obsessions personnelles. Ceci dit, je ne pense pas que cet exil soit le narratif d’un bonheur trouvé ou retrouvé. Bien au contraire. Emma ne quitte pas pour recommencer quoi que ce soit. Elle quitte pour ne pas mourir, là, maintenant. Elle quitte comme on met fin à ses jours, pour arrêter de souffrir. La vie qui l’attend, selon moi, en est une d’errance sans attache. Une vie de grande solitude. Fantasmer sur soi ailleurs est une chose que l’on peut tous faire. Mais je suis certaine que cet ailleurs n’a rien du goût vertueux de l’aventure. Comment Emma peut recréer des liens avec autrui en sachant que ces liens sont exactement le poison qui a fait sa plus vicieuse prison?
Aussi, et je dirais surtout, certains rôles exigent une grande qualité de présence à l’Autre. Une fidélité de chaque instant. Le rôle de parent est à mon sens le plus prenant qu’il soit. Je pense qu’Emma ne se départira jamais de celui-ci. Sa plus grande blessure restera probablement d’avoir été incapable de l’assumer jusqu’au bout. Ou de l’assumer tout court. Donc même en l’ayant quitté, ce rôle, elle est encore complètement subordonnée à celui-ci. À la fin de la pièce, Nina dit à Emma que toute sa culpabilité lui vient du mot « maman » puisqu’elle l’a donné à quelqu’un d’autre. Si Emma avait la force de parler, à ce moment, elle lui dirait exactement la même chose. Le mot maman restera à tout jamais le ferment de ses plus immenses regrets.
Emma est conditionnée dès son plus jeune âge par les autres, si bien qu’arrive un moment où sa vie ne correspond plus du tout à ce qu’elle pressent être. Quelle question devrait-on régulièrement se poser pour s’assurer de ne pas se faire désertion?
Hm…
Hm…
Hm…
Si je savais…
Mais…
Peut-être qu’il faut simplement accepter de s’absenter de la course effrénée de notre récit quotidien. Peut-être qu’il faut trouver une façon saine de s’éclipser momentanément du poids inévitable que c’est « être je, être moi ». Dans une société où le paraître est roi, peut-être que le « disparaître » pourrait faire office de respiration. Il y a toutes sortes de disparitions. Les plus radicales sont violentes, certes. Mais il y a aussi celles, plus douces, qui libèrent, ne serait-ce que pour quelques heures. Je pense par exemple au rôle de la fiction, aux voyages en général, aux longues marches en solitaire. Je pense aussi à la création. Je pense beaucoup à la création.
Peut-on socialement faire quelque chose pour que chaque individu se sente très tôt libre et légitime d’être lui-même et d’éprouver ses choix?
La clé réside dans cette formulation que je trouve tout à fait juste : libre d’éprouver ses choix. Cette liberté m’apparaît cruciale, vitale même. Comment la trouver, l’encourager, comment transformer la société pour l’atteindre plus en profondeur qu’en surface?
Autrefois, le citoyen vivait dans une forme de dictature éthique, religieuse et politique. La classe sociale déterminait d’avance le système de pensée de l’individu. Aujourd’hui, nous sommes libres, justement. Libres d’être sous notre propre autorité et de choisir nos familles de valeurs. Mais cette liberté est source d’angoisses et d’abîmes parce qu’elle en est une de façade. L’opinion des masses a pris la place du curé. Le système de dominants/dominés, les privilèges visibles/invisibles, les inégalités sociales forment des cadres qui astreignent vicieusement les individus.
Je voudrais vivre dans une société qui alimente la nuance plutôt que le despotisme de l’opinion. Je voudrais qu’on défasse le portrait aliénant de ce que c’est la réussite. Je voudrais qu’on se donne le droit de se transformer. Je voudrais qu’on puisse bégayer nos vies sans être constamment obligés d’affirmer un « je » qui soit ferme et fort. Je voudrais que le sexe d’un individu, sa couleur de peau, sa langue, son poids, ne détermine absolument en rien son parcours. Je voudrais qu’on puisse se dire « je suis là » sans trembler ou en tremblant justement. De la tête au cœur. Qu’on puisse vibrer, vibrer pour vrai, quand on décide à plusieurs qu’être des êtres humains, ça peut ressembler à des milliards de possibles. Et des milliards de balbutiements. Qu’on se déploie toujours, un pli après l’autre. Je voudrais qu’on cherche ensemble à ne jamais arrêter de chercher ensemble.
Photo : © Lucas Harrison Rupnik