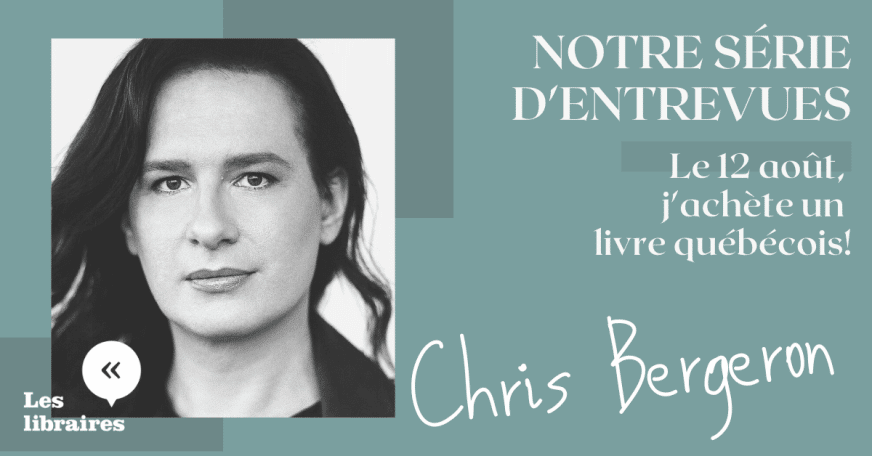De plus en plus souvent, on vous attribue la paternité d’un nouveau genre littéraire, le fantastique historique (historical fantasy); croyez-vous qu’il s’agisse d’une étiquette adéquate pour vos livres ?
Je suppose que oui. J’ai souvent dit, en blague, que lorsque vous êtes latino-américain et que vous écrivez ce genre de livres, on vous classe d’emblée dans le réalisme merveilleux et on applaudit votre travail, tandis qu’en Amérique du Nord, on a souvent tendance à vous reléguer au rayon fantastique avec un brin de mépris. Cela dit, je n’ai jamais pensé que mon œuvre transcendait le genre. Je suis tout à fait à l’aise avec l’idée d’œuvrer dans un genre populaire, même si j’ai sciemment cherché à en repousser les limites. Vous savez, ce n’est pas tant la présence de sorciers ou de créatures surnaturelles qui rattache mes livres au genre fantastique, mais la manière de réinterpréter dans un univers imaginaire des données appartenant à l’Histoire de ce monde-ci.
Depuis L’Arbre de l’été (1984), plusieurs avaient noté une diminution de la part de magie, un recours de moins en moins fréquent au surnaturel dans vos livres ; or, dans La Mosaïque sarantine, il semble que la magie soit de retour en force.
Oui et non. Je crois que c’est le sujet qui a imposé ce retour en force, comme les sujets avaient imposé cette diminution qu’une volonté délibérée de ma part de réduire le quota de magie. (Rires) La Mosaïque sarantine explore ma vision de la fin de l’Antiquité, en particulier de » Byzance » à la chute de l’empire romain. Juste la mention du nom Byzance évoque le mysticisme, la magie, les liens avec le monde occulte – alors il allait de soi pour moi qu’un livre vaguement inspiré de cette époque et de cet endroit devrait forcément contenir davantage de magie que Les Lions d’El-Rassan, par exemple.
Bien que vos intrigues soient touffues et habilement construites, la lecture de vos livres laisse l’impression que vous vous souciez davantage encore du développement psychologique de vos personnages, ce qui est relativement rare dans le genre.
Vous avez raison. D’une manière générale, on pourrait reprocher à beaucoup d’auteurs d’épopées fantastiques de négliger cette part essentielle du travail de romancier, sans doute parce que la machine éditoriale sait que ce genre plaît – paraît-il – davantage à un lectorat adolescent, beaucoup plus friand d’aventures et d’action. De même, quand on lit la littérature générale contemporaine (mainstream fiction), on pourrait également reprocher à ses praticiens de se soucier uniquement de la psychologie des personnages, au détriment de l’intrigue, de l’architecture du récit à proprement parler, de l’enchaînement des péripéties d’où le lecteur tire une bonne partie de son plaisir. Dans mes livres, j’essaie de maintenir un équilibre entre ces deux tendances qui me paraissent aussi fondamentales l’une que l’autre.
Le motif de la quête, du voyage est certes une figure obligée du genre. Pourtant, pour les héros de La Mosaïque sarantine, le mosaïste Crispin puis le médecin Rustem, il a une fonction plus fondamentale qu’un simple déplacement dans l’espace.
C’est juste. Au fil de leur voyage, Crispin et Rustem ne vont pas seulement vers une autre contrée, ils plongent également en eux-mêmes, découvrent des choses sur eux-mêmes, évoluent… Le premier tome, par exemple, amène Crispin (une sorte de citoyen romain extrêmement sophistiqué, amateur de bons vins, de bains publics, de massage, etc.) dans un monde qui lui est totalement étranger, sauvage, presque hostile. Un tas de choses lui arrivent, qui changeront sa vision du monde. Voile vers Sarance fait la chronique de ce changement, de cette évolution et des répercussions qu’auront ces péripéties sur lui, puis se termine. Mais, dans Le Seigneur des empereurs, de par la nature de l’endroit où se déroule l’action, l’attention ne peut plus se braquer sur ce seul personnage; au deuxième tome, il y a beaucoup trop de gens qui sollicitent l’attention du lecteur pour qu’il se concentre uniquement sur Crispin.
Je sais que Jean-Louis Trudel vous a déjà posé la question lors d’une entrevue pour Solaris, mais histoire de vérifier si votre opinion a changé depuis : n’avez-vous jamais ressenti l’envie d’examiner l’histoire du Canada de la même façon que vous avez examiné celles de l’Italie, de la Provence ou de l’Espagne ?
Vous savez, quand je m’inspire d’un chapitre de l’histoire réelle, je me garde suffisamment de liberté pour que ma création offre plusieurs pistes de lecture. C’est ce qui explique que quand je voyage à travers le monde, je rencontre autant de gens en Pologne, en Yougoslavie ou ailleurs qui me disent : » Dans tel ou tel livre, vous parliez de nous, n’est-ce pas ? » Pour écrire Tigane, par exemple, je m’étais inspiré d’une page d’histoire italienne, mais j’ai pleinement conscience que la thématique politique et linguistique peut avoir toutes sortes de résonances dans un contexte canadien. Cela dit, je continue de me sentir davantage intéressé par l’Europe dans la mesure où elle est le berceau de notre civilisation occidentale. Honnêtement, j’aurais l’impression de manquer de recul si je devais écrire une fiction inspirée de notre Confédération, qui est encore si jeune…