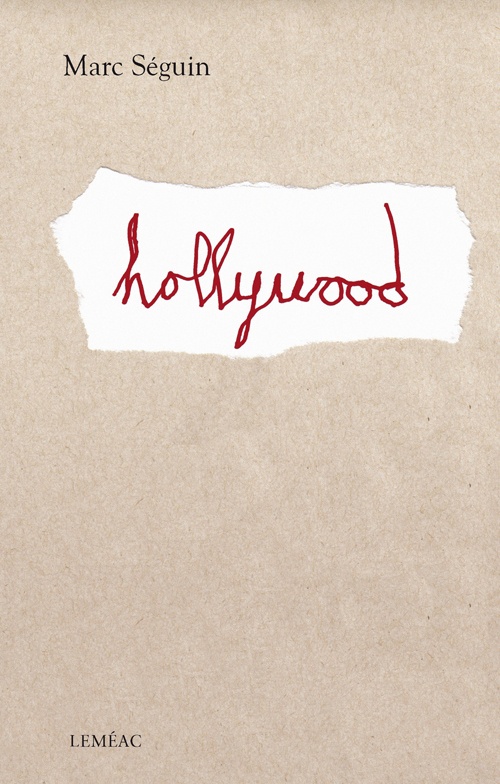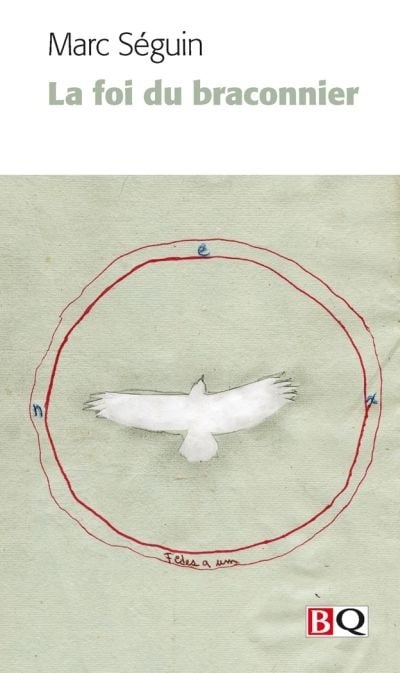Au-delà de sa pratique en arts visuels, Marc Séguin a également réalisé un film, Stealing Alice, qui fait écho à son roman Nord Alice, et un documentaire qui met en lumière des questions essentielles pour le futur de l’alimentation, La ferme et son État. Également auteur d’exception, Séguin a trouvé comment cerner les émotions, les tensions, la brutalité en ses protagonistes. Il nous en livre ci-dessous un peu plus sur lui et sur son œuvre protéiforme.
Vous avez accepté d’illustrer les Contes de Jacques Ferron, réédités à l’occasion du soixantième anniversaire de son éditeur, Hurtubise. Qu’est-ce que cet auteur évoque en vous? Quel lien avez-vous pu tisser entre les textes de Ferron et les œuvres qu’ils vous ont inspirées?
Les Contes de Ferron font partie de notre histoire. Ils nomment les territoires que nous sommes, tant géographiques qu’humains. L’écriture de M. Ferron est un travail d’orfèvre : il raconte des histoires de beautés et de travers avec une précision de sentiments unique, et c’est toujours aussi juste après soixante ans. Très peu d’œuvres littéraires savent survivre au temps. Je n’aurais pas pu « illustrer » les Contes; j’ai plutôt choisi l’évocation et d’offrir, par des dessins, une « autre » lecture.
On dit souvent de vos œuvres qu’elles explorent le caractère trouble de la nature humaine. On pourrait en dire tout autant de vos romans, d’ailleurs. Qu’est-ce qui vous attire comme artiste dans ce que la nature humaine a de bestial, d’ambigu?
Ce n’est pas tant une attirance qu’une observation. La naïveté et la bonté dont nous nous croyons constitués nous aveuglent parfois au point de nous croire, et c’est dangereux de baisser ainsi la garde. Toutes les formes de survivance (humaine, animale, végétale…) sont aussi faites de violences. Et c’est la nature des artistes de dire et de nommer l’inquiétante réalité de notre survie. Beautés et horreurs.
Parlez-nous de l’œuvre en couverture de la revue Les libraires. Dans quel état d’esprit l’avez-vous créée et que représente-t-elle pour vous?
C’est un personnage féminin qui s’élève au-dessus d’un paysage dévasté. Faites votre poésie avec ça!
Vous avez signé les couvertures de certains livres que vous avez écrits — Nord Alice, La foi du braconnier, Au milieu du monde, Hollywood. Quel plaisir trouvez-vous à illustrer « l’emballage » de vos propres mots?
Aucun plaisir (je souris ici); ça coûte moins cher de droits à ma maison d’édition (je souris encore ici). Dans la réalité, si j’ai porté les mots, une image apparentée devrait pouvoir surgir. Mais encore ici, c’est l’évocation qui est souhaitée.
Dans Jenny Sauro, votre plus récent roman, vous vous êtes pour la première fois glissé au plus près d’une protagoniste femme, sans toutefois utiliser le « je ». Pourquoi ce choix de narration?
L’histoire est racontée par une voix invisible. Pour installer une distance, pour que le lecteur puisse recevoir une histoire qui ne serait pas teintée d’un risque égocentrique. Loin du « je » narcissique. Avec la conscience d’avoir trop lu de livres au « je » ces dernières décennies. Écrire au « je » ne recèle pas davantage de vérité. Ce sont les sentiments et l’intelligence qui « écrivent » une réalité.
Vous êtes artiste, auteur, réalisateur, père de quatre enfants : quel est votre rapport au temps pour arriver à accomplir tant de projets?
Vous me faites sourire! La vérité c’est que je suis immensément paresseux, et le plus clair de mon temps est passé à rêver les yeux ouverts et à ne rien faire. Pour tout le reste, ma grand-mère disait : « Si tu veux que quelque chose se fasse, demande à quelqu’un d’occupé. » Et je suis chanceux…
Photo : © Jérôme Guibord