Elle a peu à voir avec le rôle exotique dans laquelle plusieurs la confinent cette Acadie littéraire. À l’occasion de la fête nationale des Acadiens, Les libraires sont allés faire un tour en ses livres, question de dresser un portrait juste de cette nation qui se tient debout dans la révolte avec humour et intelligence. Rencontre avec le comédien, poète, dramaturge, musicien, Gabriel Robichaud, tout juste de retour des Jeux de la Francophonie à Abidjan, Côte d’Ivoire, où il a remporté les honneurs avec la médaille d’argent en littérature pour sa nouvelle Char*.
Quel serait l’a priori que tu voudrais détruire par rapport à la littérature acadienne?
La langue. Le chiac est acadien, mais l’Acadie n’est pas chiac. Souvent on fait un amalgame dans les médias nationaux, on réserve au chiac et à l’Acadie le même traitement que les Français réservent aux Québécois : c’est-à-dire une forme d’exotisation de l’accent. « C’est dont ben cute, parle donc comme tu parles ». L’accent acadien est multiple. Oui, une génération et certains auteurs se le sont approprié, mais ça va au-delà de ça. Gérald Leblanc, par exemple, a décidé de jouer dans la langue et d’en rire. La littérature acadienne a ceci de particulier qu’elle est rieuse, elle aime faire des pieds de nez, elle s’approprie l’intertextualité.
On la distingue des littératures de la francophonie par quels autres aspects?
Notre littérature est jeune. Cette année marque le 45e anniversaire de la première maison d’édition qui a ouvert ses portes en Acadie : Les éditions d’Acadie. C’était la première maison d’édition de langue française en Amérique du Nord à voir le jour à l’extérieur du Québec.
La poésie y a une place prépondérante.
Comment ça s’explique?
C’est commun pour un peuple de commencer par la poésie, ensuite le théâtre, puis le roman, dans le développement de l’imaginaire collectif. Les premiers poètes cherchent à nommer le territoire, en font une cartographie poétique. Il lui donne une existence et le droit de vivre. Ici, nous commençons tout juste à prendre une certaine distance par rapport à ça. Nous en sommes à la quatrième génération d’artistes acadiens professionnels. Pour la plupart, nos référents, nos influences, sont ces premiers poètes. Ce sont eux qui nous amènent à l’écriture. Ce n’est pas forcément quelque chose de conscient: à un moment tu te le fais dire, tu en prends conscience et oui, ça s’inscrit dans ta démarche. J’appartiens à ça, je suis défini par ça. Pour moi l’Acadie n’est pas un prétexte.
Il y a le thème de la colère également que l’on retrouve dans notre littérature. Herménégilde Chiasson disait que la présence de la colère revient dans la littérature acadienne. C’est entre autres palpable dans les œuvres de Jonathan Roy, de Sébastien Bérubé, de Monica Bolduc, de Joannie Thomas et de Dominic Langlois.
Quelles sont les œuvres majeures que les lecteurs devraient connaître?
J’irai des œuvres incontournables et majeures pour moi.
Moncton Mantra de Gérald Leblanc chez Prise de parole. Un roman qui raconte les débuts de la littérature acadienne. Il s’agit là de la genèse d’une littérature contemporaine. Celui qu’on surnomme le Miron de l’Acadie a été très actif dans le développement de notre littérature. Sa mort en 2005 laisse encore une forme d’aura, son influence laisse une trace indéniable.
Acadie rock de Guy Arsenault aux éditions d’Acadie. C’est le deuxième livre à avoir été édité et publié en Acadie. Il est écrit en chiac, dans une langue révoltée. Arsenault était jeune au moment de la rédaction, il avait alors entre 16 et 18 ans. Le texte est néanmoins d’une maturité et d’une brutalité formidable.
Une lettre au bout du monde de Jean-Philippe Raîche, Éditions Perce-Neige. Une des plus grandes plumes de l’Acadie, une des plus méconnues également.
Alma de Georgette Leblanc, Éditions Perce-Neige. Auteure très primée qui a décidé de s’inventer dans le parler de la Baie-Ste-Marie. À la fois charnel, sensuel, doux, tendre.
Où sont les scènes locales pour vivre la culture littéraire acadienne?
Il y en a plusieurs! Je pense au Festival de poésie de Caraquet, au Centre culturel Aberdeen de Moncton, le Salon du livre de Shippagan, le Festival acadien de poésie, le Festival Frye à Moncton, le Festival Acadie Rock et beaucoup d’autres lieux en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard qui ont des scènes littéraires moins imposantes, mais importantes. Il y a aussi une foule de scènes musicales. Il y a des gens qui sont là et qui créent, on vit une réelle effervescence.
Tu es à la fois poète, comédien, dramaturge et musicien, mais c’est à titre de nouvelliste que tu as remporté la médaille d’argent aux Jeux de la Francophonie. Comment conjugues-tu le tout?
À la base, Char est un monologue de théâtre. Je l’ai adapté en nouvelle afin de la soumettre au comité de sélection. Les Jeux de la Francophonie m’ont offert l’opportunité de m’exercer à l’écriture de la nouvelle. Il y avait plusieurs questions pendant le travail : comment trouver ma voix là-dedans, comment forcer la langue, je ne l’aurais pas fait si l’occasion n’avait pas été lancée!
À la base, je suis comédien. Je me considère plus comme un comédien qui écrit et non comme un auteur qui joue. Tout se relie à la scène; le rapport à l’écriture se fait en fonction de comment rendre le texte sur les planches, je pense l’oralité dans l’écriture, le rapport aux mots change parce que je fais de la scène, mais l’inverse est aussi vrai. La rigueur est devenue autre. Quand je lis, dis, comprends un texte, tout d’un coup il y a plein de nuances qui apparaissent. L’un nourrit l’autre et le temps finit par se partager entre l’écriture et le jeu.
Très rapidement dans ma formation, je me suis rendu compte que c’était très peu probable que je fasse de ce métier ma carrière. La création est devenue une nécessité pour vivre, mais pas seulement en tant que donnée alimentaire.
Être sur scène, c’est un privilège parce qu’il y règne un esprit de liberté absolue. Ça ne veut pas dire faire n’importe quoi, mais tu peux faire à peu près ce que tu veux, pourvu que tu l’assumes. Cette liberté-là, elle est précieuse. Et puis, ça se transpose dans l’écriture. J’écris dans une révolte contre ce qui est impossible : dans l’écriture, je me permets souvent tout ce qui ne se peut pas. L’écriture devient la place pour pulvériser l’impossible.
Qu’est-ce que ça signifie pour toi d’avoir représenté ta province auprès de 84 états de l’Organisation internationale de la Francophonie?
Certainement une source de fierté. J’ai grandi au Nouveau-Brunswick, le fait que je viens de là définit beaucoup ce que je fais. Certaines choses appartiennent à ma démarche et ne peuvent être faites que parce que je suis né et parce que j’ai grandi dans ce contexte-là. En allant aux Jeux de la Francophonie, tu deviens porte-parole, porte-drapeau de quelque chose de plus grand que toi. Je veux être digne de ça, parce que c’est important, c’est un privilège.
Côté carrière, c’est aussi majeur. Je n’avais jamais été en Afrique. Ce sont 24 univers de partout dans le monde qui se rencontrent physiquement, 24 personnes qui partagent l’écriture; ça provoque de grandes rencontres. Chaque représentant a une façon de penser, de concevoir la langue. Le discernement dans les manières de parler est fait avec respect, on mise sur la façon que chaque endroit a de bonifier, rendre cette langue riche, vivante.
Les médias font souvent une polémique, de faux débats, autour de ça et ça crée beaucoup de complexes d’infériorité chez certains francophones. La question de la délégitimisation de la langue par certaines cultures qui en réclament la pureté, c’est nuisible. Il est bon de se sentir chez soi dans la langue, important de reconnaître la multiplicité de la francophonie. Affirmer qu’une langue n’est pas bien parlée par certaines nations, c’est contre-productif et dangereux pour l’assimilation.
Quel est le dernier livre enlevant, marquant que tu as lu?
Le sous-majordome de Patrick deWitt chez Alto. Une écriture décalée qui ne ressemble à rien!
Nonobstant les lois du marché, quel(s) genre(s) voudrais-tu voir prendre plus de place en librairie et pour quelles raisons?
La poésie et le théâtre parce que ce sont les genres oubliés, mythifiés et mystifiés à la fois pour de mauvaises raisons dans l’imaginaire collectif. Je n’aime pas qu’on nous enseigne ces genres comme inaccessibles. L’idée de les voir prendre plus de place en librairie serait un indicateur qu’ils prennent plus de place chez les gens et cette fausse piste de la mystification serait de plus en plus abolie. Même chose pour le théâtre qu’on nous présente comme art qui est fait pour être vu et non lu. Au contraire, c’est la trace de quelque chose qui est fait pour être vivant. Les voir de plus en plus présents en librairie serait un indicateur que les gens ont besoin de cette littérature vivante, et c’est intéressant comme perspective.
Par ailleurs, il faut dire qu’en Acadie, les lecteurs sont très gâtés par les libraires qui soutiennent les maisons locales et qui s’intéressent à ces genres-là. Comme c’est la production majeure, ils sont capables de la défendre. Les recueils sont bien en vue, bien en place.
Quelles sont la ou les libraires indépendantes que tu fréquentes d’Ottawa au Nouveau-Brunswick?
La librairie du soleil à Ottawa, Matulu à Edmundston, La grande Ourse à Dieppe, Pélagie quand je suis dans les environs d’une des trois succursales, mais surtout celle de Caraquet, Pantoute à Québec, Le Port de tête à Montréal et À la page à Winnipeg.
(extrait de la nouvelle Char, par Gabriel Robichaud)
C’était pas son char. Au conducteur. C’est comme ça qu’y nous l’a raconté. Un jour y faisait du pouce pis y avait quelqu’un qui était arrêté sur le bord du chemin. Ce quelqu’un-là était sorti, lui avait donné la clé du char, lui avait dit de le prendre, pis y était parti en marchant. Comme ça. Sans rien ajouter. Son char chanceux, que le gars disait. Le genre de char dans lequel t’as rien à craindre. Le genre de char qui te protège de tout. C’est pour ça qu’on est embarqués, le beau gars, la belle fille, pis moi. Même le gars dans le coffre, le courageux je suis sûr que ç’a eu un impact sur sa décision.
Celui-là, je le connaissais pas. Le courageux dans le coffre, je veux dire. Je l’ai jamais connu. On s’est pas vraiment parlé durant la soirée. Je t’avoue quand même que j’ai plus ou moins de peine pour lui. La rumeur voulait qu’un jour sa mère lui avait dit de pas partir de la maison. Que ça la tuerait, s’il le faisait. Pis qu’au moment de partir de chez elle, il lui avait répondu :
Alors c’est peut-être mieux que tu meures maman
Ça l’avait tuée sur le coup. Sa mère. C’est ce qu’on dit. Ça, pis que lui s’en était vite remis. Même si la mort de sa mère l’avait rendu orphelin. Fait que tu comprends que pour lui ça me fait moins de peine. Même si ça reste triste. On s’entend. Je sais rien de plus sur lui par contre. J’espère que c’est suffisant.
Les livres de Gabriel Robichaud :
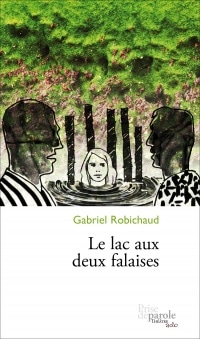
Mars 2016
Éditeur: PRISE DE PAROLE
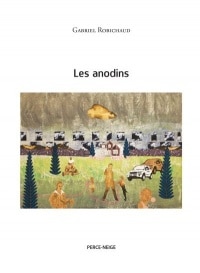
Juin 2014
Éditeur: PERCE-NEIGE
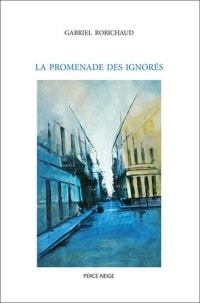
Mai 2011
Éditeur: Les Éditions Perce-Neige
















