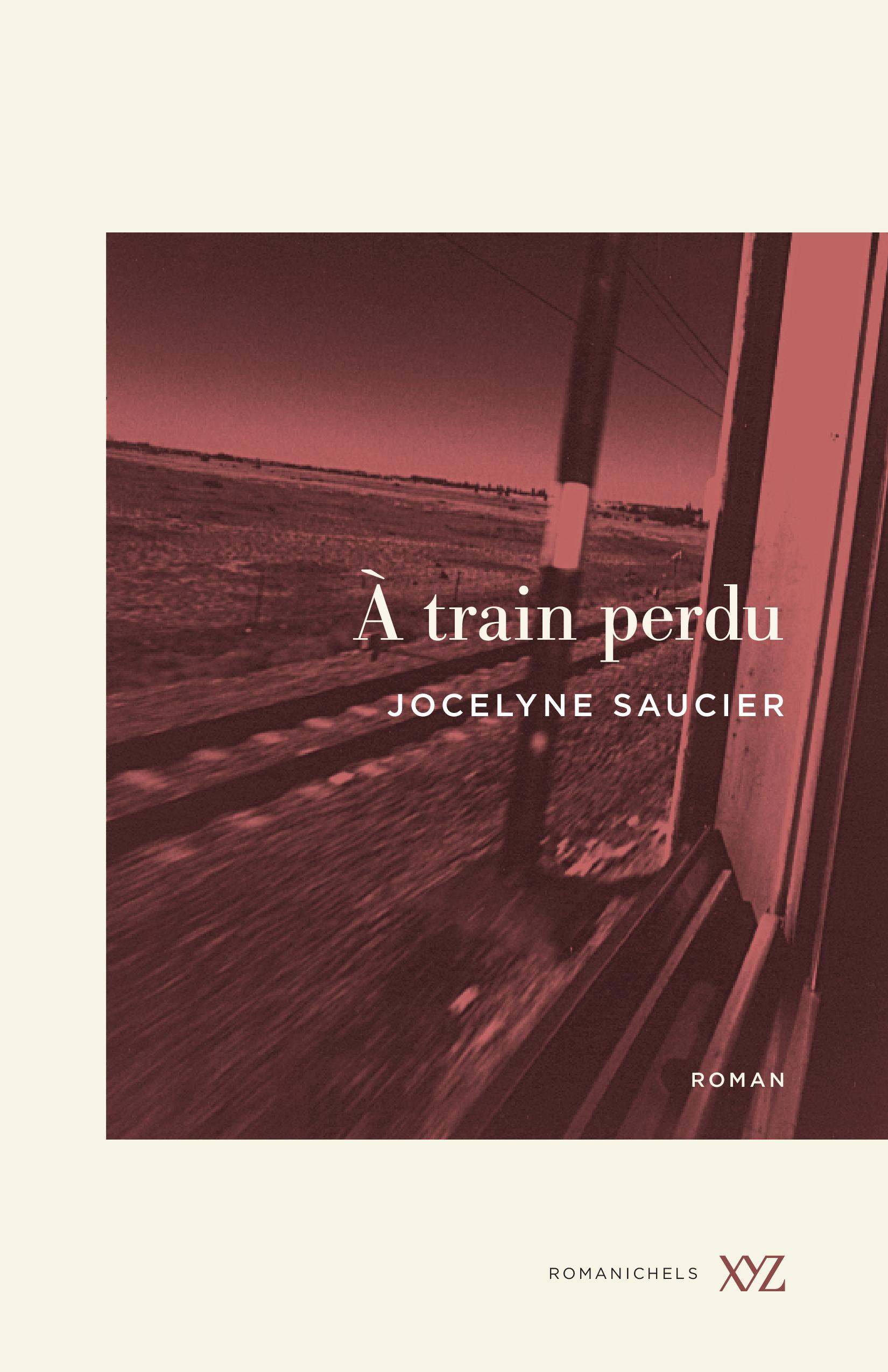Il en va d’une fable ferroviaire prenante, du récit d’errance d’une dame âgée qui porte en elle plus d’un secret. Disparu puis retrouvé, le personnage principal se dévoile à la manière d’un lent effeuillage de l’âme. Les gens sans histoire ne sont pas toujours là où on le croit.
« Une fois, j’ai pris le Northlander, le train qui fait Cochrane-Toronto, se souvient Jocelyne Saucier. J’étais en train d’écrire Il pleuvait des oiseaux et je voulais aller à Toronto pour chercher un lieu d’exposition pour les peintures de Boychuck. C’est un train du Nord, ça prenait neuf heures et comme c’est très lent, on était parfois immobilisés pendant une heure ou deux et les passagers se parlaient entre eux. Dans un siège en diagonale devant moi, il y avait une dame assez âgée, de 75 ou 80 ans. Elle avait sa glacière, des magazines, et elle n’a pas bougé de là tout le trajet durant. Elle n’a parlé à personne. Ça m’a intriguée. C’est cette personne-là qui est à l’origine du roman. »
Il était une fois à Swastika
Une simple recherche sur Google Map en fait foi : Swastika existe réellement. La bourgade se situe non loin de la frontière entre le Québec et l’Ontario, à 83 kilomètres à l’ouest de La Sarre en Abitibi-Témiscamingue. Une curiosité toponymique savoureuse, mais à jamais associée à ce symbole détourné puis devenu infâme, à la croix gammée d’Hitler et ses sbires, à l’araignée à quatre pattes qui effrayait Gretl dans La mélodie du bonheur.
Or, Swastika, c’est aussi ce village au nom improbable qui se fait le théâtre de la nouvelle histoire de Jocelyne Saucier, la poète des grands espaces accoutumée à la mise en lumière de ces territoires méconnus.
« Ça fait longtemps que je me promène dans le nord de l’Ontario à la recherche de quelque chose, un peu comme le personnage de Léonard Mostin. Je savais que j’y écrirais un roman, mais je ne savais pas quoi. Puis, un moment donné, j’ai obtenu une bourse de résidence itinérante et j’ai loué une chambre chez des gens à Swastika. Je me suis sentie comme une étudiante. […] On ne va pas au nord de l’Ontario pour la beauté de l’arrière-pays ou de l’architecture, mais Swastika, c’est beau. C’est vallonneux, il y a une petite rivière… C’est charmant. »
Au crépuscule de la vie
À l’instar de son livre transposé à l’écran par Louise Archambault il y a un an, Il pleuvait des oiseaux en l’occurrence, cet ouvrage tout frais fait la part belle aux aînés. Ce n’est pas parce qu’on gagne en âge que notre existence se trouve dénuée de tout romantisme, d’aventures amoureuses étourdissantes, d’escapades enivrantes. Bien au contraire.
« Je ne me donne pas une mission en ce sens-là. En fin de compte, écrire un roman, c’est créer de la vie. Au fur et à mesure, tout s’enchaîne. C’est après que je me rends compte que j’ai encore parlé de ça. […] Je crois qu’on écrit sur des choses sur lesquelles nous nous questionnons et pour lesquelles on n’a pas de réponse. On va vers l’inconnu. »
Après s’être cantonnée au passé, au lustre d’une enfance nomade à bord du school train de son père enseignant, c’est comme si la Gladys de Jocelyne Saucier avait voulu rattraper les ans perdus. Promise à un futur brillant, la fille du clan Campbell s’est finalement échouée à Swastika, abruptement changée en veuve avant que sa propre héritière ne se prête à un sempiternel flirt avec la mort. Suicidaire et dépressive, sa Lisana n’a finalement jamais su voler hors du nid ni même se prendre en main, privant ainsi sa mère des bonheurs simples d’une retraite bien méritée.
Délestée de la peine de celle qu’elle a mise au monde, Gladys s’est risquée à un voyage tout autant géographique qu’intérieur, animée par une quête nébuleuse que l’autrice sonde durant ces 264 pages. Un parcours cahoteux, mais ponctué de plaisirs contemplatifs, de petits bonheurs perdus.
« Dans la vie aujourd’hui, on n’a plus de temps à perdre, on est toujours en contact avec quelqu’un, sur nos téléphones… On n’est jamais là où on est. À ne rien faire, la réflexion vient par elle-même et on prend possession de soi. »
Introspectif et enlevant tout à la fois, À train perdu nous reconnecte à l’essentiel. Cette lecture, plus que n’importe quelle autre, s’impose comme un temps d’arrêt. Une halte dans le quotidien.
Photo : © Ariane Ouellet