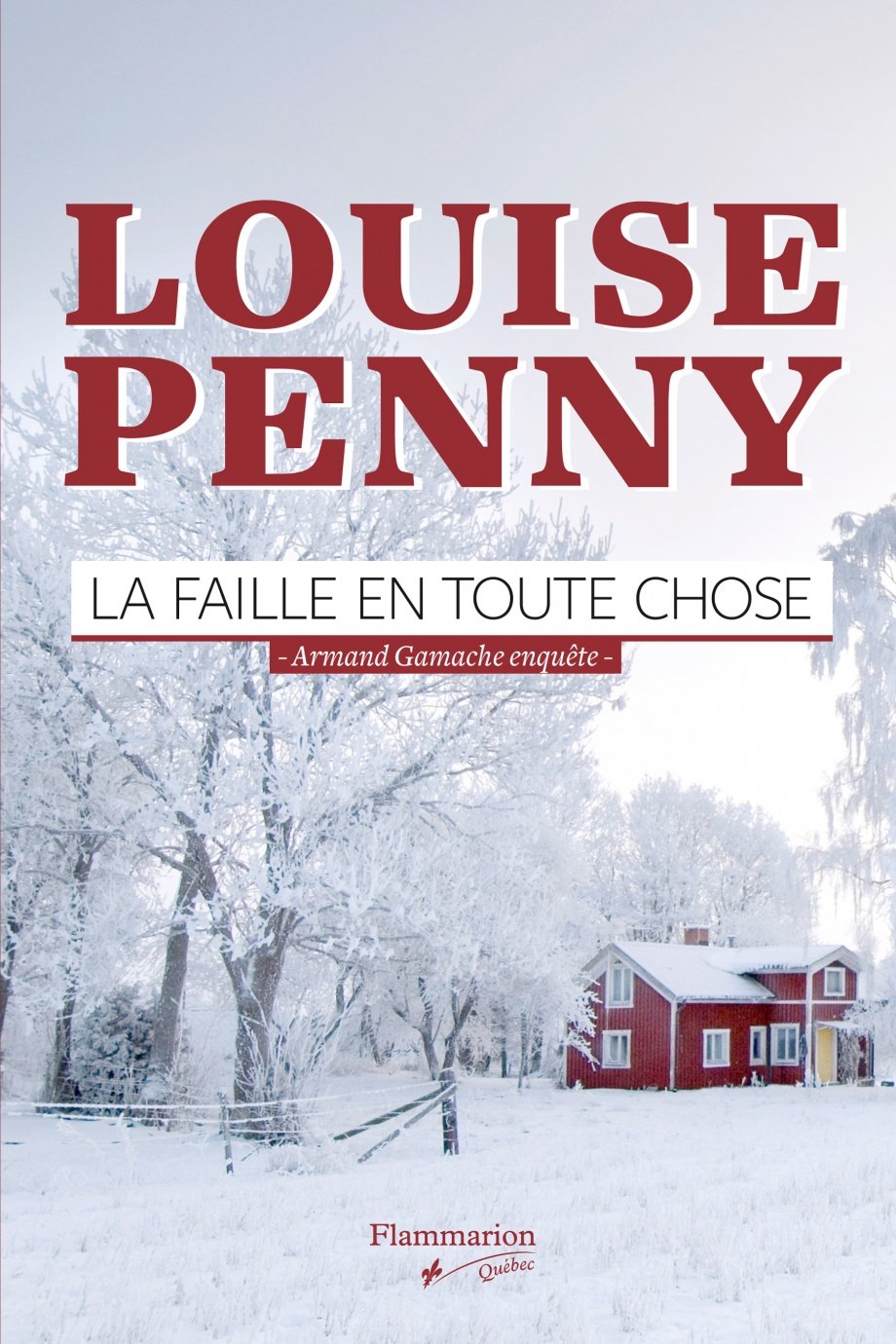Il y a ces auteurs qui, au-delà de ce qu’ils écrivent, inspirent par ce qu’ils sont. Il en va ainsi pour moi de Louise Penny, depuis notre première rencontre en 2016, à l’occasion de la publication de La nature de la bête, onzième enquête d’Armand Gamache. Ses choix de vie, son parcours d’écrivaine, sa façon d’aborder l’écriture, son regard sur l’humain : il existe des similitudes entre nos deux routes, ce qui me la rend familière et accessible; mais aussi, des différences — et là se trouve l’inspiration. D’un côté, donc, ces choses que je partage avec elle (peut-être communes à bien des romanciers, mais qu’il est si bon d’observer chez un autre). De l’autre, celles que je voudrais atteindre… disons, quand je serai grande.
J’avoue que peu avant ma première rencontre avec elle, je connaissais surtout son œuvre… à travers les louanges que m’en faisaient ses fans. En guise de préparation, j’avais donc plongé dans ses livres. Un exercice qui peut sembler fastidieux, mais qui est en fait un privilège : lire roman après roman en une courte période de temps, c’est assister en accéléré à une naissance. À des naissances, plutôt. Celles d’un univers qui s’étoffe, de personnages qui gagnent en relief et profondeur, d’intrigues qui se complexifient alors que le maître d’œuvre prend du métier. Oh, les fondations de ce qui deviendrait le village de Three Pines et l’esprit d’Armand Gamache, alors inspecteur-chef à la Sûreté du Québec, étaient là dès le départ. Louise Penny les a raffinées et renforcées. De l’avis de plusieurs, Maisons de verre, lancé plus tôt cette année en français, est son meilleur roman. C’est son treizième. Mais. « Attendez de lire Kingdom of the Blind », glousse Lise Desrosiers, l’assistante de la romancière, en faisant référence à la prochaine enquête d’Armand Gamache, qui sort en novembre et nous arrivera l’an prochain en traduction.
C’était lors de ma récente rencontre avec Louise Penny. Nous nous étions installées autour de la table en pin qui lui sert de bureau. Une de ces longues tables où l’on reçoit convives et amis, pour partager nourriture et conversations. Une table qui est depuis un siècle dans la famille de son mari, Michael Whitehead. Celui-ci est décédé le 18 septembre 2016 des suites d’une démence qui l’a peu à peu privé de tout ce qu’il avait été. Louise Penny l’a accompagné jusqu’au bout, l’a entouré et aimé. Dans les semaines qui ont suivi la mort de celui avec qui elle a partagé vingt-deux années de vie, elle a pensé qu’elle ne pourrait plus jamais écrire. En fait, elle se demandait comment elle pourrait survivre sans lui. Avant de comprendre, au fil des semaines, qu’elle le retrouverait justement là. Dans l’écriture. En particulier dans le personnage d’Armand Gamache, dont la droiture, la bonté, l’éthique ont été puisées dans l’essence même de Michael. « Je me suis remise au travail et c’est un peu comme s’il était devenu immortel. » De toute manière, Michael est partout dans cette maison qu’ils ont choisie ensemble. Elle se tourne légèrement et me montre le portrait d’un enfant aux boucles blondes sur une toile : « C’est Michael… quelques années avant que je le rencontre ! Son grand-père, Richard Jack, faisait partie de la Royal Academy of Arts de Londres et il a peint ce portrait. »
C’est donc là, dos à la cuisine, en marge de la vaste salle à manger/salle de séjour, Bishop (son golden retriever) à ses pieds, que l’écrivaine convoque sa famille littéraire : ses personnages. Le rendez-vous est quotidien, matinal et il dure environ trois heures. Ça me rappelle ce que Dennis Lehane m’a déjà dit : « Après ça, il est temps de passer à un autre genre d’écrits : signer des chèques, répondre au courrier, relire et corriger, faire des recherches. » Je suis à fond dans ce modus operandi : au bout de ce bloc d’intensive création, je n’ai que du jus de cerveau sous le crâne. Louise Penny éclate de rire. Avant d’ajouter que, comme elle est très goal oriented, elle se fixe aussi un objectif : elle n’éteint pas l’ordinateur avant d’avoir écrit 1 000 mots. Je comprends le principe : elle et moi avons un passé de journaliste (elle a travaillé dix-huit ans pour la CBC, j’en ai passé vingt-huit à La Presse), cela teinte à jamais bien des aspects d’une vie — dont l’écriture — et ça alimente le côté cartésien qui côtoie l’artiste en nous.
Parlant de l’artiste. Quand le découragement pointe, lorsque les hésitations prennent le pas sur le flot des mots, Louise Penny lève les yeux et regarde le cadre accroché sur le mur d’en face. On y lit deux mots en latin. Noli timere. N’aie pas peur. Les dernières paroles prononcées par le poète irlandais Seamus Heaney. Dans mon cas, ce sont deux petites toiles de mon ami Robert Lamarche, intitulées Out of Time et Tu comptes. Mais alors qu’en panne, je me réfugie dans Écriture : Mémoires d’un métier de Stephen King ou dans Mes secrets d’écrivain d’Elizabeth George, Louise Penny, elle, se coule dans les livres de poésie posés non loin d’elle. Et puis, il y a le carnet. À la droite de l’ordinateur. Indispensable à l’aventure. Sur la page couverture de celui-ci, elle a écrit « Book 15 ». Il y en a un pour chaque roman. Ils sont pourvus de séparateurs : une section concerne l’intrigue; une autre, les personnages; une troisième, des citations ou des vers; enfin, les dernières sont chargées de flashs divers. Elle vient de commencer celui qui servira au livre 16, même si elle ne se mettra pas à l’écriture de ce roman avant bien des mois. Les idées sont trop précieuses pour risquer de les perdre. J’abonde avec force. « Vous fonctionnez ainsi, vous aussi? » En guise de réponse, j’ouvre mon sac, en sors le carnet du moment.
Nous avons aussi, elle et moi, adopté les Cantons-de-l’Est. Ma maison jaune se trouve aux abords du village voisin de celui où est plantée la sienne (oui, jaune). La lumière y entre à flots. L’épicerie, la librairie, le café, tout est à distance de marche. Et elle aime marcher, Louise Penny. « Mais là encore, j’ai besoin d’un but. Me promener juste pour me promener, je ne peux pas. » Avec un but à l’horizon, les idées acceptent de sortir du néant. Il en va de même qu’elle soit en auto, en train, en avion : elle écoute de la musique (chaque roman possède sa playlist; il en va — bien sûr — ainsi pour moi également), ferme les yeux (non, pas quand elle conduit!) et, une fois de plus, les problèmes de l’intrigue en cours trouvent une solution, un personnage sort de l’ombre et se fait plus menaçant que prévu ou, au contraire, se révèle du beau côté de l’humain.
Parce que si des événements horribles se produisent dans les pages qu’écrit Louise Penny — autrement dit, les gens n’y meurent pas de mort naturelle —, le sentiment que dégagent ses romans en est, paradoxalement, un de réconfort. Ouvrir un livre et se retrouver ainsi au village de Three Pines, en compagnie de Ruth, la vieille poète acariâtre ; de Clara, l’artiste peintre échevelée ; de Myrna, la libraire au passé de psychologue ; entrer dans le café de Gabri et Olivier où Armand Gamache et Reine-Marie, son épouse, sont probablement attablés… Ouvrir un livre et retrouver cela et ceux-là s’accompagne de la douce sensation de rentrer à la maison. « C’est parce que Three Pines n’est pas un endroit, c’est un état d’esprit. » Elle m’avait dit cela lors de notre première rencontre, alors que nous étions allées sur les lieux qui lui ont inspiré ceux de ses romans, et qui se trouvent à Sutton, à Sutton Junction, à Knowlton, à Georgeville, à Saint-Benoît-du-Lac, à North Hatley (il existe d’ailleurs une carte pour qui veut les découvrir en solo et des tours guidés pour qui cherche l’expérience de groupe).
Je lui rappelle cette citation. Elle est ravie que je n’aie pas oublié. Comment aurais-je pu ? C’est si beau. « C’est aussi très vrai. Three Pines est un endroit qui, je crois, existe de manière plus profonde que seulement physique. C’est l’endroit où je vais quand je choisis d’être bonne, quand je suis tentée d’être cruelle ou cynique, mais que j’opte pour la gentillesse et le soutien. Je m’y sens calme, apaisée. Aller à Three Pines me rappelle d’où je viens, ce à quoi j’appartiens. C’est me souvenir du pouvoir de l’amitié et de l’importance du foyer. » Un sentiment, un état d’esprit qui dépassent les frontières : Louise Penny, qui écrit en anglais, est traduite en vingt-trois langues. Elle a des fans un peu partout sur la planète. Beaucoup d’entre eux, chez nos voisins du Sud. Et, parmi ceux-là, celle qui a failli devenir la première femme à diriger les États-Unis.
La romancière avait entendu dire que la candidate démocrate aux élections présidentielles de 2016 aimait ses livres. « Mais je ne m’attendais pas à recevoir une lettre de condoléances de sa part quand Michael est mort. » Un mot très personnel, qu’aucune obligation ne dictait. « Je respectais déjà cette femme, mais là, j’ai été profondément touchée par un tel acte de gentillesse, complètement altruiste — après tout, je ne peux pas voter! » Une amitié est née. Louise Penny se trouvait dans le quartier général des Clinton, à New York, lors de la fameuse soirée électorale qui a porté Donald Trump au pouvoir. « Une nuit terrible. » Elle a par la suite été invitée à leur maison de Chappaqua. À son tour, elle les a reçus chez elle et, il y a quelques semaines, Hillary Clinton était là quand Louise Penny a franchi le cap de la soixantaine.
Un âge auquel certains pensent à prendre leur retraite ou, au moins, à passer à un rythme de travail moins intense. Pas elle, même si elle pourrait décider de publier moins : un roman par année n’est pas une mince affaire. Mais écrire, c’est elle, c’est sa vie depuis… depuis que Michael, alors chef du service d’hématologie à l’Hôpital de Montréal pour enfants, connaissant ses aspirations d’écrivain, l’avait encouragée à quitter son emploi afin de ne plus pouvoir se réfugier derrière le manque de temps et la fatigue pour expliquer que ses projets littéraires n’avançaient pas. Elle y a pensé, puis a donné sa démission à Radio-Canada. « Et je n’ai pas écrit pendant cinq ans. » Pourquoi? « J’essayais d’écrire le meilleur livre jamais écrit ! » « Oh, celui-là! », ne puis-je m’empêcher de lancer.
Elle est passée par-dessus ce blocage grâce à un groupe d’artistes vivant dans le voisinage (en compagnie de ces femmes, elle a compris qu’il n’y avait pas de mal à amorcer, jeter, recommencer) et grâce au soutien constant de Michael pendant et après l’écriture de Still Life (qui, en français, deviendra En plein cœur) : le manuscrit sera rejeté par une cinquantaine d’éditeurs. « J. K. Rowling, Lucy Maud Montgomery, sortez de ce corps! », aurais-je envie de dire. Mais, toujours à l’écoute des autres, Louise Penny me précède : « Trouver un éditeur n’a pas été un problème pour vous? » Je suis presque gênée de dire que non, mais je le dis quand même. Et j’explique.
Je rêvais depuis toujours, comme elle, d’écrire de la fiction. J’étais, à l’époque, journaliste à la pige et mère d’un petit garçon. Les congés, je ne connaissais pas. La motivation m’est venue de mon conjoint (eh oui, moi aussi) et d’un concours littéraire : on me donnait un public cible, un nombre de mots, une date de tombée. J’allais prendre ça comme une commande parmi les autres. J’ai plongé. Soumis le manuscrit. Je n’ai pas gagné. Mais parmi les membres du jury se trouvait Raymond Plante, grand auteur et formidable éditeur aujourd’hui décédé. Il m’a prise sous son aile. « The rest is history », comme disent les Chinois (ha! ha!)… et Louise Penny. « Mais nous sommes sœurs de parcours! », remarque-t-elle. En désespoir de cause, elle a en effet envoyé Still Life au concours Debut Dagger, remis par la British Crime Writer’s Association au meilleur roman policier non publié. Quelque 800 aspirants écrivains avaient fait de même cette année-là. Son texte est arrivé deuxième et, du coup, les agents se sont bousculés pour prendre cette nouvelle venue dans leur écurie. Depuis, son rêve est devenu réalité.
Elle n’est donc pas à la veille de quitter Three Pines ! Moi, par contre, oui. J’ai déjà pris beaucoup de son temps. Mais je pars tranquille, sachant que je retrouverai le village/état d’esprit dès que je replongerai dans les écrits de Louise Penny, dans un de ses romans qui sont comme autant de Welcome home.
Sonia Sarfati
Journaliste pendant près de trente ans à La Presse, chroniqueuse et romancière, Sonia Sarfati, qui collabore aussi à la revue Les libraires comme journaliste, a publié plus d’une quarantaine d’albums et de romans jeunesse. Son roman Comme une peau de chagrin (La courte échelle), un classique de la littérature jeunesse, a été couronné du Prix littéraire du Gouverneur général. Elle a aussi publié notamment Le pari d’Agathe (Québec Amérique), la série « Laurie l’intrépide » (Boréal), Kipp kangourou (La Bagnole) et Quatre contre les loups (L’Homme). Ces deux derniers livres sont illustrés par son fils Lou Victor Karnas. Elle a aussi écrit Baie-des-Corbeaux (La courte échelle), un livre rythmé, empreint de mystère et de suspense, dont la suite intitulée L’arbre aux sorcières paraîtra en 2019 à La courte échelle. L’auteure nous fait cette fois-ci découvrir l’univers de Louise Penny.
Photo de Louise Penny et de Sonia Sarfati : © Lise Desrosiers
Autres photos : © Sonia Sarfati
Photo de Sonia Sarfati : © Chantale Lecours