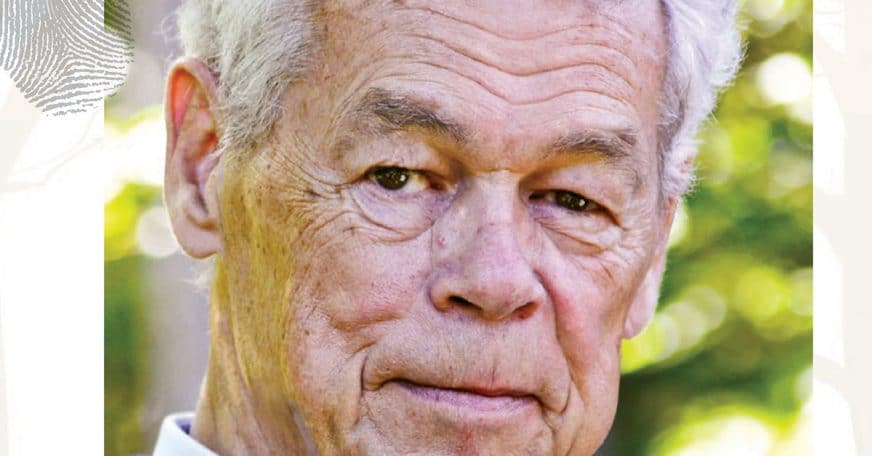Quand on s’est vus cet automne, pour la première fois depuis quelque temps, Jean-Jacques Pelletier affichait un sourire en coin. Témoignage de l’espièglerie du garnement content de son plus récent coup pendable ou marque du soulagement de celui qui sait son devoir enfin accompli? Qui saurait le dire? À en juger, cependant, par le nombre d’inconditionnels venus faire la queue aux stands des éditions Alire lors du dernier Salon du livre de Montréal, la satisfaction de l’écrivain était manifestement partagée par les mordus de ses romans, dont les intrigues mêlent politique, économie et espionnage.
Ceux qui connaissent l’écrivain ne s’étonneront pas qu’au terme d’un cycle romanesque de 5000 pages, il puisse déjà considérer son œuvre monumentale comme un tout plus grand que la somme de ses parties. «La conception de l’ensemble s’est faite en deux étapes, raconte Jean-Jacques Pelletier. Pendant que j’écrivais L’homme trafiqué [un texte antérieur, situé dans le même univers romanesque], j’ai compris progressivement que je voulais donner une dimension internationale et géopolitique au roman, ce qui m’a amené à explorer le territoire ambigu qui va des multinationales aux groupes criminels d’envergure mondiale.»
Animé de la volonté d’échapper aux contraintes du roman d’espionnage traditionnel dès ses premières œuvres (L’homme trafiqué, La femme trop tard, Blunt), qui le conduiraient ensuite aux «Gestionnaires…», Pelletier s’est escrimé à intégrer des éléments du roman noir, de la psychologie et des portraits de milieux sociaux, ainsi que des informations techniques dans des domaines spécialisés. «Après la sortie de Blunt, j’ai eu l’idée de La chair disparue puis des » Gestionnaires… « , se remémore l’écrivain. Bien sûr, il y avait toutes sortes de nouveautés, notamment l’opposition entre le Consortium et l’Institut, les Clones, un héros doté de personnalités multiples… Mais j’avais aussi la volonté de tout enraciner dans les trois précédents, de manière à ce que ce soit le même univers qui se développe.»
À la lumière des sujets abordés dans ses romans (trafics illicites de diamants et d’organes humains, magouilles financières, complots terroristes, manipulations diverses), on pourrait croire Pelletier cynique, voire désespéré du genre humain. Ce n’est pas nécessairement le cas. «Ça m’étonne toujours de voir à quel point l’humour qu’il y a dans mes romans semble passer inaperçu, déplore-t-il. C’est vrai que l’humour — surtout dans La faim de la Terre — glisse du côté de l’ironie et de la dérision. Mais je ne crois pas être désabusé. Ni pessimiste. En fait, il faut un certain optimisme pour publier des pavés de 1500 pages et croire que des gens vont les lire!»
À quoi sert la littérature?
Il n’est pas inutile de rappeler que parallèlement à sa carrière littéraire (qui ne se limite pas à ces thrillers politico-économiques hyperréalistes), Jean-Jacques Pelletier a enseigné la philosophie au collège, a écrit des ouvrages sur la finance et la gestion des caisses de retraite et même œuvré dans le domaine syndical. Un parcours assez rare dans le milieu littéraire québécois, qui témoigne de l’insatiable curiosité de Pelletier et de sa volonté de saisir et d’appréhender le monde dans lequel il vit dans toute sa complexité. À quoi sert la fiction, pour lui? «Un récit permet de rendre visibles des effets de système en les attribuant à des intervenants précis, en explicitant les enjeux et les intérêts à l’aide d’oppositions, en présentant les événements et les actions à l’intérieur d’une chaîne causale… Il permet également
d’imaginer ce que serait une résolution des situations de crises qui ont été mises en scène. Ce faisant, il nous donne un certain sentiment de contrôle sur les situations problématiques abordées dans le roman. La fiction, c’est le laboratoire de la recherche par l’imaginaire. On y construit des simulations, des modèles, pour apprivoiser le réel», répond-il.
Peut-être est-ce pour cette raison que la série de Pelletier, qui donne l’impression de carburer à la théorie du complot, peut inspirer une certaine angoisse au lecteur impressionnable. «C’est un peu inévitable qu’un roman crée un certain malaise, reconnaît l’architecte des » Gestionnaires… « . C’est précisément son rôle. Parce que sans inquiétude, on ne construit rien de neuf. Au mieux, on perfectionne un peu les gadgets courants. Pas de complot global, donc, pas de paranoïa. Mais pas de naïveté. Il existe des magouilles. Je dirais que la lucidité se méfie autant de la paranoïa que des lunettes roses.»
Assez paradoxalement, on peut dire que Jean-Jacques Pelletier aura campé un groupe de «méchants» dont l’analyse des faillites de la société contemporaine était au fond assez juste. «C’est particulièrement vrai que, dans le roman, les grands responsables du terrorisme sont ceux qui paraissent faire la lecture la plus lucide de la réalité, reconnaît-il. Mais [leurs opposants] de la Fondation font une analyse assez similaire. Et je dirais qu’ils poussent l’analyse un peu plus loin, puisqu’ils ne s’arrêtent pas aux symptômes, mais qu’ils travaillent sur les causes. Et je crois que leur analyse est plus juste. Les membres de la Fondation veulent plutôt soigner les causes sociales des catastrophes humanitaires. Pour eux, l’être humain n’est pas réductible à un comportement biologique inévitable; c’est un être culturel qui peut changer ses pratiques sociales et économiques.»
Tout intellectuelle que soit la démarche de l’écrivain, il n’a jamais négligé l’aspect proprement romanesque de ces œuvres qui mettaient en opposition des justiciers à la psychologie aussi finement esquissée que celle de leurs sombres antagonistes. «On a l’habitude d’opposer les œuvres centrées sur l’intrigue et celles qui sont centrées sur les personnages, constate-t-il. Dans le cas de mes romans, je pense que cette opposition ne tient pas. Non seulement les personnages principaux et secondaires reviennent et s’approfondissent, mais même les personnages tertiaires ou occasionnels (particulièrement les victimes) font l’objet de longues mises en situation qui constituent, en quelque sorte, de courtes nouvelles insérées dans le roman.»
Au terme d’une aventure de création échelonnée sur une vingtaine d’années, cette satisfaction du devoir accompli que j’évoquais plus tôt se colore d’un petit vague à l’âme pour Jean-Jacques Pelletier, ainsi qu’il me le confie candidement, lié une certaine perplexité: «Oui, l’auteur s’attache aux personnages, il s’en
sépare souvent avec difficulté bien que fréquemment, et en terminant la série, il s’arrange pour les laisser dans une situation qui soit correcte pour eux. À la réflexion, l’attitude de mon inspecteur Théberge face aux morts me semble révélatrice de celle de l’auteur à l’endroit de ses personnages… morts ou en sursis. Ça fait sans doute partie du deuil qu’implique le fait de quitter un univers qu’on a habité pendant aussi longtemps.»
Bibliographie :
La faim de la terre (t. 1), Alire, 784 p. | 18,95$
La faim de la terre (t. 2), Alire, 848 p. | 18,95$