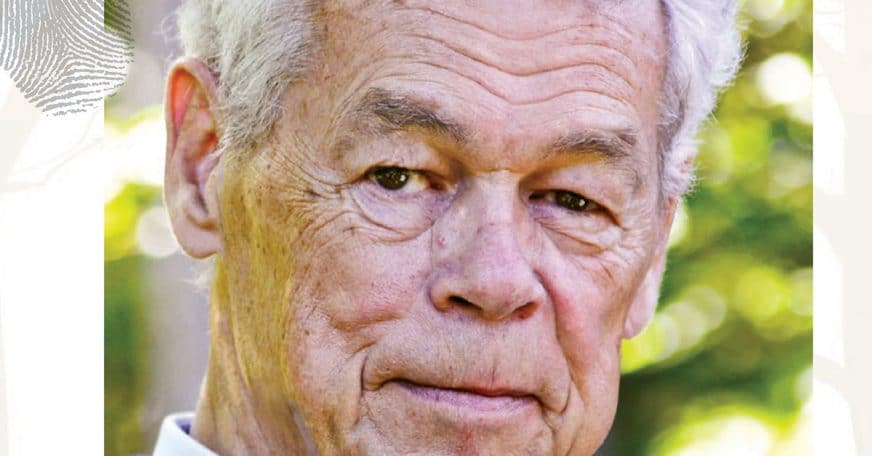Qu’est-ce qui vous a donné le goût d’écrire sur l’époque de l’après-guerre? Qu’est-ce qui vous attirait particulièrement?
Je voulais que mon livre soit un hommage aux polars classiques, comme ceux de Raymond Chandler. En le lisant, en m’inspirant pour créer mon propre projet, j’ai compris que le roman noir, c’est d’abord une ambiance et des personnages typés. Ça prend des bars enfumés, des policiers corrompus, un détective torturé, des problèmes de femmes et de boisson, du désespoir.
L’époque de l’après-guerre à Montréal était idéale pour y camper une telle intrigue. Il y avait les établissements clandestins du Red Light, l’incertitude sociale et politique de l’après-guerre, les scandales de malversation qui ont culminé vers la commission Caron. C’était aussi l’époque des policiers dépravés qui faisaient semblant de cadenasser des maisons de débauche, celle des descentes dans les bars illégaux, celle des croisades contre le vice et de l’escouade de la moralité de Pacifique Plante. C’est un pan de notre histoire qui est éminemment riche et inspirant, surtout si on veut écrire des romans sombres et faire des clins d’œil aux grands noms du polar.
Outre cela, ce qui a cimenté mon choix d’époque, c’est toute l’histoire des premières femmes dans la police. L’escouade de la moralité juvénile dont je parle dans mon livre — même si j’y intègre des personnages fictifs — a vraiment été créée en 1947. C’était une initiative de Pacifique Plante et, comme on peut tristement s’y attendre, ça n’a pas nécessairement été bien reçu. Il y avait déjà eu des femmes dans la police auparavant, mais jamais de manière permanente. C’était un milieu incroyablement sexiste, à tel point que même les secrétaires, un métier qu’on associe souvent au genre féminin, étaient des hommes. Ils n’en voulaient pas, des femmes; ils souhaitaient rester entre eux et que les choses ne changent pas. Pacifique Plante a fait table rase de tout ça et leur a imposé une brigade féminine qui a perduré, qui a pavé le chemin pour les personnes s’identifiant femmes dans les corps policiers et armés d’aujourd’hui. Lorsque j’ai entendu parler de l’escouade de la moralité juvénile pour la première fois, je me suis dit qu’il fallait absolument que mon premier roman se déroule en 1947 pour que je puisse aussi aborder cet aspect-là de l’histoire de la ville et de celle des femmes. C’était impensable pour moi de procéder autrement.
Pourquoi avez-vous eu envie de camper votre histoire entre autres dans le quartier du Red Light? En quoi ce quartier vous inspirait-il?
Les quartiers disparus exercent une fascination sur moi. La simple notion de ruine, je trouve ça inspirant! Si on a beaucoup de territoires fantômes qui ont été rasés au nom de la salubrité et de l’embourgeoisement, il y en a peu qui rivalisent, en matière de richesse historique liée à la criminalité, avec le Red Light. Ce quartier-là a été, pendant longtemps, une institution de Montréal. La métropole était une véritable capitale du crime organisé, qui pouvait rivaliser en prestige et en pouvoir avec New York! Les films de gangsters et de mafia, c’est le genre de production qui captive les gens d’ici. On a tous entendu parler d’Al Capone; c’est incroyable de penser qu’on a déjà eu des figures d’une aussi vaste importance à Montréal. Toute cette histoire a été balayée sous le tapis, en quelque sorte, au début des années 50; le pouvoir du crime organisé a changé de main plusieurs fois et les grands gangsters italo-américains ont réussi à prendre le contrôle de ce qui restait de notre Red Light. En plus, les établissements de débauche et de jeu ont été rasés pour faire place à ce qui est devenu le campus de l’UQAM, la Petite Italie et la Place des Arts. Toutes les traces de ce quartier ont été effacées; or j’ai l’impression qu’on se doit de lui faire mémoire. Sans le Red Light, la ville de Montréal telle qu’on la connaît aujourd’hui n’existerait pas.
Il y a une histoire riche à raconter de ce côté-là et, même si j’en parle très peu dans Brébeuf, je souhaite y consacrer des tomes subséquents. Par exemple, je voudrais écrire un roman portant sur le gambling illégal, celui qui était ciblé par l’escouade de Pacifique Plante; j’aimerais aussi en consacrer un à l’univers de la prostitution à Montréal. C’est une réalité qui a beaucoup changé, au fil des années, et qui était balisée de manière tout autre, dans le temps du Red Light. En fait, c’était ce à quoi on s’attend, quand on pense à des maisons de débauche, avec les « Madames », les bandits, les ampoules rouges en haut des portes. En gros, parler du Red Light, ça me permet d’aborder la question de la criminalité organisée à Montréal, mais aussi d’explorer des destinées féminines dans le contexte de l’après-guerre. C’est une véritable mine d’or pour une autrice de polars. Il y a tant à raconter!
Dans votre roman, plusieurs femmes travaillent, même si les hommes ne voient pas toujours leur présence d’un bon œil. Pourquoi était-ce important pour vous de leur donner cette place dans votre histoire?
Pour moi, il est crucial d’offrir une visibilité aux destinées féminines parce que ça contribue à les doter d’une légitimité. Plus on en parle, plus on a l’impression qu’on a le droit d’en parler, que ça mérite d’être sur la page. J’ai grandi en me faisant raconter les existences épatantes de mes grands-mères, qui étaient des femmes déterminées, courageuses et entêtées. J’ai toujours été fière de venir de cette lignée-là, et j’ai un respect absolu pour toutes celles qui se sont battues pour que je puisse avoir accès à une éducation universitaire, que je puisse choisir la carrière qui me convient, le ou la partenaire de vie qui me plaît. À l’époque où se déroule Brébeuf, les femmes travaillaient moins qu’elles le font aujourd’hui, mais elles bossaient quand même. Elles étaient là, même si on ne parlait pas d’elles. Il y avait des journalistes et des policières, des jeunes filles qui faisaient des études et des femmes de tête qui ne se laissaient pas écraser. Or ces vies-là, dans l’Histoire comme dans la fiction, sont souvent effacées au profit des destinées masculines.
En tant qu’autrice, je pense que je dois contribuer au retour de balancier. Je dois écrire des femmes parce que je veux lire plus de femmes. Pour cette raison-là, il était inconcevable pour moi de créer un univers policier sans trouver une manière d’y intégrer des filles.
Le genre que j’ai choisi posait problème, en ce sens. Traditionnellement, le roman noir est souvent assez réducteur à l’égard des femmes. Celles-ci sont reléguées à des rôles subalternes et dépendent des hommes autour d’elles. Elles doivent être sauvées ou elles sont là pour charmer les détectives. C’est tout. En tant que femme, je trouve ça insultant. Les personnes s’identifiant au genre féminin sont capables — et l’ont toujours été — de tellement plus! J’ai voulu créer des personnages féminins variés : des séductrices intelligentes, des combattantes fortes et compatissantes; bref, des personnages réalistes, riches, complexes, comme nous le sommes.
J’ai essayé de respecter le plus possible l’historicité de la chose et de donner aux femmes de mon roman des chances et des opportunités qu’elles auraient vraiment pu avoir dans le temps. Malgré tout, dans mon souci d’égalité et de mettre en scène une grande diversité de destinées féminines, je dois avouer que j’ai dû tricher. Par exemple, le personnage de Louise, la secrétaire de la Sûreté du Québec, est totalement inventé; à l’époque, les secrétaires dans la police étaient des hommes. Pour avoir une parité des genres, au sein de mon roman, j’ai décidé d’ignorer ce détail-là pour donner au personnage de Marcus O’Malley le type d’adjointe qu’il mérite : une femme qui pose des questions, qui n’a pas la langue dans sa poche, qui n’est pas impressionnée par ses niaiseries et ses fanfaronnades.
En plus de l’enquête sur les meurtres de jeunes garçons, on assiste à une rencontre de Léopold avec un psychiatre. Pourquoi avez-vous choisi d’ajouter cette séance à travers l’enquête?
Je voulais que mon livre rende hommage au polar traditionnel, mais je souhaitais aussi m’approprier le propos et jouer avec ses codes. Les policiers, dans les vieux romans noirs, sont souvent assez unidimensionnels. Ils sont des bad guys : violents, alcooliques, ténébreux, hantés par leur passé. Je désirais faire un clin d’œil à cette logique avec mon personnage de Marcus O’Malley, mais aussi la surpasser avec mon protagoniste, Léopold Gauthier.
Comme j’ai un souci d’écrire des femmes qui sont complexes, qui dépeignent un éventail de féminités différentes, je souhaitais faire la même chose avec mes personnages masculins. Avec Léopold, je voulais créer une autre représentation de la masculinité, plus réfléchie, plus posée, plus nuancée. Quelqu’un qui est brisé et qui essaie de se reconstruire, quelqu’un qui aime fort, qui se dévoue à ce qu’il fait. Marcus se fout un peu de tout; Léopold, lui, prend les choses à cœur. Il est fort sans être un dur; il est un autre genre d’homme.
La séance chez le psychiatre, c’est à ça qu’elle sert : à explorer les facettes insoupçonnées de cet homme-là. Léopold est un vétéran et il est très traumatisé par tout ce qu’il a vécu. On parle souvent de la guerre d’une manière très héroïque, mais peu de ce que les gens qui ont tout sacrifié pour aller se battre sont devenus, de ce qu’ils ont ramené quand ils sont rentrés à la maison. À l’époque, surtout, ce n’était pas quelque chose de discuté ou d’accepté. On s’attendait à ce qu’ils reviennent et reprennent le cours de leur vie comme avant, mais la réalité n’est pas aussi simple. Léopold n’a pas envie de parler de ce qu’il a vécu, mais il comprend qu’il en a besoin. Il faut qu’on lui torde le bras, un peu. C’est ce que le psychiatre fait; il le pousse à témoigner, à se confier, à exposer sa fragilité.
Au-delà de toutes ces considérations fictionnelles, les extraits de la séance chez le docteur sont là pour donner un rythme à l’histoire. Un roman noir doit être essoufflant, rapide, entraînant. Les séances du psychiatre offrent un peu de répit entre tous les pans de l’enquête. De plus, ces extraits-là nous renseignent sur les chapitres à venir et sur les dynamiques des personnages, le genre chose qui se communique difficilement au lecteur si on ne veut pas ralentir l’intrigue. On pourrait considérer ça comme de l’étude de personnage; les séquences nous en apprennent sur le tempérament de Léopold, certes, mais aussi sur sa relation avec sa femme et son meilleur ami, sur sa vision du monde.
Vous avez aussi écrit des nouvelles, de la poésie, des livres jeunesse et un radioroman. Que représente l’écriture pour vous?
L’écriture, pour moi, c’est autant de l’introspection que du divertissement. L’introspection, d’abord, car je ne peux nier que ma poésie et mes nouvelles (mon recueil, du moins) sont très intimes. Ce pan de mon travail me permet d’explorer mon rapport au réel, à travers la création. J’y observe mes relations avec les autres, avec le monde, avec la ville, parce que l’écriture me donne l’impression de mieux les comprendre, de mieux me saisir moi-même.
Le reste de mes projets, je les vois comme du storytelling. Ça va sonner un peu étrange, mais j’ai une multitude d’histoires dans ma tête que j’ai envie de partager avec les autres pour les divertir. J’ai toujours adoré la lecture et je me souviens qu’étant adolescente, je me suis un jour dit que je souhaiterais arriver à captiver des gens avec mes récits de la même manière que les auteurs et autrices que j’aimais le faisaient. Je voulais être comme Stephen King, un de mes écrivains préférés. Je serai la première à admettre que son style n’est pas impeccable, mais ses histoires, en revanche, sont souvent incroyables. Il a l’art de créer des personnages complexes et une ambiance si riche qu’elle en paraît vraie. C’est ce à quoi j’aspire avec le reste de mes projets; divertir les gens, raconter des histoires. C’est ce que j’espère avoir réussi à faire avec Brébeuf. J’ai beaucoup réfléchi à ma démarche, à mes personnages, au type d’intrigue que je voulais mettre en place, mais ce qui m’importait le plus était d’écrire un livre qui soit plaisant et agréable à lire. Du bon vieux plaisir de lecture.
Pouvons-nous espérer retrouver les personnages découverts dans Brébeuf dans un futur roman?
Absolument! Bien sûr, dans le monde de l’édition, il n’y a jamais de garantie ou de promesse; c’est un domaine difficile et qui ne pardonne pas. Cela dit, on peut toujours espérer! Brébeuf est conçu comme le premier tome d’une trilogie. Le deuxième est déjà écrit et le troisième est en chantier. Quand l’inspiration est là, on en profite. Pour moi, ça faisait partie du projet dès le début; les polars, traditionnellement, viennent en série. On suit Maigret à travers une variété d’enquêtes. Même chose pour Hercule Poirot, pour Nestor Burma, pour Philip Marlowe. Alors, oui, on peut espérer suivre Léopold Gauthier dans plusieurs autres aventures.
Et c’est une question d’inspiration, certes, mais surtout de sujets historiques. Dans Brébeuf, on aborde très peu l’histoire de Montréal. C’est délibéré; ça me prenait un premier volume pour bien camper mes personnages avant de plonger dans les bas-fonds de la criminalité. Dans les tomes subséquents, j’aimerais explorer plus en détail le monde du crime et certains événements marquants de celui-ci; je voudrais aussi pouvoir parler davantage de Pacifique Plante et de sa trajectoire foudroyante dans le milieu de la police. Avec le Montréal de l’après-guerre, ce n’est pas l’inspiration qui manque. Alors, oui : si vous avez aimé Brébeuf, vous pouvez vous attendre à une suite — ou à plusieurs.
Photo : © Martine Doyon