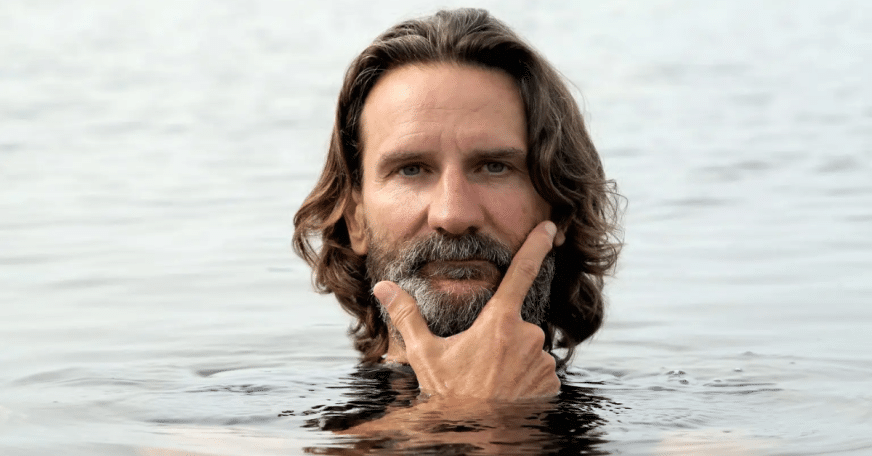Avant l’annonce du prix Man Booker, vous étiez considéré comme un écrivain dont l’œuvre était difficile d’approche, ce qui n’est pas tout à fait vrai. Le fait de recevoir ce prix changera-t-il la perception que les lecteurs ont de vos romans?
Il est vrai que dès mes premiers livres, j’ai acquis bien malgré moi la réputation d’être un auteur pour les écrivains, ce qui est une erreur terrible puisque bien franchement, mes confrères écrivains ne lisent pas mes bouquins! Je ne sais pas comment j’ai mérité cette étiquette qui, franchement, fait fuir les lecteurs. Peut-être parce que je suis un peu trop cynique et détaché en entrevue…
La plupart de vos romans présentent des personnages qui mènent une double vie ou qui se complaisent dans l’illusion. Vous avez, de plus, interrogé souvent les limites de l’art et de l’identité. Or, avec La Mer, vous semblez amorcer un virage dans votre œuvre.
Tout à fait. Ce roman est pour moi une œuvre de transition, et ce, à plusieurs points de vue. Depuis le début des années 80, j’écrivais des romans narrés à la première personne par des hommes qui nageaient dans des histoires de meurtres, d’espionnage ou de vol d’identité. Franchement, je suis allé aussi loin que j’ai pu, et je crois que La Mer a marqué la fin de ce cycle. Je devais me lancer dans quelque chose de complètement différent, alors j’ai commencé à échafauder une petite histoire à propos de l’enfance. Rien ne fonctionnait. Après une longue attente, Max Morden est apparu de e part et le problème était résolu. Toutefois, avec le recul, je me rends compte que Christine Falls (ndlr: le dernier roman de Banville, un polar écrit sous le pseudonyme de Benjamin Black) est le véritable livre de transition, celui par lequel j’entreprends quelque chose de totalement neuf, un peu comme si je vivais une nouvelle crise de la trentaine, mais à 60 ans! Bref, La Mer a donc été l’étincelle. Mon prochain roman, que j’écris sous le nom de John Banville, est d’ailleurs très différent de mes précédents. Il faut aussi que je précise que j’ai choisi un pseudonyme pour que les lecteurs distinguent les deux approches, et pas pour m’offrir une prétentieuse crise d’identité postmoderne…
Du point de vue de l’écriture, quelle est la différence entre Benjamin Black et John Banville?
Je dirais qu’avec John Banville, vous obtenez de la concentration et avec Benjamin Black, de la spontanéité. Enfin, je l’espère! Je ne travaille pas autant chacune de mes phrases lorsque j’endosse le pseudonyme de Black. Ironiquement, je prends plaisir à écrire sous cette identité, alors que pour être franc, écrire «à la Banville» n’est pas toujours une partie de plaisir.
Avec La Mer, en plus d’aborder le thème délicat de la mort, vous avez présenté un retour en enfance, un stratagème dont la conclusion n’est pas toujours heureuse en littérature. Pourtant, c’est ce qui confère à votre livre sa plus grande force.
Vous savez, lorsque les écrivains veulent entamer un virage, ils reviennent souvent dans les territoires de l’enfance. Je ne soupçonnais toutefois pas l’extraordinaire intérêt des gens pour ce thème. Par exemple, une femme m’a un jour dit à Hong-Kong que l’enfance de Max Morden ressemblait en tous points à la sienne. Je lui ai dit qu’il était fort improbable que cela arrive, mais elle s’est obstinée à me convaincre qu’il s’agissait exactement de ce qu’elle avait vécu à Hong-Kong dans sa jeunesse. La période qui précède l’adolescence semble être très importante pour la plupart d’entre nous. Je ne savais pas à quel point elle était forte. C’est une période où tout semble nous arriver pour la première fois, une période où la pureté s’en va.
On peut dire la même chose à propos du deuil, non?
Vous seriez surpris de voir à quel point les lecteurs ont trouvé dans le deuil de Max Morden un écho à leur sentiment de perte et de colère. Pourtant, je n’ai jamais vécu d’expérience semblable. Tout n’est que le produit de mon imagination. Plusieurs ont apprécié le fait que je ne tentais pas de présenter un portrait idéal de la mort, mais plutôt une image franche et assez brutale. Il y a de la beauté dans la mort, mais aussi une grande part d’amertume et de colère. Je crois que si vous écrivez de façon honnête, et c’est ainsi que la plupart des écrivains font leur travail, il en ressortira beaucoup de choses dures et difficiles. C’est cruel, mais c’est ainsi.
Bibliographie :
La Mer, Éditions Robert Laffont, collection Pavillons, 246 p., 34.95$