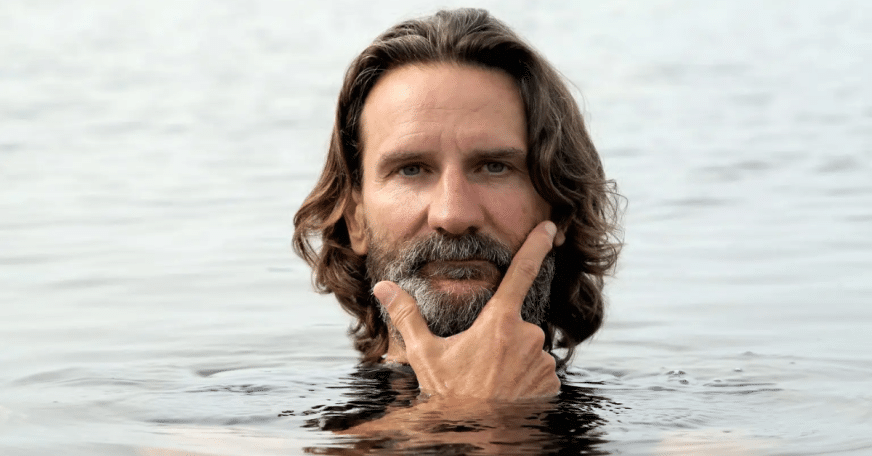Doit-on considérer la littérature comme le lieu de réconciliation de vos multiples intérêts ?
En fait, je crois qu’on peut parler de plusieurs lieux de réconciliation. Le premier est la médecine, car j’ai choisi ce métier avec pour modèles des gens comme Clémenceau, Céline (enfin, pas sur tous les points) et Henri Mondor, qui, à la fois, étaient médecins et écrivains, qui vivaient dans leur siècle. Lorsque j’ai décidé de devenir médecin, je suis tombé dans une époque très technique, mais j’ai tenté de me frayer un chemin qui préserve tout ça, de me créer un parcours humain, quoi.
À quoi peut-on attribuer la méconnaissance, voire l’oubli de cet épisode de l’histoire de France que vous relatez dans Rouge Brésil?
Cet épisode n’est pas très à l’avantage des Français ; il ne se termine même pas par une défaite – qui suppose que l’on ait été battu par quelqu’un – mais plutôt par une implosion, une guerre civile. Donc, cette tentative de colonisation avortée a débouché sur une sorte de déchirement intérieur qui n’est jamais agréable à commémorer. Et puis, les traces qui sont restées, les livres publiés à l’époque, ont quand même eu une assez grande postérité ; pensons au volume de Jean de Léry, un des témoins de cette aventure, Voyage vers la terre de Brésil, un livre que Lévy-Strauss a emporté dans sa poche lorsqu’il est venu en Amérique. Il y a une résonance intellectuelle de cet épisode de l’histoire de France, mais elle n’a passé la barrière du grand public. Cependant, les Brésiliens ont gardé le souvenir assez vif de cette époque puisque dans la baie de Rio, l’île porte toujours le nom de Villegagnon.
À l’instar des précédents, ce roman oppose cette morgue typiquement occidentale à une culture que l’on suppose barbare, en démontrant que les concepts de civilisation et de barbarie sont flous…
Cette tentative avortée de colonisation du Brésil est un des épisodes historiques les plus faciles à analyser, car il s’est passé avec une unité de temps et de lieu parfaite. L’observation en est donc une, presque, de laboratoire. On assiste à un retournement des concepts, car ces gens qui vont au Brésil pour apporter la civilisation, pour lutter contrece qu’il considèrent être l’horreur absolue, c’est-à-dire le cannibalisme des Indiens, vont finalement et en réalité s’entre-tuer et donc, devenir pour l’essentiel d’entre eux, les protagonistes des futures guerres de religion. En revanche, l’Indien échappe à cette situation, ce qui va promouvoir l’image du » bon sauvage » chez les philosophes des Lumières. Cette inversion des points de vue était, pour moi, particulièrement intéressante.
Villegagnon débarque au Brésil avec des idées fort nobles, mais il va néanmoins devenir une sorte de fanatique religieux. Est-ce irrémédiablement le cas pour tout Occidental qui débarque chez l’Autre?
Pas forcément. Villegagnon est un homme de tous les temps, mais surtout un homme de son temps. Il incarne les contradictions du XVIe siècle, celui de la Renaissance, qui commence dans l’ouverture, la curiosité et la culture et se termine par le fanatisme, le sang et la guerre. Villegagnon incarne vraiment ce parcours-là. Il a rencontré des » Autres » : les Indiens et les protestants. Mais c’est plutôt la rencontre avec l’autre soi-même, dissident et fanatique, qui va l’entraîner sur la voie de la violence.
Le personnage de Pay-Lo est naturalisé brésilien presque au sens total puisqu’il devient presque un Indien lui-même. Il incarne, pour l’Europe, l’autre attitude possible en face de l’Autre…
Les Européens n’arrivaient pas tous au Brésil avec une intention de conquête. Il y avait différentes attitudes : celles des marchands, des truands, des gens qui étaient là-bas par conviction, par choix philosophique, qui ne renonçaient nécessairement à leur » européanité » même si certains s’indianisaient complètement. Pay-Lo se trouve un peu entre les deux attitudes. Tout cela est attesté dans les textes portugais, qui ont eux aussi vu plusieurs de leurs voyageurs, de leurs naufragés, rester chez les Indiens. Effectivement, Pay-Lo démontre qu’il est possible d’adopter une attitude différente de celle que l’on attendait des Français, celle de Villegagnon et des autres colons.
Vos romans vous situent à cheval sur la grande tradition du roman d’aventures à la Dumas et celle d’essayistes tels que Montaigne, Diderot, Voltaire. Entre les deux voies, votre cœur balance-t-il?
Vos comparaisons me font rougir parce que ce sont des monuments ; on peut les prendre comme modèles mais on ne peut certainement pas faire pareil. Chez Voltaire et tous les philosophes du XVIIIe siècle, il y a une dimension d’utilité au texte qui n’est pas toujours présente chez Dumas. Parfois, on a l’impression que chez lui l’aventure est là pour elle-même, alors que lorsque l’on regarde l’usage que faisait Voltaire du roman, on s’aperçoit que le texte est aussi une machine de guerre, une machine destinée à intervenir dans les situations qu’on décrit. C’est vrai, notamment pour les thèmes du fanatisme totalitaire qui accompagne la croyance religieuse quelle qu’elle soit, qu’il y a une dénonciation de ces comportements fanatiques.
Ce choix de la fiction à grand déploiement vous oppose, d’une certaine façon, aux courants actuels dans la littérature française…
J’ai effectivement l’impression d’être tombé du bateau et que les autres sont partis dans une autre direction. Moi, je suis sur mon radeau et je suis et emporté par des contre-courants qui réfèrent à des formes et à des techniques littéraires un peu tombées dans l’oubli, du moins en France. Je trouve, par exemple, que la littérature anglo-saxonne a beaucoup moins de complexes sur le plan de l’aventure, de la référence à l’Histoire. Je revendique le droit à la différence, ce qui ne veut pas dire que je conteste le bien-fondé de ce qu’écrivent mes confrères. À l’instar du public, je demande seulement le droit de raconter une histoire.
Dans quelle mesure les réflexions de Montaigne vous paraissent-elles encore pertinentes à notre époque ?
Je suis un inconditionnel de Montaigne. Son attitude, sa perception de l’Autre, du sauvage, est totalement moderne. Dans une forme qui est celle du XVIe siècle – c’est-à-dire avec une assez faible connaissance de l’étranger bien qu’il se soit renseigné – Montaigne a écrit des choses qui portaient surtout sur le relativisme du jugement. Montaigne a écrit en plein durant les guerres de religion. Il a assisté aux massacres de Bordeaux. Sans faire un véritable parallèle, il a bien perçu l’épisode de la colonisation du Brésil. De Léry, qui est un des meilleurs observateurs des Indiens, les a respectés pour des raisons qui, en réalité, quand on creuse, sont assez mauvaises. En fait, il les a respectés parce qu’il les trouvait tellement sauvages qu’il n’y avait pas d’espoir de les convertir. D’une certaine manière, on pouvait les observer comme des bêtes. Montaigne, lui, compare des formes de civilisation sans porter un jugement sur leur valeur.
Est-il possible de concilier les valeurs de progrès, de développement et de civilisation, ces mots qu’on a toujours à la bouche en Occident, avec le respect des cultures étrangères au premier monde?
Je crois qu’il ne faut pas limiter ces idées au Tiers-Monde. Dans les pays européens, les peuples ont leur spécificité, mais ils ont de la difficulté à la maintenir dans un système qui l’écrase. Évidemment, il y a un rapport de force qui est moins favorable avec des pays qui n’ont pas les moyens de défendre leur production culturelle. Ce nivellement des cultures est assez général. Mais la vision de ce combat, qui consiste à figer les cultures en en faisant des entités immuables, n’est pas non plus une solution. Ce qui est en cause, ce n’est pas tellement la destruction éventuelle de cultures qui seraient là de toute éternité, mais la possibilité pour ces cultures de vivre, de se transformer. Les identités et les cultures sont des formes vivantes, mouvantes. Enfermer les Autres dans des réserves est hors de question : il faut savoir si ce processus de création et de transformation permanente de la culture est encore possible..