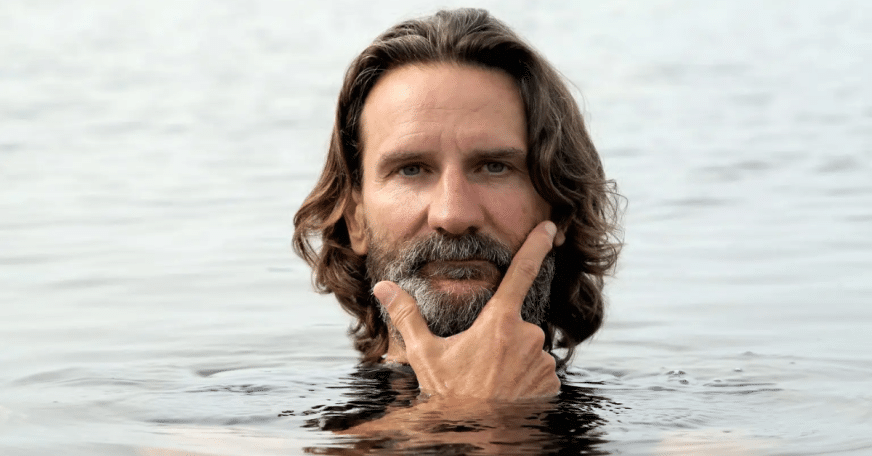Racontez-moi votre première scène d’écriture, qu’elle soit réelle ou inventée.
J’étais amoureux d’une fille. Je me suis dit autant le lui écrire. J’étais très petit, alors pour dire à une fille qu’on l’aime, je me disais « on doit devoir écrire un poème »… Comme je ne savais pas écrire de poésie, j’ai pris le poème de quelqu’un d’autre ! J’avais huit ans, je ne connaissais rien, et je suis tombé sur un poème d’Aragon. Je l’ai lu, il me plaisait bien. C’était à peu près ce que je voulais dire, alors je l’ai signé. Comme j’avais déjà une « haute » honnêteté intellectuelle, j’ai rajouté tous les cinq, six vers, une phrase de mon cru. Elle était immédiatement identifiable parce que vraiment pourrie. Puis j’ai donné mon poème en pensant sérieusement que c’était le mien. Je ne suis pas sorti avec la fille, mais elle m’a dit que j’écrivais bien. Je l’ai pris comme un compliment, comme si le texte était de moi. Et après, je ne sais pas, d’histoire en histoire ou de fille en fille, j’ai mis de moins en moins de vers d’Aragon et de plus en plus de moi, jusqu’à avoir un premier poème. Comme il était très mauvais, j’ai arrêté, mais j’ai retenu qu’à ce moment d’origine de l’écriture, il y a le désir d’imiter quelqu’un, d’imiter un style, pour espérer un jour s’imiter soi-même ou imiter son propre style.
Aragon écrivait « Tout le monde imite, tout le monde ne le dit pas… » (préface des Yeux d’Elsa). Dans les années 60, il définissait son art comme un « collage ». Que vous soyez tombé sur ce poème est une belle coïncidence !
C’est un hasard ; j’ignorais qui était Aragon. Au début de l’écriture, il y a le désir de s’élever, en général pour plaire à quelqu’un. Je crois que cette élévation passe par une sorte d’imitation ; il faut d’abord vouloir imiter, ne pas y parvenir, pour ensuite tenter d’accéder à soi-même.
S’agit-il alors de quelque chose qui serait de l’ordre d’une frustration, d’un échec à compenser ?
Je crois qu’il y a une hantise des textes qui ont marqué, une hantise suffisamment forte pour contaminer ce qu’on essaie d’écrire. La libération par rapport à ces textes consiste à ne pas parvenir à les retranscrire ou à faire aussi bien. C’est quelque chose qui n’est pas négatif comme la frustration ; on réalise que ça ne nous appartient pas totalement.
Poursuivons sur cette hantise de l’influence. J’ai été frappé par la violence des scènes de naissances que l’on retrouve dans vos deux premiers romans. Cette peur des origines correspond-elle à la peur des références ?
Je n’avais pas pensé à ça… Mon premier roman [NDI : Neiges artificielles, Flammarion, 2002], je l’ai écrit en toute innocence, pour savoir ce qu’il y avait dedans. Je ne savais pas pourquoi je l’écrivais, ni ce que j’allais dire. Cette anecdote par rapport à la naissance, elle est venue comme ça, sans que ça soit un propos qui me tenait à cœur d’exprimer. Je n’avais pas encore lu Cioran, De l’inconvénient d’être né, mais je crois qu’à l’origine du cynisme — parce qu’il y avait une sorte de cynisme dans mon premier roman —, il y a un rapport contrarié à la vie, qui vient avec la naissance. Le moment de la naissance, c’est le moment premier de la trahison vis-à-vis d’une antériorité qui serait à la fois plus confortable et plus large, puisque non déterminée. C’est un fantasme sans substance, un point d’origine, un départ.
Ce qui nous mène à cette fin mélancolique de Neiges artificielles, où le narrateur s’acharne à démontrer à l’enfant que le Père Noël n’existe pas, pour ensuite regretter son geste : est-ce une manière de demeurer dans la même position ?
Vous parlez de mélancolie : je dirais plutôt « nostalgie ». Pendant très longtemps, j’ai été nostalgique de façon maladive, au point où ça parasitait ma vie. Dans ce livre je parlais de la nostalgie de l’enfance, d’où cet interlocuteur qui est un enfant de six ans. Et aujourd’hui, quand j’y repense, je ne suis plus sûr d’être nostalgique de cette période. J’ai le sentiment d’avoir créé cette nostalgie, pas par mauvaise foi ou malhonnêteté, mais comme si j’avais recomposé un peu mon enfance pour l’opposer à mon adolescence, la croire plus dorée. En réalité, je crois que j’ai eu une enfance assez insignifiante. Je m’en rends compte d’autant plus facilement aujourd’hui qu’un des grands rêves de mon adolescence, c’était de pouvoir écrire : avoir cette vie, cette liberté-là. On peut donc très bien être nostalgique d’une période qu’on n’a jamais vécue.
N’est-ce pas la définition du kitsch ?
Le kitsch, chez Kundera du moins, est plutôt « la négation de la merde ». Cette attitude psychologique consiste à vivre comme si la merde, au sens large, figuré, n’existait pas. C’est la négation de ce qui suscite la honte en soi. Dans mon cas, ce n’était pas tout à fait ça, mais je crois que cela demeure le principe même de la nostalgie : une recomposition de la mémoire pour trouver un secours dans quelque chose de fantasmé, qu’on appellerait une période simplifiée, innocente. J’avais le sentiment d’être venu à bout de ma capacité d’illusion, d’où ma disposition à la nostalgie. Aujourd’hui, je sens, pour être honnête, qu’un jour je serai très nostalgique de maintenant, parce que j’estime être très gâté, proche de ce à quoi je rêvais : être libre et faire au mieux ce que je voulais faire. Ce qui risque de me manquer, c’est avant tout le sentiment de liberté, la possibilité aussi d’aller au bout de sa curiosité.
Dans vos précédents romans, on décèle un refus de l’attachement de la part de vos personnages, tandis que dans La Fascination du pire, on constate une sortie vers l’autre.
Oui. C’est un livre qui est un peu différent des autres dans la mesure où il y a une dimension purement narrative, alors que dans les autres non. Mais le fait que le narrateur ait une femme à qu’il était « attaché », qu’il avait un défi, comme ça, de fidélité, n’était en rien central pour moi.
Sans être central, est-ce que ça n’accentue pas le propos du livre ?
Une des grandes questions posées à l’individu en Occident, c’est la compatibilité de l’exercice de son désir avec un rapport constructif et fiable à l’autre. On vit dans une société publicitaire, de l’exacerbation du désir et du fantasme. Je trouve que tout ça vient à bout très facilement de la capacité d’illusion, qui est nécessaire pour croire en une histoire de couple. Comment concilier suffisamment d’innocence pour envisager le prolongement d’un amour et, en même temps, la liberté accordée à tous ses désirs ? Comment être un individu intégré dans cette société sans en être totalement l’objet ou la victime ? La renonciation, qui se joue d’ailleurs dans les histoires à deux, est une notion que j’aime bien car la part à laquelle il faut renoncer est comme une offrande à l’autre. L’un des thèmes centraux de La Fascination du pire, du reste, c’est la frustration, une triple frustration. D’abord celle, dans le roman, qui était créée artificiellement par une religion très idéologique ayant un rapport très difficile avec la sexualité et la liberté, puis celle, occidentale, incarnée par le personnage de Martin Millet, qui, parce que les dernières barricades protégeant l’individu sont tombées — à savoir le couple, la famille —, se retrouve sur un marché où il ne peut gagner : celui des corps, des êtres, du désir.
C’est un sujet qu’on trouve aussi chez Houellebecq, notamment dans Extension du domaine de la lutte.
Exactement. Les lois qui régissent les rapports de force entre les individus sont semblables aux lois économiques. À cet égard, si on a espéré que la libération sexuelle « libère » les individus de la frustration, on est presque obligés de constater, aujourd’hui, que c’est le contraire qui se passe. La libération sexuelle renvoie chaque individu à sa propre frustration avec d’autant plus de violence qu’elle avait commencé par lui laisser croire que les désirs allaient toujours trouver une résolution positive. Cette frustration, qui me semble être l’un des moteurs de la société occidentale, est l’un des thèmes qu’il m’importait d’intégrer au roman. Enfin, il y a cette autre frustration, la troisième, qui consiste à renoncer à soi pour pouvoir se donner, comme un pôle négatif ou positif, comme une modalité de survie à l’autre.
Et quand on doit renoncer à l’autre ? Je pense à ce couple en voyage de noces, dont la femme disparaît à jamais. On la lit dans Les Amants du n’importe quoi et dans La Fascination du pire.
Oui, ça revient dans La Fascination…, mais j’avais oublié que c’était aussi dans Les Amants du n’importe quoi [NDI : le deuxième roman de Florian Zeller]. Non pas parce que j’ai une mauvaise mémoire, mais parce que je ne lis pas mes livres et je pensais que ça faisait partie d’un passage supprimé. Mais ça a un sens que ça revienne ; c’est une anecdote que j’avais entendue petit et que j’ai souvent imaginée comme l’exemple du cauchemar absolu : le moment où l’on croit qu’on va approcher l’apothéose de l’amour, l’autre disparaît, comme ça ! J’ai cette obsession permanente, dangereuse de la disparition de l’autre…
La conscience du malheur même quand ça va bien : « La fascination du pire ». D’où vient ce titre ?
Il y a une phrase de Cioran qui dit « Je suis fasciné par le pire ». Mais sinon, le titre s’est imposé de lui-même ; je l’aimais bien sans trop savoir ce qu’il voulait dire. Beaucoup de gens l’ont toutefois compris comme une complaisance pour le pire. Moi, je l’avais plutôt écrit comme quelque chose qui parasite : cette attitude qui consiste à interpréter tous les signes comme les pièces à conviction d’une catastrophe, dont on aurait pris à l’avance la mesure, sans savoir quelle allait être sa nature. Au fond, dans mes romans, je parle vraiment rarement de moi. En revanche, le seul endroit où je me reconnais sans ambiguïté, dans cette fascination du pire, dans l’explication psychologique du terme. Ce n’est pas quelque chose de complaisant, c’est au contraire quelque chose dont j’essaie de me débarrasser. J’ai fréquenté avec tellement de régularité la mort autour de moi que je suis dans une attitude de veille permanente par rapport à cette possibilité. Ce qui fait que les gens qui me sont chers, je les appelle dix fois par jour, mais vraiment dix fois par jour. Pas pour savoir comment ils vont, mais pour savoir s’ils sont toujours vivants.
Vous inventez à chaque fois des prétextes ?
Oui, je me débrouille. Mais il n’y a pas vingt personnes qui me sont chères non plus ! C’est ridicule, mais je vis avec ce ridicule, parce que j’ai une très forte disposition pour la panique. Cette anecdote, sans doute, véhicule cet effroi à considérer la possible et l’extrême brutalité de disparition de l’autre.
C’est presque le contraire de cet imaginaire de la naissance dont on parlait au début. Au lieu d’être soi-même expulsé, déchu, c’est l’autre qui se volatilise !
Oui. Aujourd’hui, c’est sans doute cette idée qui m’anime plutôt que le fait d’ « être expulsé ». C’est lié à la fréquentation de la mort, je crois, celle des autres, de mon environnement.
Revenons au texte. Dans Les Amants du n’importe quoi, c’est explicite : la fiancée enlevée est maintenant dans un bordel quelconque, on ne pourra pas la retrouver. Or, la destination n’est pas mentionnée dans La Fascination du pire. Par contre, le thème de la prostitution irrigue tout le roman…
Oui, c’est vrai. On va dans les bordels, mais on ne trouve pas la fille qu’on cherche !
Le voyage en Égypte, qui sert de base à La Fascination du pire, s’écrit en écho aux passages de la Correspondance de Flaubert consacrés à Kuchuk-Hanem, cette prostituée qui l’a tant inspiré. À l’opposé, le personnage de Martin Millet insiste sur la promesse des soixante-douze vierges faite au martyr dans le Coran. La prostituée serait-elle au roman ce que la vierge est à la religion ?
Comme lieu du fantasme ?
Oui. Avec la vierge, il n’y a pas d’échange : c’est la pureté idéologique. N’est-ce pas dans la nature du roman de marier les discours ?
Il y a, chez Kundera, cette idée que le roman naît avec Rabelais et Cervantès, au moment où deux idées contradictoires peuvent cohabiter dans un seul paragraphe. Cette réflexion, Kundera la faisait par rapport à l’histoire de Rushdie, en 1988. Aujourd’hui, ce n’est pas simplement l’Imam d’Iran qui attaque le roman, c’est plus dangereux parce que moins identifiable : c’est un esprit de censure qui commence à tout contaminer. Dans mon roman, je parle de l’Islam, mais j’aurais pu également prendre pour contexte l’Amérique profonde ou parler, par exemple, de Voltaire contre la religion catholique. On assiste, en France, pays qui prétend avoir l’histoire de la liberté pour lui, à une « judiciarisation » de la littérature, où la plupart des associations lisent les livres pour faire des procès. À travers Rushdie, ce n’était pas Rushdie qu’on attaquait, mais le roman ; et à travers le roman, ce n’était pas le roman, mais bien l’Occident. Aujourd’hui, à travers le roman, ce qui est attaqué par les associations, c’est l’histoire de la liberté et de la jouissance. C’était un point de départ pour La Fascination du pire car je trouve que c’est absolument insoutenable. C’est une négation de tout ce à quoi j’attache de la valeur. Le roman ne saisit le monde que comme interrogation, jamais comme réponse. Sinon, on fait un essai, une idéologie ! L’art du roman, c’est la possibilité d’associer des contradictions, donc de toucher à la complexité des choses et à leur relativité.
Votre manière de conclure La Fascination du pire, où le « je » du roman adresse un démenti au lecteur, réintègre le discours dans l’espace romanesque. Est-ce qu’il n’y a pas également une pique à l’endroit de l’autofiction ?
Oui. Je voulais réinscrire ce roman dans une tradition de la fiction, et non pas dans cette autre tendance qui contamine beaucoup l’intelligence et qui s’appelle le témoignage, l’autofiction, la biographie, etc. Je ne veux pas parler de moi : on s’en fout de moi. Ma tradition inscrit le roman dans une autre histoire, qui est celle de l’ambiguïté, du brouillage de pistes, où cohabitent le vrai et le faux, et c’est seulement dans cet espace que le genre romanesque prend sa vraie dimension. C’est à ce moment-là qu’il devient dangereux. On parlait tout à l’heure de Kundera, de Rabelais…
Je suggère comme sous-titre à votre roman : « Le jour où Panurge ne fera plus rire ».
Oui, c’est un texte superbe [NDI : Les Testaments trahis, Folio, 2000]. Kundera y dit que l’humour est une invention du roman. Or, l’humour est ce qui rend tout ambigu. Rendre ambigu, c’est jouer avec les autres. C’est vrai que je laisse suffisamment de pistes, aussi, pour ne pas simplement dire que c’est une fiction. Dans Neiges artificielles, je ne parlais pas du tout de moi, et pourtant, j’y ai créé un personnage qui s’appelle Florian, et ce, pour faire des stratégies de mise en abyme avec lesquelles on est obligés de se dire que si on n’arrive pas à démêler ce qui est vrai de ce qui est faux, il ne nous reste plus qu’à considérer que ça n’a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c’est de savoir ce qui fait écho à la vérité.