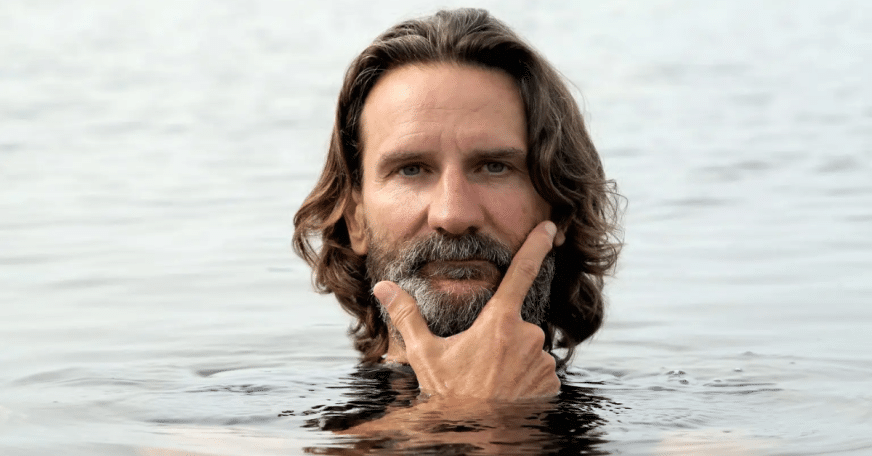Nul besoin de revenir sur la controverse qu’avait soulevé l’an dernier l’article sur la littérature québécoise que signait David Homel dans les pages du quotidien Le Monde à l’occasion du Salon du livre de Paris, mais sans doute faut-il rappeler certaines de ses hypothèses pour expliquer pourquoi notre littérature soit si peu prisée en Europe francophone. Ainsi, aux dires d’Homel, la littérature québécoise serait à l’image de notre société «trop tranquille» et tournée vers elle-même; elle s’écrirait aussi dans une langue colorée par un fort accent qui la rendrait plus difficile à comprendre par les francophones européens, un accent hélas moins exotique et séduisant que celui, créolisé, des écrivains issus d’autres régions périphériques de la francophonie mondiale.
Ce point de vue, qui a valu à Homel d’être décrié sur la place publique, Margaret Atwood le reprend à son compte dans l’entrevue qu’elle m’a accordée pour ce numéro du Libraire. Soit. Mais, ai-je demandé à Homel, qui commente également l’actualité littéraire anglo-canadienne dans La Presse, dans quelle mesure ces hypothèses ne s’appliqueraient-elles pas aussi à une partie de la littérature de l’autre solitude? «Je ne veux pas répéter inutilement des propos qui malheureusement avaient choqué, mais c’est évident que l’anglais du Canada passe très bien dans le Commonwealth et assez bien aux États-Unis. Il y a des variantes et des variations, bien sûr, mais rien de comparable à ce qui distingue le français québécois du français de l’Europe.»
Allons plus loin cependant et demandons-nous quels écrivains anglo-canadiens voient leurs oeuvres exportées et pour quelles raisons? «Eh bien, lance David Homel, tu remarques sans doute comme moi que beaucoup de ces écrivains sont des Néo-canadiens, issus du Sud-Est asiatique, dont la langue est déjà teintée d’un certain accent très britannique, pense à Rohinton Minstry, par exemple.» Ici, je ne peux m’empêcher de sourire à l’idée que, justement, l’un des plus grands succès de la littérature anglo-canadienne à l’étranger, qui ne porte pas la signature d’un écrivain issu de l’immigration, L’Histoire de Pi (Prix Booker 2002), est l’œuvre d’un écrivain québécois et met en scène un héros originaire de l’Inde…
Le Canada métèque
Voilà un autre constat qui ne plaira pas à tout le monde, que David Homel fait sans le moindre désir de provocation. «Il faut quand même le dire: parmi ces écrivains anglo-canadiens dont les oeuvres voyagent et sont lus à l’étranger, beaucoup avaient eux-mêmes voyagé avant d’arriver au Canada, parfois avant d’être Canadiens. Sans doute doit-on aussi noter qu’ils ne s’agit pas d’immigrants ordinaires, si on me pardonne l’expression; ces écrivains pour la plupart appartiennent à la crème, à l’élite de leur pays d’origine, qu’ils sont venus au Canada avec une longueur d’avance et parfois même des romans tout prêts sous le bras…» Faut-il alors conclure que les oeuvres anglo-canadiennes du crû voyagent désormais moins aisément que celles de ces Néo-canadiens, très prisées dans l’anglophonie? «Excellente question, d’opiner Homel. Bien sûr, le constat ne s’applique pas aux grands noms de la littérature anglo-canadienne, les Mordechai Richler, Margaret Atwood, Alice Munro et tutti quanti. Mais reconnaissons que l’émergence des écrivains néo-Canadiens, issus de part et d’autre du Commonwealth et surtout de l’Inde, a eu un effet majeur sur le rayonnement de la littérature anglo-canadienne dans le monde.»
Le succès mondial de cette poignée d’écrivains néo-canadiens d’expression anglaise serait-il à l’origine d’un mythe sur le rayonnement tous azimuts de l’ensemble du corpus? «Je crois que oui, acquiesce Homel. Et d’ailleurs, c’est un phénomène mondial ― pensons à Salman Rushdie ou Zadie Smith en Grande-Bretagne: il y a depuis quelques années un engouement générale pour la littérature post-coloniale. Parce qu’ils ont publié chez des éditeurs d’ici, ces écrivains ont contribué à augmenter le rayonnement de la littérature anglo-canadienne d’une certaine manière; mais en même temps, ils se sont inscrits dans un courant qui émergeait de toutes parts.» C’est ce courant émergent qui s’est généralisé au fil de la dissolution des frontières et de la mondialisation des marchés économiques que certains critiques ont baptisé world literature, à l’image de ce world beat qui s’est imposé dans le domaine de la musique.
Au risque de passer encore pour celui qui insiste pour faire entendre le son de cloche dissonant, Homel surenchérit: «Ce témoignage vaut ce qu’il vaut, mais mon agente littéraire m’a dit que le prétendu engouement pour la littérature anglo-canadienne va en s’amenuisant. La preuve en est que dans les foires de livres internationales, elle ne vend plus les droits de coédition ou de traduction de romans du Canada anglais aussi aisément et aux mêmes prix qu’il y a quelques années. Et je continue de croire que c’est encore lié au goût des éditeurs pour les littératures post-coloniales qui lui ne se dément pas, d’autant plus que la conjoncture politique internationale y est propice.»
Enfin, David Homel en conviendra avec moi, sans doute y a-t-il un brin d’anti-américanisme latent dans cette volonté d’abord parisienne de promouvoir une littérature anglophone qui parle d’Amérique sans être issue des États-Unis.