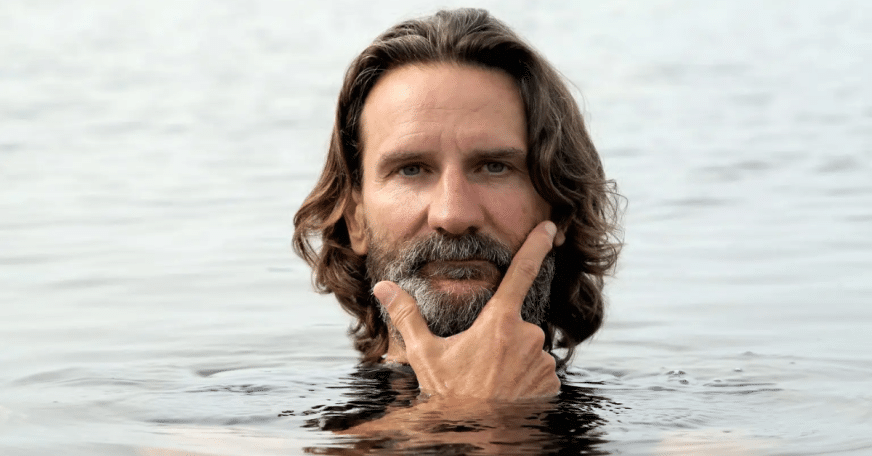Vous avez consacré dix ans à Glamorama; on peut supposer que le projet initial a dû évoluer pas mal au fil de l’écriture…
J’ai amorcé ce livre en décembre 1989, environ une semaine après avoir mis le point final à American Psycho, et j’ai passé près de deux ans à en esquisser les prémisses, à faire des recherches. Au moment d’attaquer la rédaction, j’avais une idée très précise du livre. Ç’a été le cas pour tous mes autres livres: je fais toujours des plans détaillés, je consacre beaucoup de temps à la préparation. Si mon projet s’est modifié, c’est surtout en raison des problèmes occasionnés par la sortie d’American Psycho. À cause de toute cette controverse, j’ai pris une année sabbatique. Quand je me suis remis à Glamorama, j’ai changé quelques détails; le livre a pris une couleur plus sombre, plus paranoïaque. Sans doute était-ce dû à la paranoïa que j’ai ressentie avec la controverse d’American Psycho. Autrement, sur le plan de l’intrigue, des personnages, du concept, peu de choses ont changé. Et puis, je n’ai pas travaillé huit ou neuf ans à temps plein. Beaucoup de choses me sont arrivées qui m’ont forcé à interrompre l’écriture pendant de longues périodes. Mais ces problèmes personnels n’ont pas affecté le roman tant que ça.
La paranoïa, la peur… Doit-on parler de crampe de l’écrivain ?
Non, je n’ai jamais vécu ça. Quand j’ai repris Glamorama, mon père est mort et j’ai eu à faire face à toutes sortes d’ennuis avec sa succession. J’ai passé une partie de 1993 en cour et quand je suis retourné à l’écriture, mes éditeurs exigeaient un livre. Alors ils ont publié Zombies, un recueil de nouvelles, et il m’a fallu revoir certains détails de ce bouquin. Et puis il y eut la rupture de mon couple, une relation qui avait duré sept ans, et puis aussi des problèmes de drogue et d’alcool. Additionnez tout ça et vous voyez bien qu’il ne s’agissait pas d’une crampe de l’écrivain.
Aviez-vous certaines appréhensions à l’idée de publier Glamorama ?
Non. C’était comme un rêve. Je n’ai jamais vécu une sortie de livre aussi paisible. Mes éditeurs m’ont appuyé et ça s’est très bien passé. Je ne redoutais rien, je me savais entre de bonnes mains. Je n’éprouve pas beaucoup de craintes à propos de ma carrière et tout ça. Ce qui m’effraie a plus à voir avec ma vie privée et quotidienne. L’image de Bret Easton Ellis, la réaction du public à mes livres, ça ne m’effraie pas beaucoup.
Dans votre œuvre, vous abordez le thème des apparences, mais rarement ce qu’elles cachent…
J’ai choisi de rester fidèle à mes narrateurs. Tous racontent leur histoire et je les laisse faire. Je n’ai pas tendance à intervenir en tant qu’auteur, à m’immiscer dans leur narration. Il faut lire mes livres comme des critiques de ces gens qui sont obsédés par les apparences, qui s’en satisfont et qui ne cherchent pas à aller plus loin. Il y a suffisamment de critique implicite pour que l’auteur n’ait pas à ajouter son grain de sel. À travers le comportement de mes personnages, les choix qu’ils font, leur manière d’agir et d’être, mes livres dénoncent notre mode de vie et cette idée que les apparences révèlent la vérité. Nous vivons dans une société où cette idée a force de loi; on n’en a plus que pour les images et la perception.
La violence, les meurtres, les viols semblent inévitables dans un univers aussi décadent que celui que vous décrivez…
Parce que nous sommes humains. Il y a en l’être humain un potentiel de bonté mais aussi la capacité d’être vil, de commettre des actes horribles, de tuer. Ça fait partie de la nature humaine. C’est encore plus évident aux États-Unis, où les gens sont particulièrement violents. Les armes à feu pullulent et les meurtriers en série rôdent. Nous sommes une nation violente par essence. American Psycho et Glamorama traitent de meurtres en série, de terrorisme et pourtant je ne suis pas une personne violente. Plus je vieillis, plus je suis sensible à la violence. Je n’aime pas y assister, ni même lire là-dessus. J’étais au milieu de la vingtaine quand j’ai conçu ces livres; je ne crois pas que j’aurais encore envie d’écrire sur ces sujets. J’avais à l’époque moins conscience de l’éventualité de ma propre mort. En vieillissant, on développe davantage d’empathie pour la souffrance des autres. Je ne crois pas que la douleur émeuve autant un jeune homme.
La télé nous abreuve quotidiennement d’histoires véridiques de meurtres, de tragédies et personne ne semble s’en offusquer. Pourquoi vos livres sont-ils perçus comme plus choquants, plus dangereux ?
Sans doute les critiques littéraires sont-ils plus sensibles que les chroniqueurs télé. Vous savez, les lecteurs ne s’offusquent pas de mes livres; ce sont les critiques qui s’offusquent de mes livres. Mais les réactions à American Psycho ont changé depuis la parution initiale du roman. Les gens le perçoivent moins comme une célébration de la violence que comme une critique du comportement mâle, une satire sociale. Mon lectorat comprend mes intentions, il n’y a que mes détracteurs qui continuent d’être outrés. On peut critiquer un roman pour un tas de choses, des détails stylistiques, l’angle d’approche choisi par l’auteur… Malheureusement, on a tendance à me critiquer d’un point de vue moral à propos de mon utilisation de la violence. Pourtant, c’est une violence fictive, imaginaire : personne n’a été blessé pendant la rédaction de ces romans.
La gloire, la célébrité ouvre-t-elle nécessairement la porte à la violence ?
Je le crois. Dans Glamorama, la violence est une métaphore de la gloire. Elle est intimement liée à la gloire, dans la mesure où la gloire n’est qu’une chimère, elle n’existe pas. Tout ce qu’on nous montre dans les médias, à la télé, dans les magazines n’existe pas, ce ne sont que des images. Nous passons notre temps à projeter des fantasmes sur telle star de cinéma que nous ne voyons que dans des films ou dans des talk-shows. Notre société est obnubilée par des gens qui n’existent pas réellement. La question que pose mon roman est la suivante : où cela nous mènera-t-il ? À mon sens, ça nous mènera à une société brisée, une culture brisée. La violence n’est en définitive qu’une métaphore de cette brisure.
Dans vos livres, vous citez constamment les marques de commerce; pourquoi ?
Regardez autour de vous, comptez le nombre de marques de commerce qui vous entourent quotidiennement. Si je veux décrire le monde contemporain d’un point de vue contemporain, impossible de ne pas citer les marques de commerce. On me l’a souvent reproché mais, en toute honnêteté, ce n’est pas un choix stylistique. Avec American Psycho, le fait que mon tueur en série portait telle marque de montre-bracelet m’a valu quelques tracas avec la compagnie qui ne voulait pas voir sa marque de commerce associée à mon livre.
À ce qu’il paraît, votre prochain livre abordera des thématiques plus intimes…
En effet. Ce sera un roman autobiographique. Mais il semble qu’il me faut de plus en plus de temps pour écrire qu’avant. Il faut dire que mes livres sont désormais beaucoup plus longs, plus complexes. Je ne crois pas que je prendrai autant de temps à l’écrire que pour Glamorama, mais je doute qu’il paraisse avant mon quarantième anniversaire…