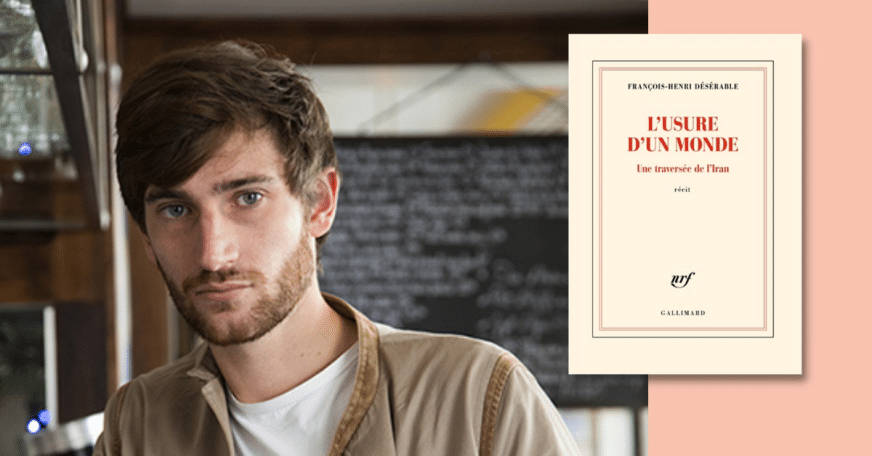En effet, Wright observe sans catastrophisme, mais avec une certaine inquiétude, sur une très longue période, la tendance fréquente des civilisations à grandir et à développer leurs moyens techniques, jusqu’à un point de non-retour où elles surexploitent leurs ressources et en viennent à s’effondrer.
Progresser jusqu’à l’échec
C’est ainsi que les Mésopotamiens établirent une civilisation florissante, notamment grâce à l’invention de systèmes d’irrigation avancés et performants. Trop performants, en fait, puisque cette irrigation excessive finit par conduire à la salinisation des terres et à leur transformation permanente en désert. Les Mayas, de même, avaient construit de grandes villes et ouvert des vallées entières à l’agriculture. La déforestation entraînée par ce développement intensif devait toutefois provoquer des phénomènes d’érosion catastrophiques et l’effondrement de la société maya classique, dont plusieurs villes furent alors abandonnées.
Un phénomène similaire s’est produit lors de la dislocation de l’empire romain, explique Wright: «Rome, sous l’empire, a atteint 500 000 habitants. Il a fallu jusqu’au XXe siècle pour revenir à ce niveau de population. En Angleterre, les villes romaines ont été plus ou moins abandonnées. Les poèmes anglo-saxons parlent de ces ruines vides. En Italie et en Espagne, l’archéologie nous montre clairement que des secteurs avaient été déboisés et où, pendant mille ans, la forêt a repris ses droits. La situation a perduré jusqu’à la fin du Moyen Âge, lorsque la population a suffisamment augmenté pour qu’on occupe de nouveau ces terres.»
En fait, la tendance remonte même au-delà de la civilisation, à l’époque préhistorique, où les hommes ont provoqué les premières extinctions massives de grands mammifères. Comme l’écrit Wright, «les chasseurs du Paléolithique qui ont appris à tuer deux mammouths au lieu d’un seul avaient fait du progrès. Ceux qui ont appris à en tuer 200 ― en faisant culbuter un troupeau au bas d’un escarpement ― en avaient fait bien trop. Ils ont mené la grande vie pendant un temps, puis ce fut la famine.»
e part où aller
Reportés à l’échelle d’une société d’hyperconsommation de plus en plus planétaire, les exemples passés donnent froid dans le dos. Les hommes préhistoriques ou les peuples de Mésopotamie pouvaient toujours déménager et se réinstaller un peu plus loin. L’homme contemporain n’a e part où aller si son système économique et l’environnement se mettent à flancher. «Si nous ne vivons pas à l’intérieur de nos moyens, notre civilisation s’effondrera. Nous ne faisons pas exception à cette règle», résume l’auteur, dont un roman intitulé La Sagaie d’Henderson paraît également ce printemps chez Actes Sud.
«L’histoire se répète et chaque fois, le prix augmente», disait un graffiti cité par Wright. La fin annoncée du pétrole, les conséquences de la désertification de plusieurs zones de notre planète, la menace qui pèse sur la grande majorité des écosystèmes marins et des stocks de poissons qui y vivent, une baisse de la production alimentaire due à la surexploitation des terres ou aux changements climatiques sont autant de facteurs qui pourraient provoquer des dislocations graves dans nos sociétés, et affecter profondément la capacité de l’humanité à soutenir sa population actuelle. «Si notre système industriel tombe, il est peu probable que plus d’un ou deux milliards d’humains puissent vivre sur la Terre», soit la population mondiale à l’orée de la révolution industrielle, explique Wright.
Wright n’est d’ailleurs pas seul à penser de la sorte. Il souligne entre autres les résultats du rapport de l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire, réalisé par l’ONU et publié en mars 2005, qui signale très clairement que l’humanité appauvrit actuellement le capital naturel dont sa vie dépend: «Près des deux tiers des services dispensés par la nature au genre humain sont en déclin dans le monde entier», lit-on dans ce document troublant, qui souligne de plus que «dans bien des cas, nous vivons sur des ressources que nous empruntons littéralement aux générations futures.»
L’humanité condamnée?
Courons-nous irrémédiablement à notre propre perte, comme tant d’autres civilisations avant nous? Est-ce que la terre est devenue une immense île de Pâques, cette terre qu’un peuple a surexploitée jusqu’à couper le dernier arbre des jungles qui la couvraient autrefois? Sommes-nous condamnés? «J’ai de bonnes et de mauvaises journées en y pensant, répond Wright. Je crois qu’il est possible qu’on se faufile à travers les défis qui se posent actuellement: nous avons la capacité technologique et la richesse nécessaires pour y arriver. Ce qui nous manque, c’est la volonté politique. Et un sentiment d’urgence chez nos classes dirigeantes.»
Le fait que les conséquences de nos excès se fassent sentir à long terme crée un problème supplémentaire qui freine l’émergence de ce sentiment d’urgence dans un monde politique et social qui pense avant tout à très court terme. C’est généralement face à des crises majeures, souligne Wright, que l’humanité donne les coups de barre nécessaires: «C’est seulement quand les choses tournent vraiment mal que nous nous mettons à agir. De façon réaliste, il faudrait qu’on passe tout près de la catastrophe pour que tout le monde se réveille. Moi-même, j’espère le mieux, mais je crois que nous devrions prévoir le pire.»
Ainsi, nous devrions notamment chercher à réduire notre impact environnemental partout sur la planète, en évitant notamment aux peuples émergents de répéter les erreurs historiques (et continues) de l’Occident: «Pourquoi laisser l’Inde et la Chine passer par la même étape de développement « sale » que nous avons vécue? Si nous ne maîtrisons pas les choses, les chances de nous maintenir au-delà de quelques décennies se réduisent considérablement.»
Bien sûr, si la civilisation moderne en venait à s’effondrer, la nature pourrait souffler et se remettre des abus perpétrés par les humains. «Mais c’est un processus à très long terme. Et ça, ce n’est pas une bonne nouvelle pour nous», conclut Ronald Wright.
Photo de Ronald Wright: © Neil Graham
*********
Bibliographie :
Brève histoire du progrès, Ronald Wright, Hurtubise HMH, 224 p., 19,95$