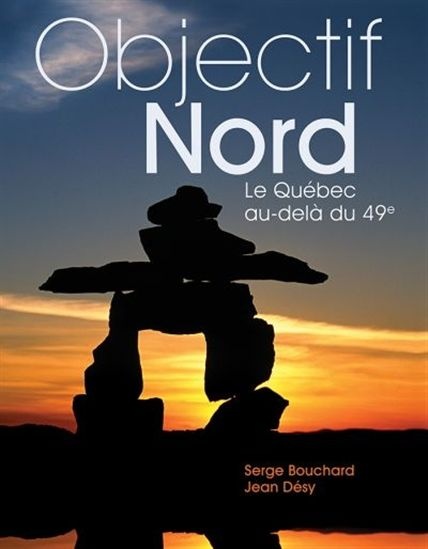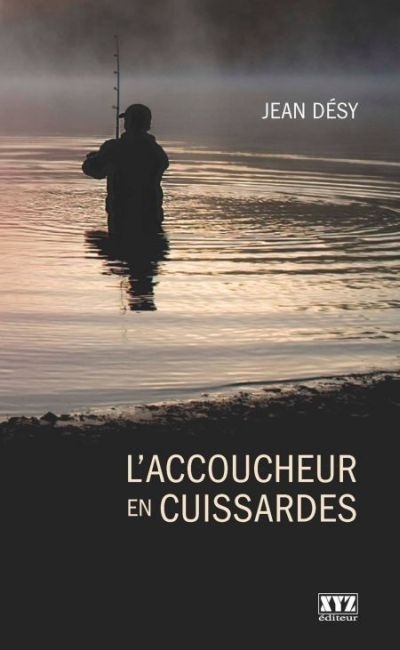On me contacte pour faire un papier sur Jean Désy. Je serai honnête : je ne connais que son nom, que j’ai vu ou lu à quelques reprises. Je stresse instantanément, me dis déjà que le timing n’est pas bon, que je manquerai probablement de temps (je suis entre quatre projets, trois tournées et l’achat d’une maison qui ne vient pas et me laisse pratiquement sans domicile fixe), pourtant, quelque chose m’appelle alors que je prends connaissance de son corpus. En parcourant lentement ses titres (beaucoup), j’ai un semblant d’impression de déjà-vu : je sais, je sens que cette rencontre pourrait me marquer, que j’aimerai l’œuvre de Jean Désy, et qu’il y a là quelque chose qu’il faut que j’aille voir, absolument.
Je m’informe, j’apprends de lui qu’il est diplômé, hautement, en littérature, en philosophie et en médecine, qu’il pratique encore, qu’il enseigne aussi, qu’il voyage et disparaît régulièrement apprivoiser le Grand Nord. Bien que j’aie déjà accepté le défi, je me sens alors indigne de faire face à Jean Désy. Je me sens indigne d’aller à la rencontre de ce coureur de froids, de ce chasseur-pêcheur, de cet homme qui affronte les sommets escarpés comme les plaines vierges enneigées du fond de la toundra. Moi, Gaspésienne déracinée, urbanisée, j’ai peur d’être démasquée. Jean veut m’inviter à visiter son terrain et son campe, dans le bois, pour prendre une longue marche, et parler, surtout. Et je sais que je ne suis pas équipée, que je n’ai rien pour aller jouer dans la nature : entre deux déménagements, mes choses du dehors dorment quelque part au fond d’une boîte ou d’un sac. Suis-je encore capable de perdre mon souffle dans un sentier, d’apprécier la solitude de la nature, les animaux, les mains froides, les pieds mouillés? Et suis-je réellement capable d’écrire à propos de ça?
Au téléphone, la veille de notre rencontre, Jean me demande ce qu’on m’a fait lire de lui. « L’accoucheur en cuissardes, Vivre ne suffit pas, Chez les ours, La route sacrée, en gros », que je lui réponds. « Ils t’ont fait travailler fort », qu’il s’étonne. J’ai envie d’éclater de rire. S’il savait comme j’avais besoin de lui, à ce moment précis de ma vie. Je pense : « On ne m’a pas fait travailler, on m’a fait un cadeau. » Et je suis certaine, en l’ayant survolé, que Jean Désy serait bien placé pour comprendre ces choses de la synchronicité que je nomme là.
Le lendemain, en arrivant près de Saint-Raymond-de-Portneuf, j’ai envie de mettre mon téléphone en mode avion. Jean avait tenu à m’expliquer les directions de vive voix, comme on ne le fait plus, et j’avais eu envie de respecter ça, même si je savais que j’allais utiliser mon GPS. Mais une fois sur les chemins de campagne, j’ai envie de tout prendre avec mes sens et de laisser mon téléphone dans le fond de la voiture. Je roule sans musique et je me concentre à essayer de mettre, de porter, les yeux de Jean. Il y a de la brume, la neige de bord de route est sale. La journée est floue, lourde, il y a de la nostalgie dedans. Une petite pluie tombe, il n’y a pas de soleil, les glaces cèdent et calent sur les rivières. Je prends tout ça, j’essaie de mettre tout ça dans moi et d’arrêter de penser à mes réseaux sociaux et à mes amours tremblants.
Je sais que Jean aime le silence, ou du moins, ce qu’on croit être le silence : le bruit du dehors, de l’animal et du végétal, l’appelle plus que le bruit des humains. Mais je sais aussi que Jean aime les humains. Il les aime probablement plus que la majorité des autres humains. Il aime les humains au point de passer sa vie à les soigner jusque dans leurs plaies les plus profondes, au sens propre comme au figuré. À mon arrivée au restaurant La Croquée, notre lieu de rendez-vous, Jean semble content de me voir, peut-être presque autant que moi. Il se dit enchanté, il m’appelle chère (ce qui me rappelle la Gaspésie, avec ses mesdames et messieurs d’un certain âge, remplis de poésie inconsciente et de bienveillance). Mais Jean Désy n’est pas vieux du tout, ou du moins, il n’en a pas l’air (pourtant, même s’il m’a demandé de le tutoyer, j’ai peine à tenir. À chaque phrase, je dois faire attention, les vous s’échappent de ma bouche sans que j’aie pu les contrôler). Ses yeux sont étincelants et malicieux, on sent que la machine de sa tête fonctionne bien, tout comme celle de son corps, qu’il y a là juste assez de place pour le jeu, la réflexion, la curiosité, et l’aventure aussi.
On monte dans la voiture de Jean pour le petit bout de route tout vaseux qui nous mène de La Croquée à son campe, à la Coopérative du Bras-du-Nord. Je me sens bien. Jean me met à l’aise, chose qui m’arrive rarement, avec des inconnus. Je ramasse mes questions et impressions en paquets dans ma tête, pour plus tard. Je sais que je veux qu’il me parle de nature, d’autochtonie, de nomadisme, de spiritualité, de religion, d’amour, mais aussi de littérature et de féminisme. Mais je n’ai finalement pas besoin de tendre les perches : elles viennent toutes seules. « Tu connais Lou Andréas Salomé? » qu’il me demande, entre deux évitements de trous d’eau. Mais je ne la connais pas. « Tu vois! Tu sais, c’est une des plus grandes psychanalystes, penseuses, écrivaines de l’histoire. Elle a inspiré Freud, Rilke, Nietzsche, et on ne s’en souvient pas beaucoup. » Puis, plus tard, il m’avoue qu’Une sorcière comme les autres, d’Anne Sylvestre, chanson bouleversante sur les femmes dans l’histoire (probablement une de mes préférées au monde), est aussi, selon lui, l’une des plus grandes œuvres musicales et littéraires qui existent, même si elle n’est jamais citée aux côtés de celles de Brel ou de Ferré. Le ton est donné. La connivence est certaine.
Jean a tout prévu. Il a apporté une glacière, du vin, du fromage, de quoi faire à souper, mais aussi des bottes et des pantalons cirés pour moi, pour notre randonnée, sans que je lui aie parlé de mes problèmes vestimentaires. Je trouve ça trop beau et généreux, j’en suis presque émue. Mais une fois arrivés au campe, il me demande de faire du feu pendant qu’il va chercher son skidoo, et la nervosité me gagne encore. J’ai peur qu’il ne prenne pas, le feu. (C’est toujours ça au fond, l’histoire de ma vie : ma peur que le feu ne prenne pas). Sauf que le petit bois s’allume.
Je n’avais jamais réalisé à quel point les mondanités tombent quand on se retrouve face à la vie dans sa plus simple expression : sans eau courante, loin de la civilisation. L’amitié, l’intimité s’installent vite, ne serait-ce que lorsqu’on doit couper une conversation en plein milieu pour dire « pardon, il faut que j’aille à la bécosse pour faire pipi ». J’avertis d’ailleurs Jean dès le départ que j’ai tendance à être indiscrète, que je n’ai pas souvent le filtre qui me permettrait de distinguer les questions normales des questions trop intimes. Jean fait un signe qui pourrait vouloir dire : « Ne t’inquiète pas, il n’y a pas grand-chose qui me gêne. »
Il me montre la cabane qu’il a construite pour Thomassie, le fils adoptif (venu du Nord) de son amie Isabelle, aussi copropriétaire de son campe. Il me le montre avec fierté, me parle avec bienveillance de la vigueur de Thomassie, de ses habiletés physiques, de sa douceur aussi, de sa timidité. « Je n’oserais pas dire que je fais office de figure paternelle pour lui, mais… » Sa phrase s’arrête là, et on se met en marche.
Impossible de passer plus de cinq minutes avec Jean Désy sans parler du monde autochtone, qui est presque devenu sa deuxième nature au fil des années, si on peut dire cela. Jean entrecoupe toujours la conversation d’une anecdote d’un de ses amis cri ou inuit, d’une citation d’une poétesse innue (notamment, d’ailleurs, Natasha Kanapé Fontaine, une amie commune), d’une histoire de chasse ou de pêche avec guide sur les terres vierges du Nord. On discute de l’urgence de revenir au territoire, de mieux le connaître et surtout, de le respecter plus, de l’importance de reprendre notre place dans la nature, au lieu d’essayer de la dominer. On parle de créer des ponts entre les peuples, mais de la difficulté de le faire sans flirter avec l’appropriation culturelle ou l’attitude du colonisateur. Je lui parle de moi, qui ai grandi à côté de la réserve micmaque de Gesgapegiag, de ma honte de ne jamais avoir eu la moindre curiosité à l’égard de leur culture, de mon envie de faire autrement, notamment grâce à ses écrits. Et je sens dans les yeux de Jean, dans ses mots, le même amour et la même admiration pour ses amis, guides, connaissances et patients autochtones que ce que j’ai ressenti à la lecture, notamment, de L’accoucheur en cuissardes.
Et le nomadisme, là-dedans, ce besoin de voyage et de déracinement? Jean m’avoue que chacune des parties de sa vie, de la médecine à l’écriture, de l’enseignement au voyage, fait partie du grand tout, justement, de sa vie; ce qui rend cette dernière possible. Que chaque facette est interdépendante de l’autre. Que l’enseignement le fait vibrer probablement de la façon la plus puissante, mais que la médecine lui permet de partir là où il s’est immédiatement senti chez lui, au Nord. Et qu’il a le besoin d’y retourner, toujours, jusque dans son sang.
Jean me parle de foi, de sa foi, du temps qu’il a pris avant de l’exposer dans son écriture, avec La route sacrée. Par pudeur, un peu. Et que plus le temps avance, moins la pudeur le freine, du moins là-dessus. « La vie, si on ne croit pas en rien, ça ne fait pas de sens, pour moi », qu’il me confie. Je crois que Jean Désy croit par nécessité, qu’il s’est construit, même guéri en croyant, peut-être par extrême empathie et extrême sensibilité, confronté dans sa pratique de la médecine à ce contact particulier que celle-ci donne avec la mort. Jean Désy a la foi, et s’inquiète pour ceux qui ne l’ont pas, et ce, même si la religion pure entre en conflit avec plusieurs facettes scientifiques et philosophiques de sa personne.
Mais c’est peut-être en l’amour qu’il croit le plus. L’amour Agapan plus particulièrement, l’amour universel, qui donne et n’attend rien, l’amour divin tel qu’il existe dans la langue grecque (par opposition à l’amour Stergein [familial], Philein [amical] et Eran [charnel]). D’ailleurs, à ce dernier, Jean Désy n’accorde que peu de mots dans sa littérature, je l’avais dénoté. Pourquoi? « Par pudeur, encore, peut-être. C’est comme ce livre que j’essaie d’écrire depuis des années, dans lequel je me questionnerais sur si, oui ou non, je pourrais, en plein cœur de la toundra, tuer un homme avant qu’il ne me tue, par légitime défense. Si je pourrais le tuer sans remords. Je n’arrive pas à l’écrire, ce livre, c’est trop… » La pudeur, oui.
Une fois arrivés au grand bouleau jaune, on décide de rebrousser chemin. La journée se terminera bientôt. À notre retour au campe, Jean me cuisine un spaghetti sur le brûleur, et le vin rouge qu’on a débouché nous anime et nous fait accéder à un autre niveau de conversation, encore plus ouvert que dans l’après-midi. Il me parle de ses enfants, qu’il adore, d’autres amis, d’amours. Alors, je ne me sens plus comme une jeune fille sans substance : la parole voyage des deux côtés et je comprends que j’ai peut-être ma place ici, finalement, face à Jean Désy, oui, mais aussi face à l’écriture. Je me trouve un peu changée, de la manière la plus clichée qui soit.
Juste avant mon départ, Jean me demande de lui écrire un petit mot dans son livre de bord, comme le font tous ses visiteurs. J’hésite quelques secondes, puis je finis par tracer : « Bonjour Jean, je m’appelle Stéphanie. Je n’ai pas vraiment de maison, pas vraiment de diplôme non plus, et pas de bottes de marche. Pourquoi m’a-t-on choisie pour venir à votre rencontre? Je ne le sais pas. Peut-être pour toutes ces raisons. »
Et je l’ai encore vouvoyé.
Stéphanie Boulay
Elle a lu Anne Hébert, Antoine de Saint-Exupéry, Réjean Ducharme et Marguerite Duras. Elle coécrit, avec sa sœur, des chansons qui parlent de quatre roues, de feu, d’amour et de balades en pick-up. Puis, en 2016, elle signe son premier roman, À l’abri des hommes et des choses, dans la collection « La Shop » de Québec Amérique. Un roman à l’histoire étrange et forte, d’où poignent la colère et la différence chez une jeune protagoniste en marge des repères, qui vit les deux pieds dans la nature. Ainsi, c’est dans une écriture ensauvagée, dans une poésie indomptable, que Stéphanie Boulay libère sa plume de romancière. Pour la sensibilité qu’on devine chez cette artiste, pour son amour du grand air, il était naturel pour nous de la jumeler au poète et romancier Jean Désy, afin qu’ils parcourent ensemble un petit bout de chemin… [JAP]
Photo de Stéphanie Boulay : © Martine Doyon
Photos de Jean Désy et de Stéphanie Boulay : © Stéphanie Boulay