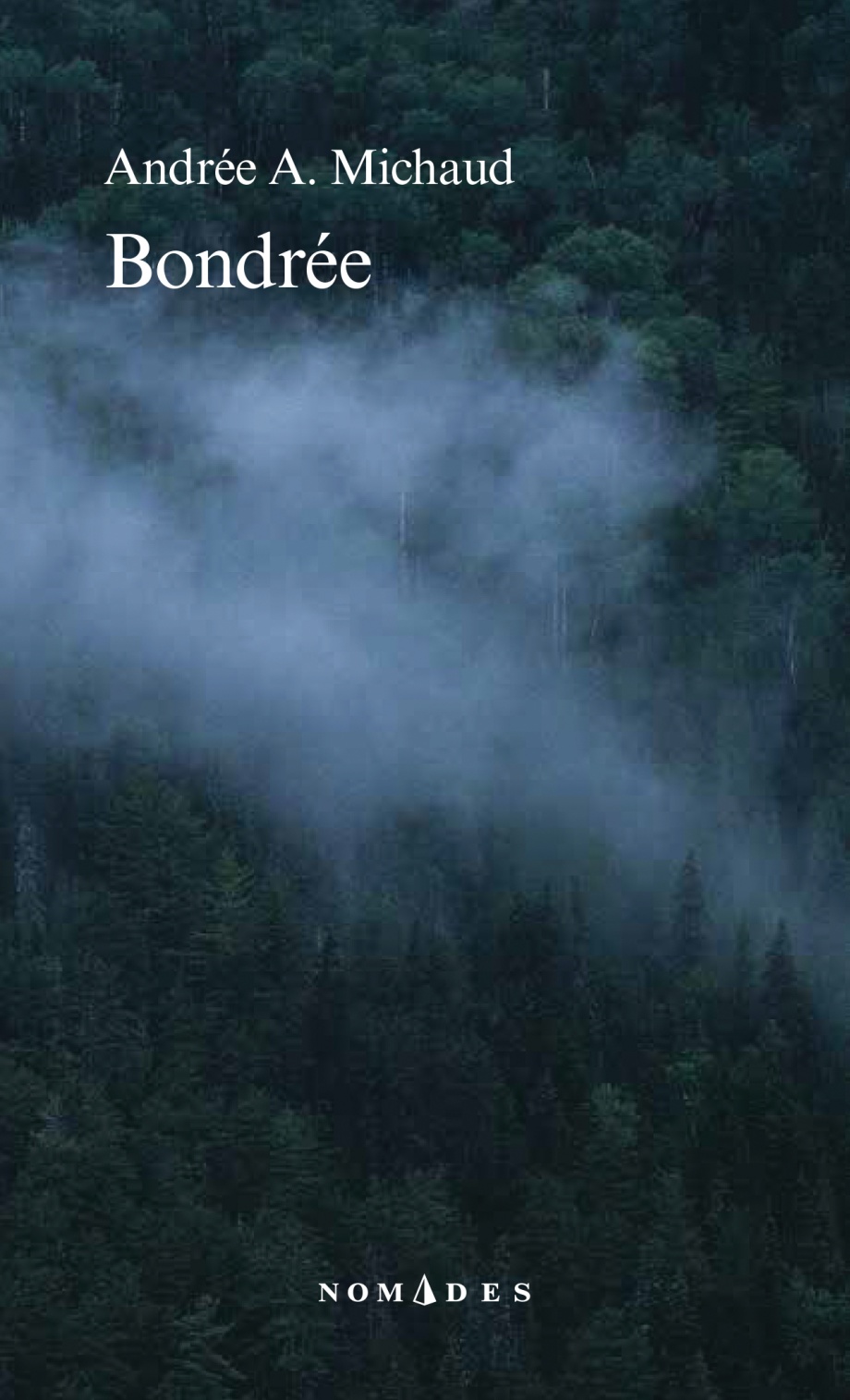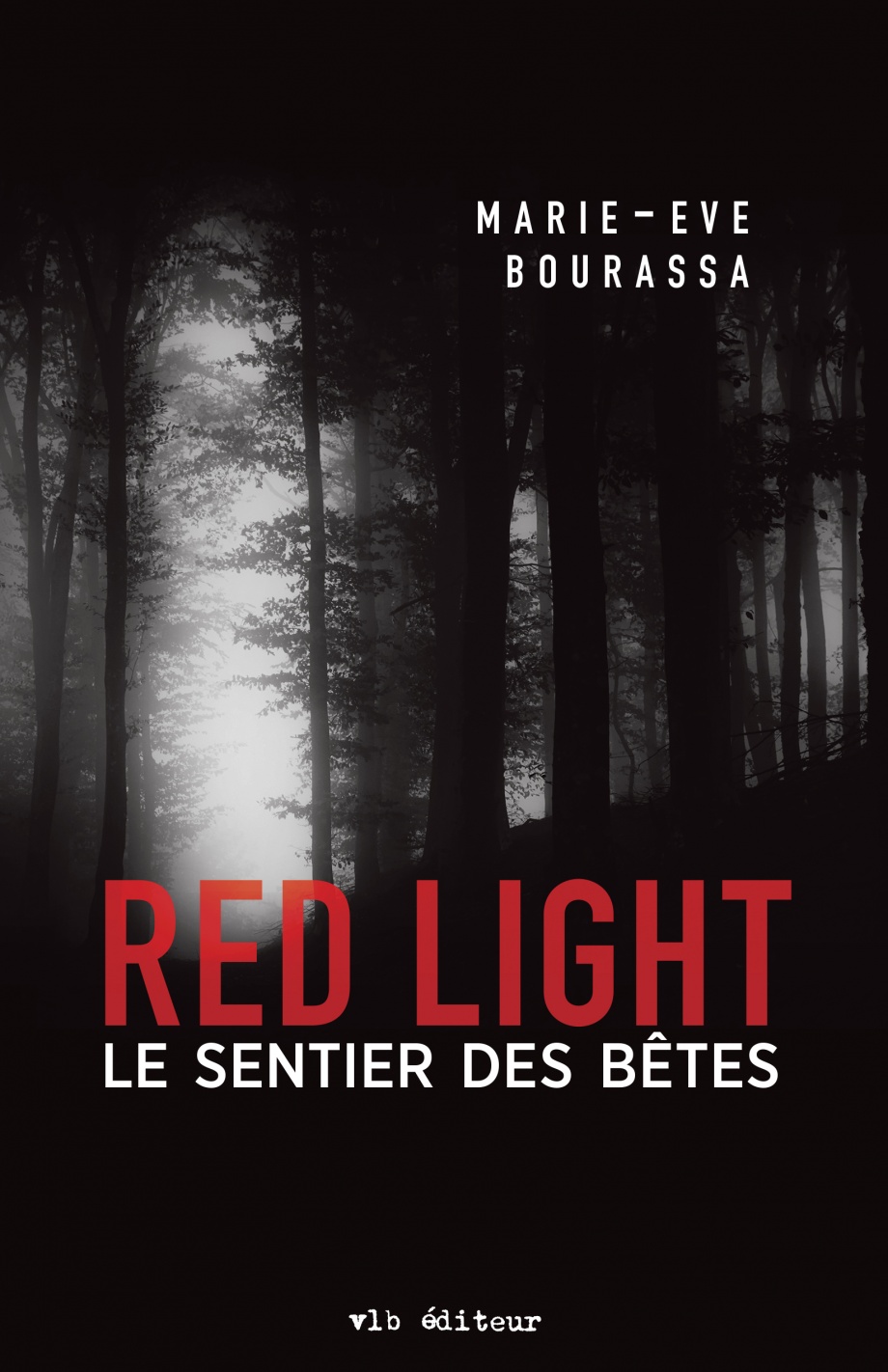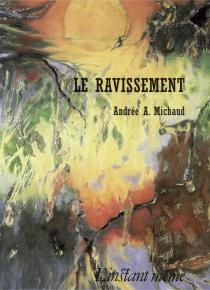« J’en ai même rêvé. » C’est ce que j’ai confié à Andrée A. Michaud au téléphone, quelques jours plus tôt, en parlant de son dernier roman. Le soleil nous honore de sa présence, lui, si discret depuis le début de l’hiver. Il est 8 h 30, et je quitte un Montréal frigorifié, en direction, justement, de ces routes secondaires qui sont venues me troubler jusque dans le sommeil.
La voix de Jim Morrison emplit l’habitacle, people are strange, et je souris : non seulement le timbre chaud contraste à merveille avec la froidure implacable qui s’abat sur nous depuis que l’hiver s’est pointé, mais je viens à peine de terminer Lazy Bird, j’ai fini la veille ce roman où la poésie du chanteur est omniprésente. J’ai donc le cœur gros et léger, c’est ce qui arrive lorsque je dépose pour la dernière fois une œuvre dans laquelle je me suis un peu perdue en chemin; un sentiment contradictoire qui ressemble un peu à celui qui m’envahit chaque fois que j’emprunte la 10, en direction de ce village qui m’a vue naître et avoir 17 ans, avant que je le déserte.
Je roule jusqu’au bout de l’autoroute. Les villages se succèdent, des chemins bordés d’arbres, de forêts sans fin. Une heure à avancer, seule dans ma voiture, la musique trop forte :mon monde est loin derrière et avant même d’atteindre ma destination, me voilà plongée dans l’univers d’Andrée A. Michaud, sur ces routes secondaires qui peuplaient son dernier opus et dont, à l’instar de l’auteure, j’ai eu l’impression de ne pas tout à fait ressortir intacte. J’imagine d’ailleurs ma voiture s’écraser, quitter la chaussée et disparaître dans ce tournant où, qui sait, égarée à des kilomètres de tout lieu habité, après des heures de marche, à mon tour, je tomberai peut-être face à face avec mon double…
Cette bizarre sensation de déjà-vu, unheimlich dirait Freud, s’accentue en arrivant à la maison, la seule qu’on ne voit pas de la route – et devant laquelle je passe deux fois sans m’arrêter, la technologie ne m’étant plus d’aucun secours ici. Les clôtures, les sentiers creusés dans la neige et bien sûr cette nature grouillante d’inconnu, partout : pas de doute, je suis à bon port, à cet endroit qui vit aussi sur les pages de Routes secondaires, quelque part entre le village de Saint-Sébastien, le 4e Rang, la Languette. Andrée m’accueille à l’extérieur, malgré la rudesse toute particulière de ce décembre, ou n’est-ce pas plutôt Heather, Heather Thorne qui le fait? On entre, et comme si l’auteure lisait justement dans mes pensées :« Voici P. » m’annonce-t-elle, en riant, me présentant à son chum, Pierre. Je devine, bien sûr, la présence des chats, toute proche; Holy Crappy Owl, le hibou de paille, doit se balancer au bureau en se demandant qui est cette étrangère, people are strange when you’re a stranger, qui vient perturber la tranquillité de l’endroit.
Il y a cinq ans, Andrée en a eu assez de la grande ville, où elle n’arrivait plus à écrire. Sur un coup de tête, en septembre, le couple décide donc qu’il est temps de migrer, se rapprocher un peu de ces vastes lieux, principaux théâtres des romans de l’auteure. C’est finalement non loin de son village natal que leur toute première maison les attendait, et à peine deux mois plus tard, ils quittent Montréal et emménagent dans ce nouveau nid, en pleine tempête de neige, welcome to the country. Intriguée, je lui demande si elle aurait cru, un jour, retourner vivre dans la région qui avait vu grandir la petite Andrée, et elle m’offre un rictus amusé que je comprends bien. Bien sûr que non. Le problème – si c’en est un –, c’est que lorsqu’on vient de la campagne, il y a quelque chose qui demeure, qui reste là, à l’intérieur. C’est ce que me dit Andrée. Et puis, un jour ou l’autre, cet appel de la nature se fait entendre, de plus en plus fort, si bien qu’on n’a plus vraiment le choix de l’écouter. Peut-être s’agit-il d’un cri aussi puissant que celui qui, au début de l’âge adulte, m’a moi-même incitée à déserter mon patelin, m’évader enfin vers la cacophonie des espaces urbains, troquer la noirceur impénétrable de la nuit et les étoiles pour les lumières de la ville.
La fiction me plaît, en partie parce que je n’aime pas particulièrement parler de moi. Je préfère de loin les histoires inventées d’un bout à l’autre, peuplées d’affreux et d’écorchés. Aussi, je confie à Andrée que je la trouve courageuse de se livrer comme elle le fait, dans Routes secondaires, de se mettre en scène et de se commettre dans l’autofiction. Sur le visage d’Andrée se forme alors un sourire timide : « Est-ce que c’est de l’autofiction? J’sais pas. En fait, j’avais surtout envie que les gens croient que je suis folle », me confie-t-elle, et on rit. Comment oublier ce délectable passage du roman qui m’avait, justement, donné l’impression de toucher à l’auteure : « P. vient de terminer la lecture des 117 premières pages de mon manuscrit. P. vient de descendre pour me dire t’es folle avec un sourire fendu jusqu’aux oreilles. L’air est sourd et je suis heureuse. »
Devant le « vin versé », pour reprendre les mots de mon hôte, on discute. D’abord de bourbon et de tabac, en compagnie de P. Aussi de tous ces bons penseurs qui prendraient plaisir à faire notre procès. Puis de cinéma, de littérature et, bien entendu, de polar. Lorsqu’Andrée évoque cette gêne qu’éprouvent certains envers la littérature de genre, elle le fait au passé, comme si le roman policier ne faisait plus partie d’une sous-catégorie. Elle est d’avis qu’avec le temps, les choses ont changé, qu’elles évoluent encore, et c’est tant mieux. Si jusqu’à tout récemment, les intellectuels n’avouaient pas aisément apprécier l’œuvre de Stephen King, le romanciercompte dorénavant plusieurs adeptes parmi les littéraires. Lire du genre ne serait donc plus un plaisir coupable. Andrée, elle, aime beaucoup King, depuis longtemps, même si elle a été particulièrement déçue par ses derniers ouvrages – et ses fins, Stephen King a bien du mal à terminer ses histoires en beauté… Elle me raconte aussi que c’est avec regret qu’elle avait découvert, préparant un voyage au Maine, que les petites villes de Derry et de Castle Rock n’existaient que sur papier. La force de la narration : certains lieux, comme certains personnages, arrivent en effet à transcender les pages et commencent à vivre dans notre monde.
Raconter est un art, un vrai. Au fil de la conversation me reviennent les paroles de cet autre écrivain qui, entre deux bières, m’avait tout bonnement confié que l’auteur de romans policiers n’était pas là pour faire, et je cite, « de belles phrases »; son rôle se résumait donc simplement à narrer une histoire, à créer une intrigue crédible. Rien de plus. Pas de flafla, pas de style. « La littérature, on laisse ça aux autres. » Pourtant, me rappelle mon hôte, les grands du polar se sont toujours démarqués par une plume incendiaire, des propos acérés, une vision unique du monde dans lequel nous vivons et une critique, ô si essentielle, de nos sociétés. Pourquoi faudrait-il choisir entre littérature et polar?
C’est ce qui nous amène, tranquillement, à nous aventurer du côté des contrées sauvages de Bondrée. Ma rencontre, la première, avec Andrée, c’est en effet à travers l’univers de ce roman percutant que je l’ai faite. Une lecture troublante, inoubliable, nécessaire. C’est avant tout les motsde l’auteure qui m’avaient happée : une narration puissante, poétique, mais profondément ancrée dans la réalité de notrecoin d’Amérique, « immergé dans une mare d’anglophones ». Une langue décomplexée, intègre et vivante, comme on aimerait en voir plus souventen littérature de genre. L’histoire, pour sa part, est poignante, l’intrigue, solide : l’atmosphère régnant dans Bondrée, un mélange de beauté et de laideur savamment orchestré, nous poursuit encore longtemps, après la lecture. Jamais l’auteure ne sacrifie le récit au profit de la prose, et vice-versa : ils se servent l’un l’autre. On ne s’étonne pas que Bondrée ait récolté sur son passage les éloges et les récompenses.Ce qui rend Andrée particulièrement fière, c’est d’avoir remporté les prix Saint-Pacôme et Arthur-Ellis, pour le meilleur polar, ainsi que le prestigieux GG : deux extrêmes, dit-elle, mais des extrêmes qui ne devraient pas être, « genre » n’excluant pas« littérature ».
Mais pourquoi écrire du roman policier? En ce qui me concerne, l’écriture se traduit par un acte de questionnement : ça semble aussi être le cas pour Andrée qui, à travers ce genre, tente de comprendre comment un individu en arrive à commettre l’irréparable. Pourquoi tuer? Au fond, c’est un peu ça, du polar : se forcer à visiter les côtés les plus sombres de l’être humain. S’enfoncer « dans ces creux latéraux au fond desquels s’entassent les déchets, cadavres, obstacles ou vérités trop crues pour être offertes à la vue de qui ne peut supporter l’omniprésence de la mort », peut-on justement lire dans Routes secondaires.
De ma chaise, à la table de la cuisine, j’ai une vue sur le grand bureau d’Andrée. Je passe de lui, à mon hôte, à la chatte qui mange dehors, derrière la porte vitrée : une chatte errante qu’Andrée nourrit depuis quelques jours. La fille de la ville envie le spectacle qu’Andrée peut admirer tous les jours par les larges fenêtres de cette pièce sur lesquelles les bombyx doivent venir se cogner en été : les oiseaux, les arbres, les différentes intempéries. Elle a même aperçu un lynx, il n’y a pas si longtemps. Des centaines de livres côtoient la romancière, dans ce bureau et sur chaque étage de la maison. « Il y en a même au sous-sol », et je me dis que c’est un peu ça, le paradis d’un auteur : absolument tout ce qui l’entoure est là pour l’inspirer.
À étudier le titre des livres et ceux des nombreux films (j’aperçois, entre autres, la télésérie Twin Peaks) se trouvant dans ses bibliothèques, les quelques affiches qui décorent les murs de son espace de travail (comme ce cadre d’un roman de David Montrose), on devine qu’elle affectionne sans retenue le polar. Mais Andrée ne se cantonne pas à un seul genre : elle est habitée d’un besoin de se réinventer, de la crainte de finir, immanquablement, par se répéter. J’en viens d’ailleurs à me demander s’il ne s’agit pas de la peur universelle de tous les auteurs : celle d’écrire le même roman, encore et encore. De là cette volonté de prendre des risques : « Quand j’écrivais Routes secondaires, je me suis beaucoup questionnée : est-ce que je me tire dans le pied en écrivant cette histoire? » Après le succès rencontré par Bondrée, il aurait peut-être été plus simple dedonner une nouvelle vie à l’inspecteur Michaud, ou à la petite Andrée. Mais cette crainte de tomber dans la redite demeure, même si elle ne se ferme pas totalement à l’idée d’une suite, un jour. Et en ce qui a trait à Lazy Bird? que je lui demande : « J’ai tué tous les personnages forts », me répond-elle doucement, comme attristée par leur disparition.
Parlons-en, des personnages. On rigole un peu sur le fait qu’on s’évertue à créer des personnages beaux et complexes, des personnages auxquels on s’attache tant… Des personnages qu’on traite surtout si mal. De telle sorte que leurs afflictions et leur douleur semblent parfois même nous traquer, et j’ai en tête l’image de Max Cady, le fou furieux de Cape Fear obsédé par l’idée de se venger de celui qui a causé sa perte. C’est d’ailleurs un constat que fait Andrée A. Michaud, le personnage de Routes secondaires, qui compare sa propre blessure, une cicatrice en forme de M, à celle qu’elle a « dessinée, il y a de cela longtemps, sur la peau de Sissy Morgan, une jeune fille morte au bout de son sang », dans Bondrée. Ainsi, nos personnages nous accompagnent; nous devenons aussi, parfois, nos propres personnages. Ça m’amuse – et ça m’inquiète. Étrangement, il y a, de mon côté, cette toux trop creuse dont je n’arrive pas à me débarrasser malgré le repos et les jours sans vin et qui me réveille la nuit… Voilà que je regrette d’avoir eu l’inélégance de donner la tuberculose à mon Herb qui, avouons-le, ne méritait certainement pas un tel châtiment.
Et pour le futur? Andrée me confie avoir perpétuellement une œuvre en court, qui prend peu à peu forme, des projets qui naissent alors qu’on accouche d’autres idées. « Si j’ai un roman en chantier, je ne peux pas mourir. J’ai cette drôle d’impression qu’on ne peut pas mourir tant et aussi longtemps que quelque chose n’est pas terminé. » J’aime ça. Beaucoup.
Je pars pendant qu’il fait encore jour, question d’avoir quelques minutes de clarté sur les trois heures qui me séparent de Montréal, cette ville à qui, en attendant à mon tour l’appel de la nature, je me sens toujours appartenir. Je referme la porte de la maison derrière moi, disant au revoir à Andrée, à P., aux chats.
J’ai presque l’impression d’entendre Holy Crappy Owl me saluer, lui aussi.
Marie-Eve Bourassa
Formée notamment en scénarisation, ce qui transparaît dans ses dialogues forts et son écriture rythmée, Marie-Eve Bourassa a séduit les lecteurs avec sa trilogie « Red Light », dont le premier tome a été récompensé du prix Arthur-Ellis et du prix Jacques-Mayer. Avant de s’intéresser au quartier mythique de Montréal, Marie-Eve Bourassa avait auparavant publié Par le feu et Élixirs : Une petite histoire illustrée des cocktails, ouvrage dans lequel elle raconte entre autres l’origine de certains cocktails. C’est d’ailleurs derrière un bar de Montréal que l’étincelle de sa série enivrante a eu lieu, nous a-t-elle déjà révélé dans une entrevue entre nos pages. Elle a eu envie d’en connaître davantage sur ce quartier chaud quand on lui a appris que le bar où elle travaillait était un ancien bordel. Et comme « Red Light » se passe au temps de la prohibition dans l’univers glauque et enfumé des années 20, au milieu des cabarets et des bordels, l’alcool y coule aussi à flots. [AM]
Photo d’Andrée A. Michaud et Marie-Eve Bourassa : © P.
Autres photos : © Marie-Eve Bourassa
Photo de Marie-Eve Bourassa : © Mathieu Rivard