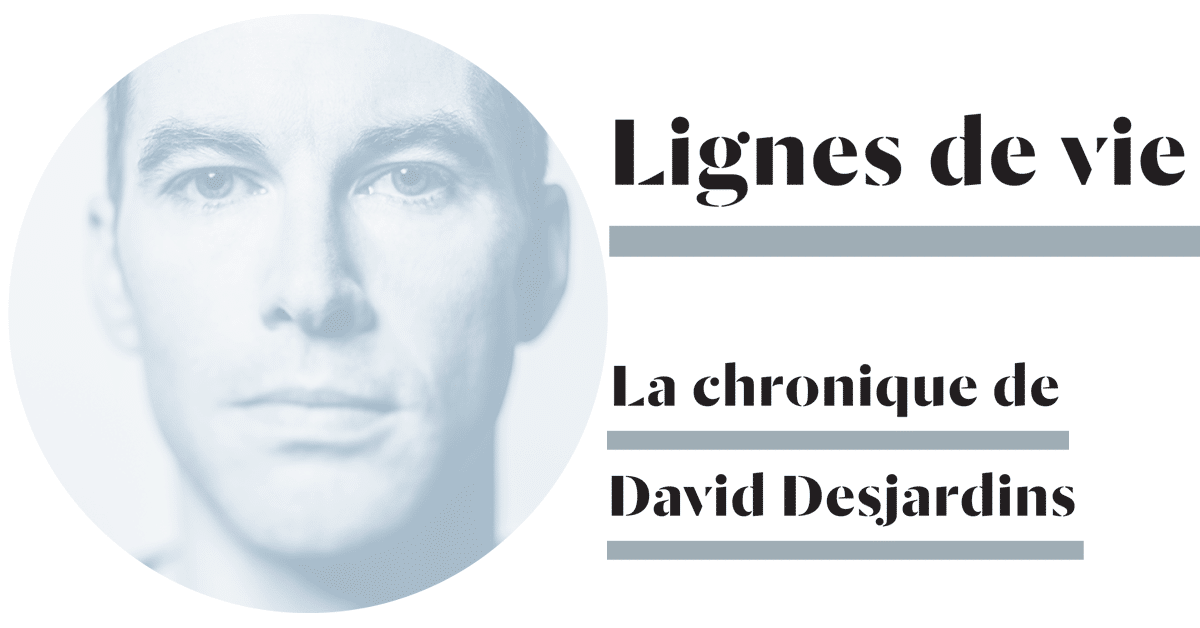Sur la pile à lire, dans le fatras qui fait office de bureau, mais où je ne travaille plus jamais, je prends La classe de neige, d’Emmanuel Carrère, en Folio.
Pourquoi celui-ci, pourquoi maintenant? Pourquoi l’ai-je acheté, en usagé, je ne sais où ni quand exactement? L’envie d’un livre est bien mystérieuse.
Je l’ouvre, donc, avec la ferme intention de l’inhaler d’un trait pendant la fin de semaine. À la première page, une précédente propriétaire a inscrit au stylo son nom et son numéro de téléphone.
Marie-Hélène Laporte, 418 XXX-XXXX.
Ce classique de Carrère fait glisser le lecteur jusqu’au cœur de l’horreur sur le traîneau d’une prose duveteuse, enveloppante… qui finit par vous étrangler d’effroi. Je l’ai effectivement aspiré, d’un coup, comme une bouffée d’air glacial.
Mais Marie-Hélène, elle? Qu’avait-elle pensé du livre? Quel passage l’avait marquée? Qui était-elle au juste? Soudainement, l’acte de lire n’était plus solitaire, mais je ne pouvais pas non plus dire que je pouvais en partager quoi ce que soit.
Je n’aurais jamais osé appeler…
Et puis cette pensée m’a quitté comme elle m’était venue. On n’a pas vraiment le luxe d’imaginer la vie d’inconnus avec pour seuls indices un nom, un numéro de téléphone, et le choix d’un livre qu’ils ont ensuite bazardé. Il faut aller vite, passer à autre chose. Rêvasser nuit à l’efficacité.
À moins d’être écrivain.
Si j’étais Patrick Modiano, sans doute serais-je parvenu à créer un récit parfaitement anxiogène en cherchant à retrouver cette lectrice pour je ne sais quel motif plus ou moins absurde, mais virant à l’obsession. Le narrateur, après avoir appelé le numéro puis raccroché, se mettrait à fréquenter le même bouquiniste où il a acheté le bouquin dans l’espoir de croiser Marie-Hélène, ce qui se produirait. Il se mettrait alors à la suivre sans savoir pourquoi, pendant des jours, la traquant dans les boutiques, et de zinc en zinc.
C’est la chose qui me frappe le plus dans les romans du Nobel de littérature : le temps. Cette capacité des personnages principaux, mais le plus souvent du narrateur, à disposer d’heures qui se dilatent presque sans fin pour mener des quêtes où plane l’intoxicant mélange de mystère, d’oisiveté et de danger.
C’est là, il me semble, que j’y puise le sentiment de nostalgie qu’il déploie pourtant ailleurs, comme dans les descriptions d’un Paris disparu avec sa jeunesse. Comme c’est encore le cas dans le très beau Souvenirs dormants, qui m’a réconcilié avec l’homme au paletot gris : depuis quelques livres, je m’étais mis à m’ennuyer en le lisant. Comme si je ne croyais plus aux menaces floues qu’il distille dans ses récits, et que leurs dénouements vaporeux s’étaient mis à m’agacer.
Ce Souvenir dormants n’est pourtant pas bien différent du reste de cette œuvre qui revient toujours sur la même chose : l’étude des fantômes qui nous hantent. Une étude pour piano, devrais-je dire, puisque Modiano écrit de la musique déguisée en romans. Celle-ci se déverse dans le cœur du lecteur comme les Nocturnes de Chopin, lancinante comme une bande-son de Philip Glass.
Olivier Adam chasse lui aussi le fantôme. Du moins sa narratrice.
Avec, ici encore, une grande maîtrise du style qui fait rebondir les mots sur une partition plutôt qu’une page blanche.
Et ici aussi, plane un vif parfum de nostalgie.
C’est peut-être une affaire française. L’état d’esprit d’un pays au bord de la crise de nerfs – qu’Adam décrivait d’ailleurs avec une causticité à fleur de peau dans Les lisières.
Même Virginie Despentes s’y est mise. J’y reviens plus loin.
Adam, donc. Chanson de la ville silencieuse. Quelque chose de Modiano chez cette narratrice à la recherche de son père, porté disparu, déclaré mort, mais qu’on aurait aperçu quelque part à Lisbonne. Un père rock star, légendaire. Quelque part entre Bashung et Djeunny. Populaire, mais avec du génie. Consumé par l’ego du créateur adulé. Une idole de la France d’autrefois, une manière ancienne de faire la musique, de l’envisager.
Il y a donc la musique dans le récit, la forme. Et partout, l’idée d’un paradis perdu, d’une innocence réduite à l’état de souvenir. Adam termine ses phrases avec un soupir plutôt qu’un point.
Chez Virginie Despentes, la nostalgie est dure, elle vous traverse comme l’humidité en hiver. Elle mène au désastre. Ceux qui s’y accrochent et refusent de changer, comme le personnage qui donne son titre à la trilogie Vernon Subutex, risquent de glisser dans les marges de l’histoire, les caniveaux d’une société qui n’en a plus que pour l’hyper-richesse, tandis que les moins nantis sont promis à l’hyper-nuit, noire et sans espoir.
Tous ses personnages semblent broyés à divers degrés par le monde dans lequel ils doivent se contenter de survivre. Forcément, on en vient presque à envier les requins, les puissants, les seuls encore vraiment libres dans un univers où tout s’achète. Ces mêmes salauds qui peuplent les étages supérieurs La tour abolie de Gérard Mordillat, tandis que celles et ceux qu’ils écrasent se replient dans le stationnement sous-terrain où ils ont élu domicile.
Ou alors on a des envies de violence, de révolution à rebours, mues par un désir formidablement puissant qu’on nous rende le temps, le droit de rêver à un avenir meilleur, les idéaux qu’on n’avait pas encore étouffés dans le cynisme…
Despentes exploite l’idée d’une époque qui meurt et dont nous voyons la fin arriver comme on devine, dans ses dernières pages, la conclusion de La classe de neige : avec effroi, étranglés par la possibilité du pire qui se dessine à l’horizon.
Chaque changement social est une transaction.
Les romanciers jaugent l’époque. Ils nous permettent de prendre la mesure des renoncements à la faveur desquels nous « évoluons ».
Despentes, Adam et Modiano nous racontent un autre temps dont on ignore s’il était meilleur ou pas, mais dont on sait que l’on regrettera sans doute ce qu’on a sacrifié pour aller plus vite, pour être plus efficaces, et qui en faisait la beauté.