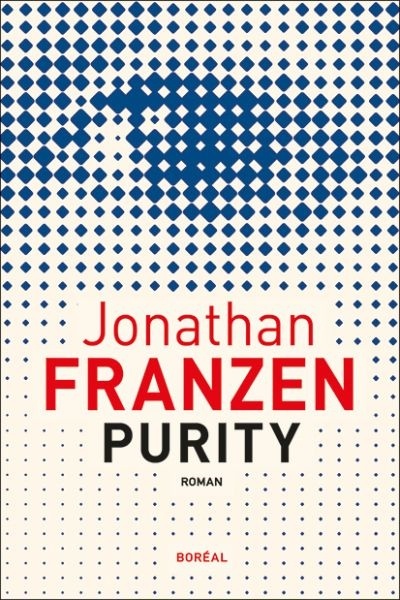On dirait bien que ça y est. Exit la rupture, le clash générationnel. Si le portrait est fidèle, nous sommes dans la répétition du pareil, à quelques nuances de gris pixélisé près.
L’âge ingrat semble avoir intégré les névroses familiales, les accueillir comme un châtiment inéluctable. Les revers d’une génération de boomers passée de hippie à yuppie, puis de X ayant sombré dans l’aigreur consumériste ont-ils à ce point déteint sur les générations suivantes que la seule voie possible soit de se mettre en mode veille?
Ce n’est pas moi qui le dis. C’est ce que racontent mes livres. Deux romans récents sur la jeunesse. L’opulent Purity, de Jonathan Franzen, un « vieux » qui s’épanche en trois briques géniales (et quelques ouvrages plus minces) sur les déboires de la famille américaine. Et puis le plus modeste Nouvel onglet de Guillaume Morissette, une nouveauté de l’automne, aussi traduite de l’anglais.
Les deux détaillent le même engourdissement de vingtenaires. Un peu comme si tout était brisé, que la seule chose à réparer était l’espoir, et qu’en attendant qu’on la ressorte du garage, on avait choisi le repli sur soi déguisé en ouverture sur le monde; réseaux sociaux en bandoulière, hypersolitude dans la foule sentimentale qui a soif de Pabst comme d’idéal.
La coolitude résignée de papa et maman a-t-elle eu raison de la révolte adolescente?
On dirait bien. Aussi, on a souvent envie de se fâcher contre le narrateur de Nouvel onglet. Natif de Québec, celui-ci migre vers Montréal où il laisse son identité se dissoudre dans la communauté anglophone. Aucune aspiration. Même pas de colère. Une vie sur le respirateur, des jours qui s’évanouissent sur YouTube, des nuits noyées dans la bière et les psychotropes, des relations de surface où les seuls vrais dialogues se déploient dans Messenger.
WTF?, a-t-on constamment envie de lui hurler. T’es en train d’échapper ta vie. Ajoutez ici l’émoticon approprié.
Comme chaque fois que le portrait est juste, il fait mal, et on se fâche un peu contre son auteur. Ici, on pourra reprocher à celui-ci d’avoir si parfaitement intégré la fadeur de ses personnages qu’il finit par en imprégner sa prose, réchappée en partie par une forme où les ellipses à répétition nous font changer de scène comme on butine entre les onglets, justement.
Je m’y suis ennuyé plus encore que dans l’autobus depuis lequel j’écris cette chronique. Mais comme la trame du paysage autoroutier raconte nos dérives modernes à travers la beauté de champs et la laideur de nos constructions qui les défigurent, Nouvel onglet est un spectacle plus instructif qu’agréable. Voici ce que fabrique ce monde épuisé : une jeunesse déjà vieille. En cela, ce roman, à défaut d’être passionnant, fait œuvre utile.
C’est autre chose chez Jonathan Franzen. D’abord parce qu’on a sans doute ici affaire à l’auteur du plus important roman américain des vingt dernières années (Les corrections), mais aussi parce que le maître n’a rien perdu de ses talents de portraitiste. Le romancier parvient à sonder la psychologie humaine avec une si remarquable acuité qu’on voudrait que ses livres, bien qu’obèses, ne se terminent jamais; ils ne sont pas des miroirs, ce sont des microscopes braqués sur nos âmes.
Le voilà donc qui refait le parcours des névroses de personnages qui sonnent vrai, remontant dans leur enfance, à la manière du psychanalyste, pour trouver le moment où un truc se brise.
Chez le personnage de Purity, que tout le monde surnomme Pip, c’est la faute à la mère. Une excentrique, hypersensible, folle patentée, surtout. Coupée du monde, elle se sauve de la normalité dans les replis du brouillard des collines de Santa Cruz. Depuis San Francisco, où elle mène une vie dépourvue d’ambition comme de plaisir, sa fille n’échappe pas au joug de cette femme qui confond l’amour et l’étouffement.
On pense à la mère des Corrections. On pense aussi à Patty dans Freedom.
Mais les pères ont aussi tort que les mères dans ces romans comme dans Purity, et leurs obsessions condamnent leur progéniture à l’errance, le cumul des erreurs familiales devenant le seul legs valable. Un apprentissage de la vie à la dure.
En ce sens, Franzen réécrit ici le même roman pour la troisième fois, avec pour théâtre de sa tragi-comédie, les limbes du courriel et de la décryption des sous-entendus de textos équivoques. La jeunesse, ici, comme dans Nouvel onglet, est paralysée. Comme si le monde qui s’offrait à elle était trop vaste, et les sentiments véritables trop vrais pour qu’on puisse les soutenir.
Chez Morissette comme chez Franzen, ce qui ressort avec le plus de violence dans ce cynisme consommé, avec l’ironie comme armure, c’est la difficulté d’aimer. La peur maladive de se tromper, de faire comme papa et maman : vieillir et s’ennuyer. Alors pourquoi attendre? Emmerdons-nous maintenant si le futur n’augure rien de mieux.
Mais ce n’est pas autant l’affaire d’une génération que d’une époque que racontent ici ces auteurs. Suffit de regarder mes connaissances qui ont dépassé l’âge tendre des protagonistes tandis qu’ils scratchent les possibles sur Tinder pour bien comprendre que le gavage technologique est en train de fucker notre rapport aux autres. Et que notre peur de l’échec est devenue notre principale source de désengagement généralisé.
Comment faire quand les marques agissent comme des gens et les gens comme des marques, comment faire le tri dans ses sentiments? Peut-on aimer Forever 21 comme on aime Francis? On nous a trompé, intimement et collectivement. Et nous n’en revenons juste pas.
Intelligences artificielles. Algorithmes qui nous connaissent mieux que nous-mêmes. Le futur est advenu. C’est maintenant. Et si j’avais 20 ans, moi aussi, j’aurais peur de la vie dans ce monde que nous avons préparé pour eux, et qui ressemble à un jeu vidéo générique, ni bon ni mauvais. Juste un peu décevant. Mais auquel on consacre nos heures d’éveil.
Mais oh! tout n’est pas perdu. Ils éteindront bien la console. Faisons-leur confiance. Ma seule envie, c’est qu’enfin la colère parvienne à sourdre et qu’ils nous répondent comme nous le méritons. Pas en caricaturant notre apathie. En faisant tout péter, tiens.