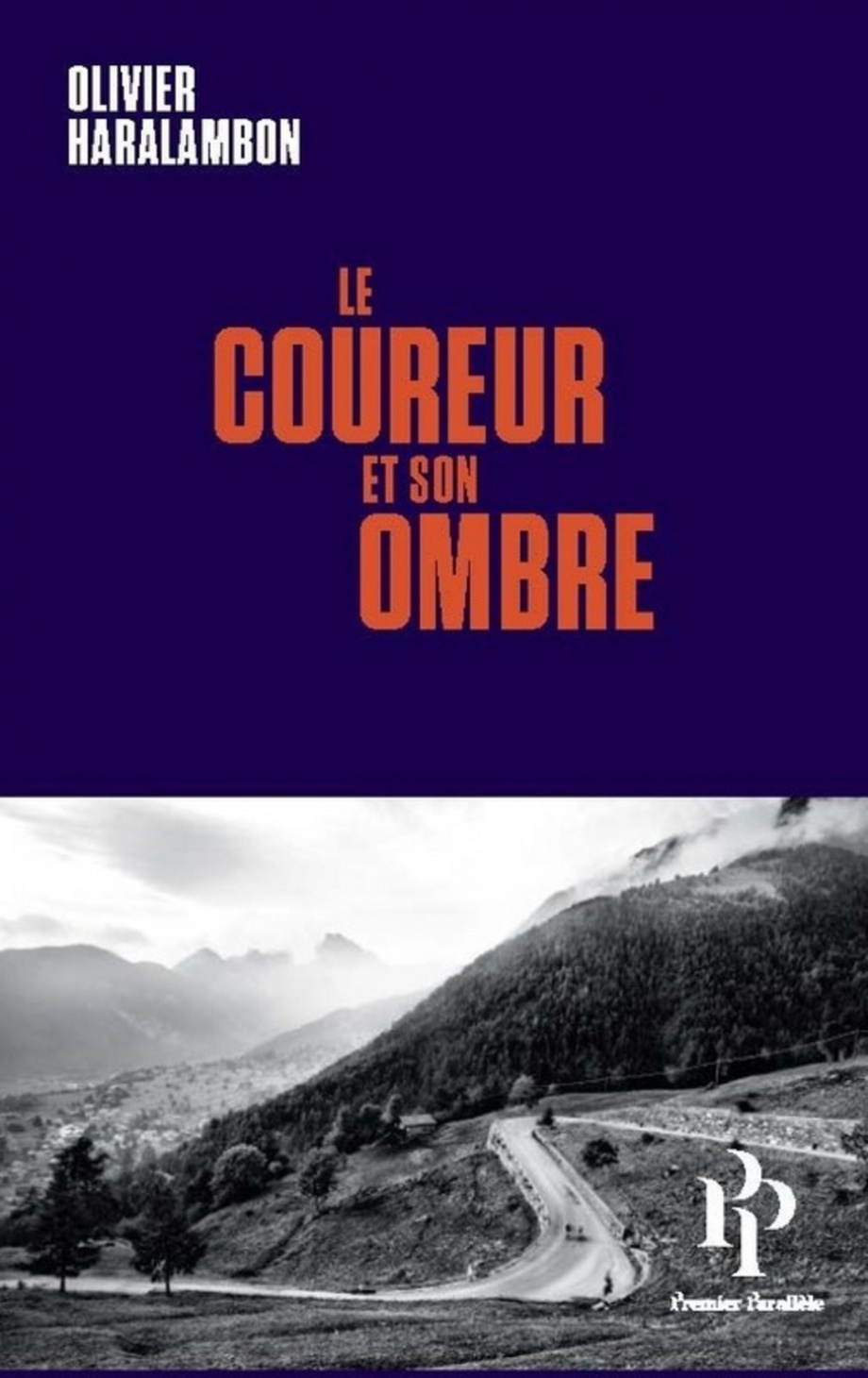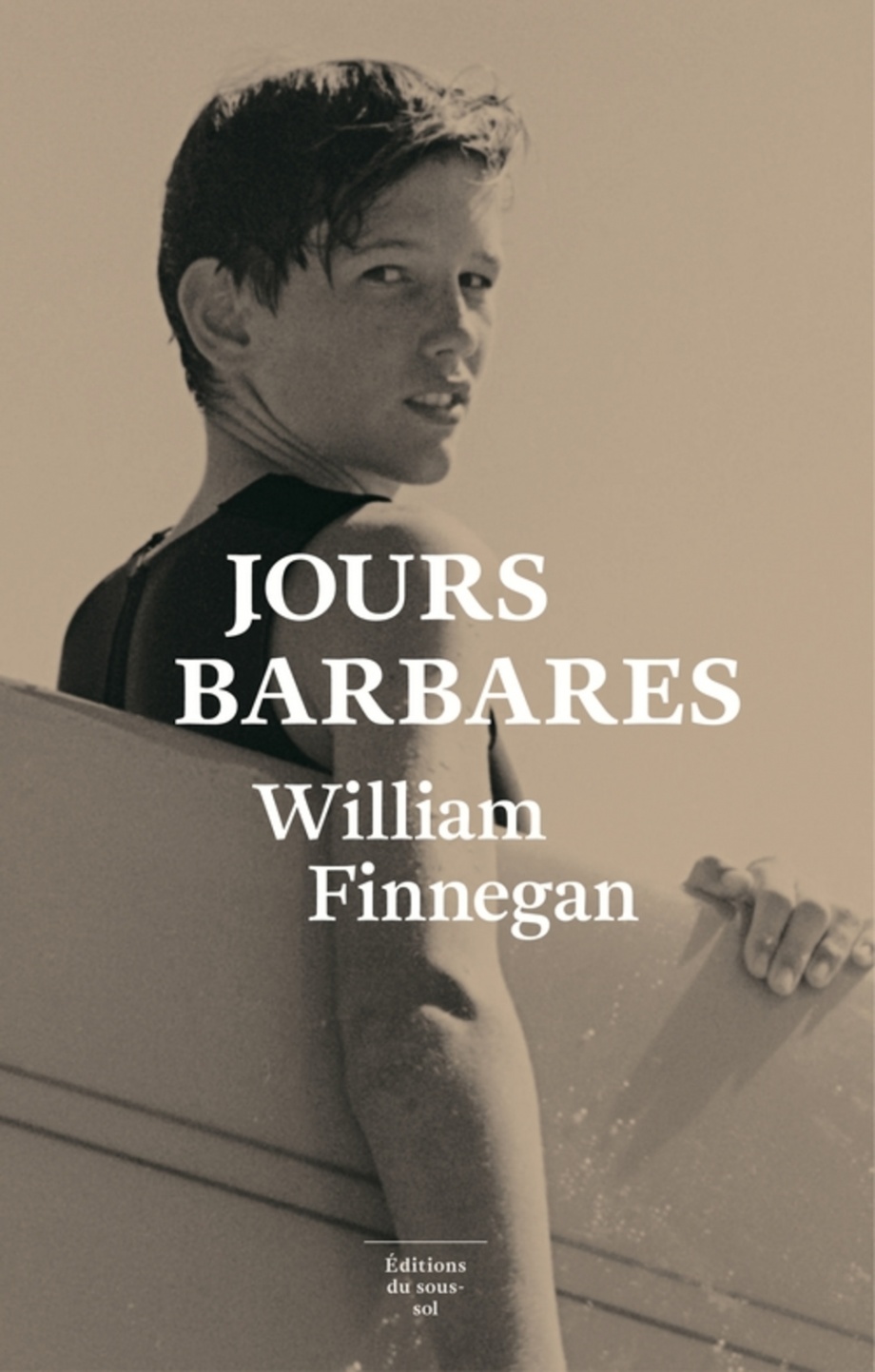C’est juillet. Des pixels s’agglutinent pour tracer minutieusement le détail de la meute chatoyante des coureurs du Tour de France. Le peloton s’étire ou se resserre sous le bleu chauffé du ciel qui touche aux cimes des Vosges, des Alpes, des Pyrénées. Lors des pauses, l’écran de mon ordi passe au noir juste avant que s’affiche la pub. Y apparaît alors le fugace reflet de mon torse nu, mon épaule barrée d’une cicatrice brochée qui me condamne à l’inertie.
Par ma fenêtre, l’azur délavé multiplie les faire-part que je tente d’ignorer, mais dont je suis obligé de constater qu’ils s’empilent dans ma tête, jour après jour, celle-ci bientôt sursaturée, comme une boîte aux lettres abandonnée aux dépôts maniaques des livreurs de Publisac.
L’invitation à enfourcher mon vélo et à intégrer le paysage demeurera lettre morte pour encore plusieurs semaines. Ma vie est un diagnostic. Mon quotidien, une prescription de confinement. Fractures de la clavicule, du grand trochanter et de l’omoplate. La peau brûlée sur mon côté gauche par une rencontre intime avec l’asphalte à 50 km/h s’effrite en un million d’écales galeuses. Je paye le prix d’une passion. Celle du vélo, plus encore de la course qui en est pour moi son acmé. Chute au peloton. Je suis tombé. Et je ne songe qu’à ceci : remonter en selle.
Le sport est mystérieux. Lorsqu’il vous happe, qu’il s’empare de votre existence, il peut vous habiter jusqu’à vous hanter. Ainsi, le vélo me garde souvent éveillé la nuit. Je revois mes défaites sous tous les angles, mes réussites aussi, mes insomnies devenues analyses techniques et stratégiques. Je ne peux plus vivre sans la vibration d’après l’effort intense de l’entraînement. Le corps entier qui irradie. Le cœur qui bat très lentement et épouvantablement fort. Imaginez la grosse caisse d’un orchestre funèbre à La Nouvelle-Orléans.
Couché dans le noir, j’ai l’esprit chargé des aventures qui ponctuent la biographie de l’homme rangé que je suis.
Un peu comme celle écrite par William Finnegan, dont les Jours barbares (Éditions du sous-sol) ont meublé mes moments libres des deux dernières semaines avant ma chute. Au milieu du livre, je me croyais lassé des histoires de surf de ce journaliste du New Yorker. Je le déposais en me disant : un prix Pulitzer pour ça? Mais j’y revenais tous les soirs, sans comprendre pourquoi.
Né en Californie, ayant passé de grands pans de son adolescence à Hawaï, Finnegan a été mordu par une passion pour la planche qui l’a poussé à tout quitter, à la fin des années 60, pour y consacrer son existence. Une vie de surf bum.
Pourquoi ce récit m’attirait-il? Pourquoi, malgré mon impression de lassitude devant cette écriture efficace, sans plus, revenais-je sans cesse à ce quotidien livré aux flots, brûlé par le soleil et le sel, consacré à la recherche d’une vague parfaite?
Sans doute parce que l’auteur tente de répondre à cette question qui me taraude, et surtout obsède mon entourage qui ne saisit pas ce qui me pousse à me défoncer à l’entraînement et à prendre divers risques pour aller plus vite, pour gagner.
Ce désir de grimper des montagnes, de les dévaler le couteau entre les dents, cette volonté maladive de raffiner le geste jusqu’à la perfection, de repousser mes limites, cela les dépasse.
Chez Finnegan, le surf est une quête en même temps qu’une évasion. Une fuite de la vie domestique. Et en même temps le désir de toucher à quelque chose de pur. « Le surf est une voie, un dessein, pas un sport », lui dit un de ses amis.
Vient le jour où l’errance doit prendre fin. Mais l’obsession perdure. Dans presque tous ses voyages, une planche l’accompagne (comme moi mon vélo). Même à New York, il trouve d’étonnantes vagues qu’il surfe, l’hiver, sous la neige, son corps gainé d’une seconde peau de néoprène.
Ce n’est pas tant dans la réflexion que dans l’accumulation des gestes de cette vie de surf (c’est le sous-titre du livre dans sa version originale : A Surfing Life) que les explications se dessinent. Comme une faim insatiable. Et c’est là qu’est le génie de cet ouvrage qui expose le poids d’une passion en la racontant, jour après jour, année après année.
Dans Le coureur et son ombre (Premier Parallèle), Olivier Haralambon insiste aussi sur l’idée que son sport n’en est pas un. Pour lui, les cyclistes sont « des danseurs, des funambules, des marins, des écrivains, des toreros, des poètes, des artisans de l’effort, des mystiques, des ascètes, ce que vous voulez, mais pas des sportifs ».
Son livre est magnifique. Sa prose riche, dense comme le peloton qui traverse les rues étroites d’une bourgade belge. La métaphore y exulte. Et elle exalte la beauté du geste chez le cycliste dont il raconte le quotidien dans les rangs professionnels, traitant de ce monde comme d’un vaste organisme vivant. C’est, de loin, ce que j’ai lu de mieux dans le genre. Sans doute parce que Haralambon a fait de la course, comme Finnegan surfe, et que l’intérieur d’une vague ne se raconte pas de la même manière lorsqu’on y est soi-même passé. Les tripes d’un peloton furieux qui déboule vers l’arrivée pour le sprint non plus.
Pourquoi se consacrer à ces sports? Haralambon dit qu’il s’incline devant une part de mystère. Plus journaliste qu’écrivain, Finnegan rejoint l’esprit d’analyse d’un Jon Krakauer qui lui aussi déconstruit son dévorant penchant pour l’extrême dans Into the Wild : plus on donne à cette passion, plus elle donne en retour, finit-il par déduire de ses nombreuses années à chasser les vagues et à tromper la noyade ou l’hypothermie.
Mais que nous donne-t-elle au juste?
Haralambon comme Finnegan constatent la folie que nécessite l’effleurement de la perfection. Mais l’un comme l’autre comprennent bien qu’il y a là quelque chose qui relève du sacré. Un regard tourné en soi, dans l’effort, où le corps poussé jusque dans ses derniers retranchements ouvre une porte vers quelque chose de plus grand que soi.
Au sommet d’un col que j’ai monté à mon allure la plus rapide, plus aucune pensée n’accède à ma conscience. Je ne suis que souffrance. Et ensuite, avec mes amis, nous partageons cette expérience intime de l’effort qui nous tue un peu pendant quelques secondes pour nous rendre à la vie. Sans pouvoir trouver les mots pour exprimer ce qui nous habite, nous savons pourquoi nous allons si loin, si vite, si haut. Et tant pis si les autres ne peuvent pas comprendre qu’au bout de cet effort inhumain se trouve quelque chose comme une forme d’extase qui nous permet de mieux composer avec le vernis du quotidien. Quelque chose comme un instant de barbarie dans un monde trop civilisé.