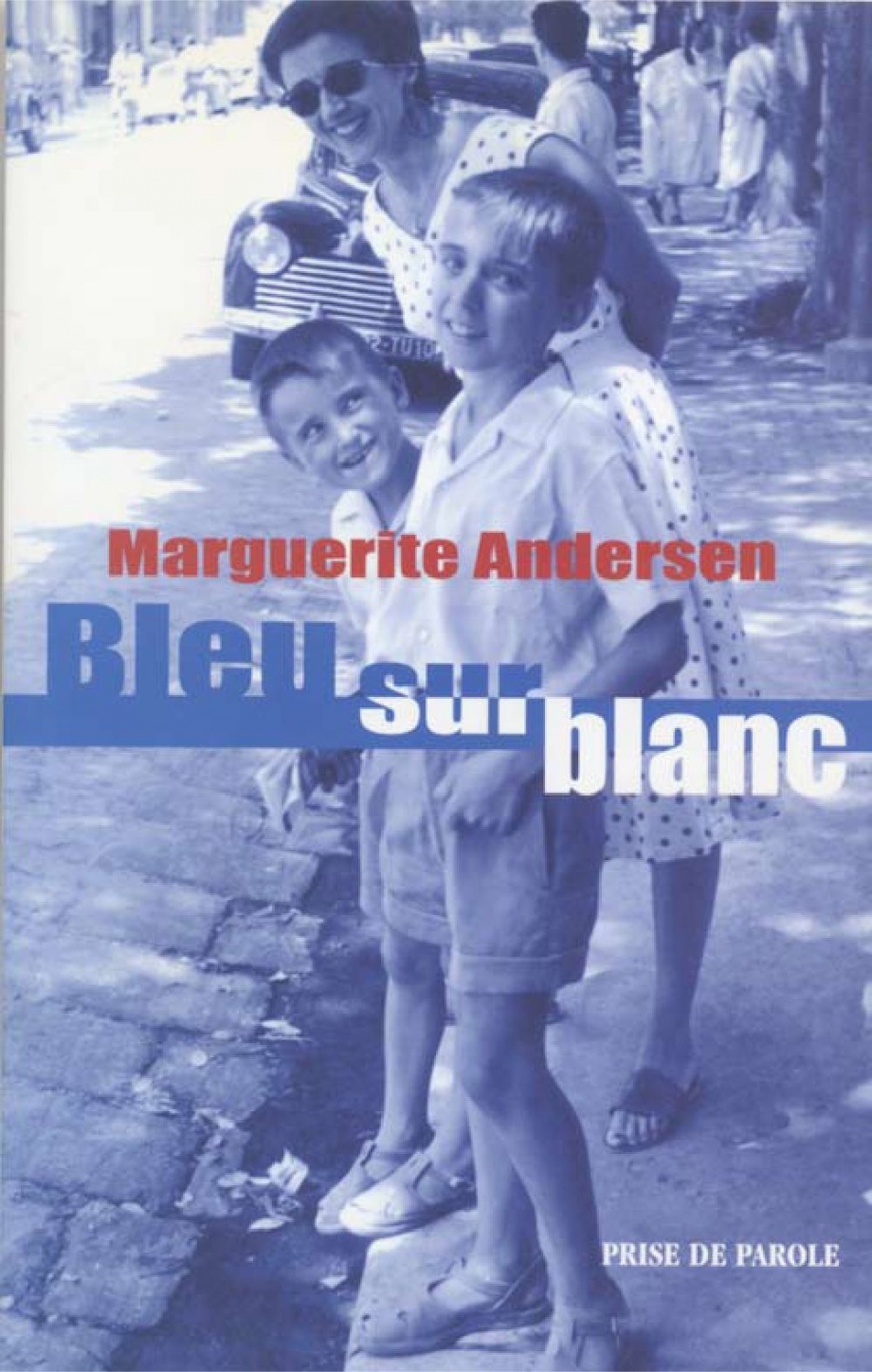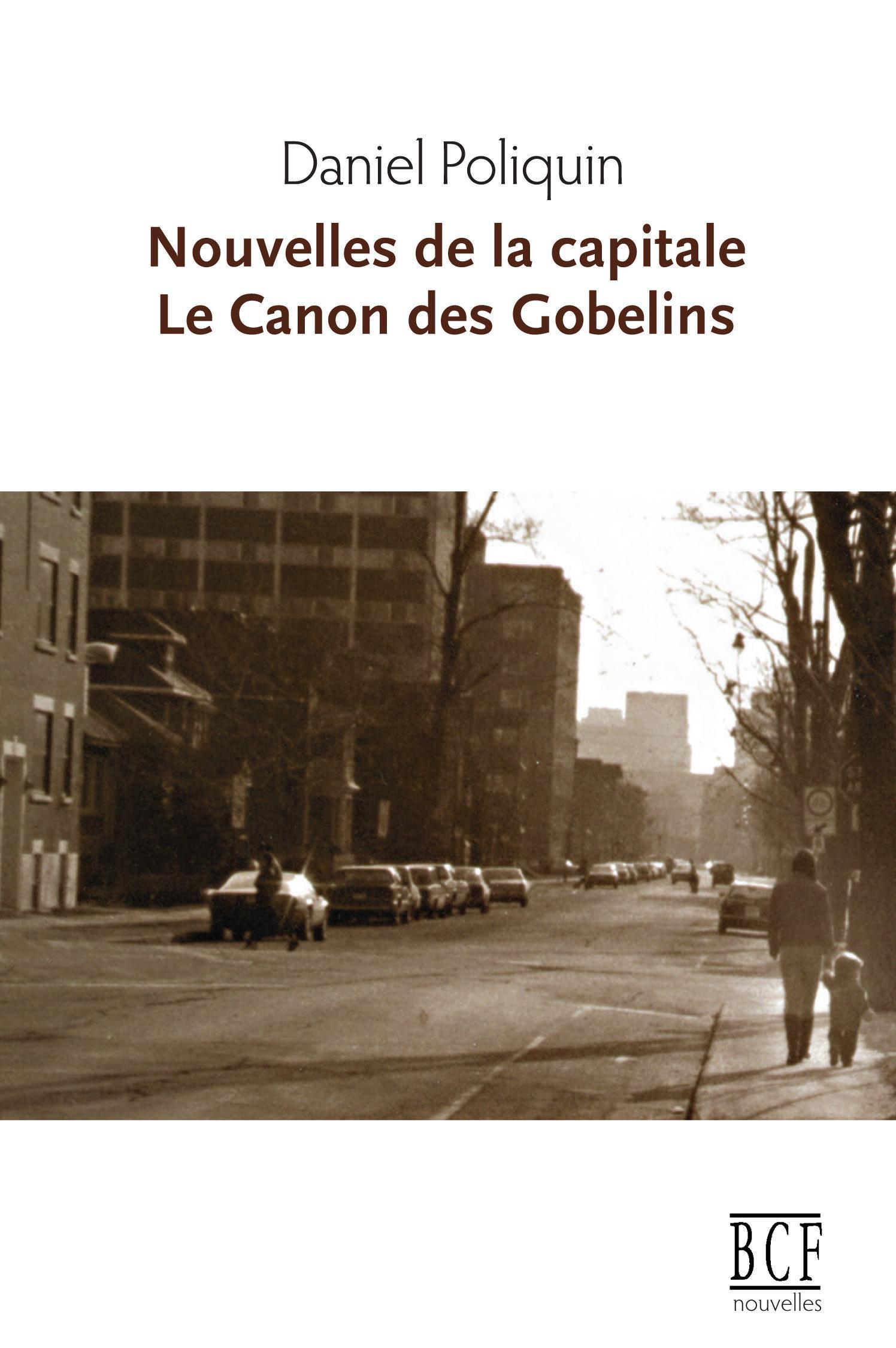La première fois que j’ai entendu le nom d’Ouanessa, c’était le 22 août 2012 et je marchais sur le boulevard René-Lévesque avec des dizaines de milliers d’autres. Après avoir tendu mon poème-affiche Jeanne au cœur de mai au député de Mercier Amir Khadir, ce dernier m’a répondu qu’il fallait absolument que je lise le poème Nous marchons d’Ouanessa… et son nom de famille s’est perdu dans la clameur, le député s’est éloigné, j’ai noté sur un exemplaire de mon poème le prénom de Ouanessa, en le faisant commencer par W, comme un épais qui se magasine une assurance chez Wawanesa. Au lancement de son dernier livre, je suis monté sur scène pour lire ce très beau poème que j’avais recopié à la main juste avant de partir de chez moi.
« Nous marchons parce que le gravier, seul, est insuffisant. Nous marchons pour clamer, nous avons des cordes vocales aux jambes et nous refusons de reculer, de débaptiser les sentiers d’importance. Nous marchons parce que les murs sont des enclos, les instituts, des dérivés de bruits et de dollars braisés. Nous marchons parce que la justice n’est pas seulement une idée : elle a des mollets. Nous marchons, et avec un accent grave. »
Il y a dans cette poésie quelque chose de si précis, quelque chose qui est à mille lieues de ces lentes métaphores s’autodigérant dans une métaphysique vide et sonore, à mille lieues de ces grosses machines à images que l’on couvre de prix. Pas étonnant, à ce compte, que les gens ne lisent pas de poésie! Au lieu de cette beauté désarmante, de cette marche où les mots ne sont plus à la remorque de l’image, on encourage le huis clos de la pensée poétique qui se sent si fière de se comprendre elle-même!
Évidemment, la pluralité des démarches poétiques n’est pas chose à proscrire, c’est plutôt l’hégémonie stylistique qui nous entraîne sur la mauvaise pente. Tant mieux s’il y a des formalistes, des spiritualistes, des exotiques, des amphibiens! Tant qu’on ne récompense pas sans cesse le même genre de salades, je ne vois pas pourquoi on encouragerait tel légume plutôt que tel autre. Cessons la métaphore potagère, elle pourrait m’attirer des ennuis. La clé est dans l’authenticité de la démarche, dans la voix sincère et réelle qu’elle nous laisse entendre. La voix d’Ouanessa Younsi, claire comme de l’eau de roche, mérite que l’on s’y attarde.
Son dernier recueil, Emprunter aux oiseaux, s’ouvre sur un prologue bouleversant qui nous explique bien l’origine du projet : sa grand-mère qui souffre d’alzheimer, sa propre condition de médecin psychiatre. Le langage qu’elle a appris de son aïeule, celui qu’elle lui offre maintenant pour que la beauté triomphe de la mort : « Empruntant la fragilité aux oiseaux, rencontrant et racontant ma grand-mère, je plaide la nécessité de la poésie, qui plonge là où la science recule. La poète accompagne la tempête pour l’apprivoiser et la traduire. Oppose la présence au délire. »
À quel chemin s’attarder lorsque la route est tout à coup dénuée de signes, privée de flèches? Ouanessa Younsi a choisi de faire parler sa grand-mère en filigrane dans sa litanie pour que nous soyons à même de saisir l’extrême frontière qui, de la mémoire la plus intime à sa perte inéluctable, départage les eaux mouvantes du langage entre l’appartenance et l’invention : « Une petite fille épelle/l’effondrement/des cathédrales//ne lâche pas/ta douleur/ne part pas//rédige l’épreuve du lien ». Ainsi s’ouvre la première de ces litanies où s’enchevêtrent les paroles brouillées de la grand-mère, ces paroles qui tentent de s’accrocher au réel et brisent leur barque sur le roc de l’oubli. Les italiques nous indiquent le passage de l’une à l’autre, comme si une voix extérieure au poète prenait en charge le drame intérieur qui se joue au fil des mots : « les diables//ils coupent/mes seins//sauve-moi/sauve-moi ».
Et il y a de ces moments où le réel entre dans la danse pour s’anéantir dans les mots et donner un souffle fulgurant à l’éclat des images tendues comme des fils au-dessus du volcan : « niveau de soins/ne pas réanimer//la robe approche tes os/comme le collet/les lièvres ». Et d’autres où la détresse enfantine de la maladie confine à un absolu qui tente vainement de passer à travers le chas d’une aiguille : « je ne veux plus aller à l’école/c’est trop lourd/l’alphabet ». Jamais cette litanie ne confond la proie et l’ombre. C’est peut-être là une grande force de ce livre d’éviter le piège du souhait pour aller mordre dans l’impossible en traduisant dans une langue limpide les accents très véritables de la perte vécue de part et d’autre de ce dialogue sans tirets. e part nous n’avons l’impression qu’Ouanessa Younsi cherche à faire parler sa grand-mère : elle nous parle et jamais son fantôme n’apparaît pour nous hanter, sa voix presque crue transperce les voiles jetés sur nos regards et laisse la lumière entrer par la fenêtre : « l’amour change de nom/mais pas de visage ».
Curieusement, Emprunter aux oiseaux est tout sauf un livre déprimant. Il se dégage de certains passages des accents féroces, sensuels, joueurs qui ne cadrent pas avec l’idée que l’on se fait d’une poésie qui aborde un sujet aussi grave. Et puis, quand cette férocité fait place à la lucidité, il se trouve encore une voix pour confronter l’insupportable condition humaine dans une pointe noire au milieu de la blancheur des murs d’hôpitaux : « tu suces ton menton/j’essuie tes selles//bientôt des gens comme moi/tueront/des gens comme toi ». Si Ouanessa Younsi se demande « quel bagage/apporter et démolir », elle pourrait aussi entonner avec les gardes suisses cette chanson, en guise d’au revoir :
Notre vie est un voyage
Dans l’hiver et dans la Nuit,
Nous cherchons notre passage
Dans le Ciel où rien ne luit.