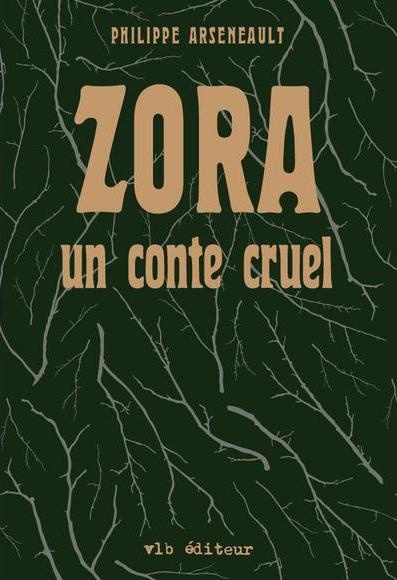« Il y a des écrivains et des raconteurs d’histoires », argue-t-on parfois, dans un besoin d’opposer et de hiérarchiser. Vain débat, selon moi, puisque tous, d’une manière ou d’une autre, racontent, et puisqu’il y a surtout, au bout du compte, les lecteurs qui seuls choisissent ce qu’ils ont envie de lire, sans trop se soucier de ces étiquettes (pas plus que des étiquettes génériques si chères aux critiques, du reste). Cela dit, il y a des nuances.
Bernard Werber est un rêveur militant raconteur d’histoires. Une évidence si l’on considère La voix de la Terre, qui conclut sa dernière trilogie, Troisième humanité. Rappel : David Wells, gagnant d’un concours de grands projets pour l’humanité, a créé une race de minuscules humaines, les Emachs. D’autres participants au concours avaient également un grand projet : immortalité, créatures artificielles conscientes… thèmes classiques de la science-fiction. Le tout sur fond très sombre de bouleversements climatiques, de renaissance musclée du fanatisme religieux et de bras de fer hégémoniques entre les grandes puissances sur l’échiquier mondial. Car un grand jeu est en cours – sept joueurs humains et néohumains (les Emachs) et un huitième, la Terre, Gaïa, dont on n’a entendu la voix depuis le début de l’histoire. Celle-ci a créé ce qui est devenu la race humaine pour se défendre des astéroïdes destructeurs, mais elle a perdu le contact direct avec ses créatures. Or elle découvre ici que certains astéroïdes sont des fécondateurs conscients, l’Autre auquel elle aspire pour devenir, croître, évoluer elle-même. Sauf que les humains, eux, l’ignorent, et continuent, grâce surtout aux Emachs, à se défendre, pensent-ils, des cailloux géodestructeurs. Mais la situation s’est beaucoup dégradée sur tous les plans entre les joueurs et leurs « utopies » concurrentes, depuis le tome 2 – on en est venu à se méfier des Emachs salvateurs, puis à les craindre, et à vouloir s’en débarrasser. Les Emachs, de leur côté, luttent pour leur survie – espèce contre espèce. Il y a cependant un tiers parti (dont David Wells) qui désire l’entente au moins stratégique contre tout ce qui menace la Terre, avec qui, enfin, on va reprendre ici contact in extremis, pour une finale très ouverte.
On reconnaîtra aisément (trop, pour certains) les thématiques chères à l’auteur, tout comme son style : pas de sous-entendus, pas d’énigmes, tout est exposé directement en surface. La narration n’est pas simpliste, mais il s’agit de raconter le plus simplement possible une histoire complexe et mouvementée qui ne perdra pas le lecteur, dans la tradition du vieux roman-feuilleton populaire – mais pas en épisodes hebdomadaires, ce qui permet quand même quelques modernités narratives à l’auteur : une mosaïque de personnages et de péripéties, avec, en contraste ou en écho, des plongées dans L’Encyclopédie du savoir relatif et absolu, œuvre de l’ancêtre Wells (celui des Fourmis), annotée par ses descendants. C’est seulement de la juxtaposition de certains éléments que naît une certaine voix de l’auteur – parfois sarcastique, parfois accablée. Mais l’histoire l’emporte sur l’écriture qui se veut transparente, absente, outilitaire. On peut le reprocher à Werber (on ne s’en fait pas faute). Il n’en demeure pas moins qu’on peut refermer ce livre satisfait. C’est de la science-fiction qui divertit tout en faisant réfléchir sur des sujets graves, actuels, voire brûlants… et que n’importe qui peut lire et comprendre sans avoir besoin de connaître tout de la science-fiction passée et présente. N’était-ce pas le précepte d’Horace, « instruire en divertissant »? Le rêveur militant a partagé ses rêves et ses cauchemars. Mission accomplie.
Philippe Arseneault est un écrivain raconteur d’histoires. Zora, un conte cruel met en relief son amour du langage et sa maîtrise de la narration. On pense à Rabelais, à Henri Michaux… et à San-Antonio. Invention jaillissante de truculents patois réels et inventés, néologismes réjouissants, foisonnement de vocabulaire inattendu (mais toujours compréhensible) se trimballant du québécois au français d’hier et de presque aujourd’hui, l’auteur se délecte et l’on peut se délecter avec lui du simple plaisir des mots. Mais il y a quand même une histoire, et même une histoire très bien articulée, et même une histoire de fantasy! Dans une sombre forêt fréquentée par des petites créatures monstrueuses peut-être imaginaires, les fredouilles, un aubergiste horriblement sale, bête et méchant – comme tous les habitants du cru – a par erreur une fille. La petite Zora grandit comme une sauvage. Elle est rescapée par un vieil alchimiste qui la perd néanmoins parce qu’elle est poursuivie par le sinistre barde noir, Glad l’Argus. Il finit par la récupérer et par l’épouser pour la protéger. Six ans plus tard, Zora et son vieil époux paternel (qui poursuit la recherche de l’immortalité) font la connaissance d’un jeune homme collecteur d’histoires, devenu mortellement insomniaque à cause d’un mauvais sort de l’affreux Glad. Ensemble, ils réduisent celui-ci à l’impuissance. Mais l’intrigue ne s’arrête pas là : Zora sera perdue de nouveau, puis retrouvée, et connaîtra un destin inattendu, devenant une légende. Eh oui, on pense aussi à Schéhérazade et aux Mille et une nuits, car transparaît ici cette allégresse narrative des enchaînements et emboîtements d’histoires improbables et sans fin – même s’il y a une sorte de fin. Certainement pas pour Arseneault, un écrivain dont j’ignore (et doute) s’il poursuivra dans cette veine ou si ce roman sera son unique essai dans les genres. Essai réussi, en tout cas.
Les lecteurs de Werber ne seront sans doute pas tous des lecteurs d’Arseneault et vice versa. Mais pour ceux qui aiment les grands écarts…