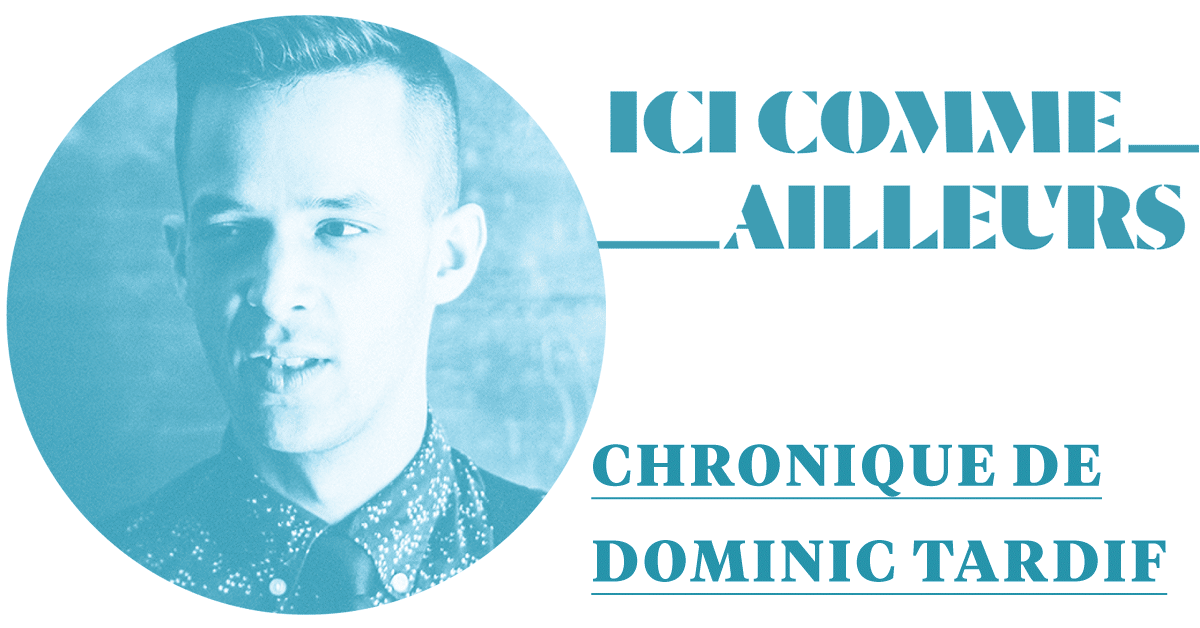Comment survivre à ses parents?, s’interrogent Valérie Roch-Lefebvre et Marie-Pier Lafontaine dans deux puissants premiers romans.
« Est-ce que je te fais penser à mon père? », que je demande à ma blonde à l’instant même où je vois apparaître la question dans sa pupille — une question qu’elle n’ose prononcer parce qu’elle m’aime trop. Ai-je commis quelque chose de grave? Pas pantoute. Fidèle à mes habitudes, me voilà qui angoisse au sujet du menu d’un restaurant où nous devons retrouver des amis, ou d’une autre de ces vétilles à partir desquelles j’ai développé un talent exceptionnel pour gâcher une soirée.
J’ai 33 ans et vieillir ressemble de plus en plus, depuis quelques années, à craindre que tout ce qui m’a toujours agacé, irrité, contrarié chez mes parents — tout ce dont j’aurais horreur d’hériter — ait dormi en moi pendant toutes ces années.
C’était un soir de février glacial, d’un genre auquel seuls les Abitibiens savent survivre. Dans la classe où mon père avait débuté sa carrière d’enseignant il y a à peine quelques mois et où elle se terminait déjà, ma mère et le gamin que je suis alors l’aidons à ranger dans des boîtes ses effets personnels. Et je comprends, de retour à la maison, en épiant depuis ma chambre la conversation des grands, que mon père n’en pouvait plus de l’ingratitude de ses étudiants adultes, et des patrons l’implorant d’être plus clément avec ces tout-croches qui, certes, ne s’aidaient pas beaucoup, mais pour qui, vraisemblablement, l’école n’avait jamais été une matière facile.
Souvenir presque banal auquel je repense toutes les fois que le travail me procure la moindre contrariété. Un seul courriel de reproche d’un employeur — rien de grave — et rapplique instantanément cette envie de tout balancer et de m’enfoncer dans la nuit, de juguler cette honte de ne pas avoir été à la hauteur, à laquelle se mêle toujours les accents d’une risible colère d’avoir été incompris, de ne pas être estimé à ma juste valeur. Puis l’angoisse : serais-je condamné à reproduire les mêmes erreurs que mon paternel?
Oublier le passé ou s’y engloutir?
« J’ignorais que je portais la même solitude [que mon père] », écrit Valérie Roch-Lefebvre dans l’introduction de son premier roman, Bannie du royaume, précisément traversé par cette question qui n’épargne personne, celle de la transmission. Autrement dit : est-il possible d’échapper aux failles et défauts, gros ou petits, de ceux qui peuplent notre arbre généalogique?
Ça commence, comme beaucoup de bons livres, au salon funéraire, lieu de tous les bilans, de toutes les tentatives de réconciliation et de toutes les fausses bonnes intentions. « La fratrie est divisée en deux camps : l’un qui a oublié le passé et l’autre qui s’y est englouti », observe la narratrice au sujet de la famille de son père, deux postures confinant au pire, c’est-à-dire, dans le premier cas, à ce que ce passé vous revienne au visage le jour où vous vous y attendez le moins, ou dans le second, à ce que votre cœur finisse par se calcifier. C’est pourtant tout ce qu’a légué à ses six enfants celle que l’on pleure ce jour-là, une mère imprévisible et distante qui aura préféré à la possibilité de vivre celle de lire « des biographies de gens célèbres jusqu’à sa mort, enivrée par les potentiels de l’existence ».
Et si j’évoquais mon propre rapport à mes parents, c’est moins — vous l’aurez compris, je l’espère — pour dresser un parallèle entre l’incapacité relativement commune de mon père à supporter l’autorité et les problèmes de santé mentale qui affligent la grand-mère et le père de la narratrice de Bannie du royaume que de souligner à quel point ce roman n’est pas seulement une histoire de santé mentale transmise de mère en fils en fille.
Il n’y a pas plus puissante métaphore du poids de ce que nous cèdent sans le vouloir nos parents que cette maladie que ne nomme jamais Valérie Roch-Lefebvre, bien que l’on devine dans ses descriptions qu’il est question d’une forme de schizophrénie ou de bipolarité.
Une certaine fatalité embaume donc ce récit croisé des vies ayant oscillé entre euphorie et réclusion de cette grand-mère en allée et de son fils, qui n’aura su entrer en dialogue avec elle qu’en imitant ses (mauvais) choix, lui qui « avait fait des enfants dans cette banlieue uniforme pour comprendre ce que [sa mère avait] ressenti ». Mais la fatalité ne triomphe pas complètement, sans doute parce que l’on devine, entre les lignes, que l’écriture, ou du moins la capacité de mettre des mots sur ce qui sommeille en elle, procurera à la jeune femme qui témoigne la force lucide de faire ce qu’il faut afin que les voix qui enchaînaient son père ne l’enchaînent pas elle aussi.
Enfin se raconter
Chienne, premier roman de Marie-Pier Lafontaine, semble lui aussi animé par cette conviction qu’il reste toujours, quand tout en nous a été détruit, quand notre dernière parcelle de confiance en la vie s’est éteinte, l’ultime pouvoir de raconter comme on l’entend son récit de soi. En une série de courts chapitres, une survivante décrit, avec une précision ayant pour effet de chasser tout oxygène autour de vous, la violence méthodiquement perverse (et perversement méthodique) de son père.
« J’ai inventé un souvenir d’enfance, écrit-elle dans cette autofiction. De toutes pièces. À croire que j’avais besoin que personne ne sache tout à fait la nature exacte de ma souffrance. Qu’il y ait cette pièce amovible dans le casse-tête. Il y a une justesse biographique plus grande dans ce morceau de mensonge, de fiction, que dans les reconstitutions. Et si un jour j’étais lue. Si j’étais lue, je porterais ce faux souvenir avec encore plus de convictions que les autres. Je dirais même que c’est le seul qui soit véridique, qui nous soit bel et bien arrivé. »
Il y a dans la littérature, nous rappellent à la fois Valérie Roch-Lefebvre et Marie-Pier Lafontaine, quelque chose comme une promesse : celle d’un espace permettant de faire ses propres choix. Ce qui ne veut pas dire, comme le prétend hypocritement une certaine fiction, que tout finit toujours par bien aller et que toutes les blessures guérissent, mais bien que de (se) raconter, c’est un peu déjà choisir ce que l’on souhaite conserver du passé.