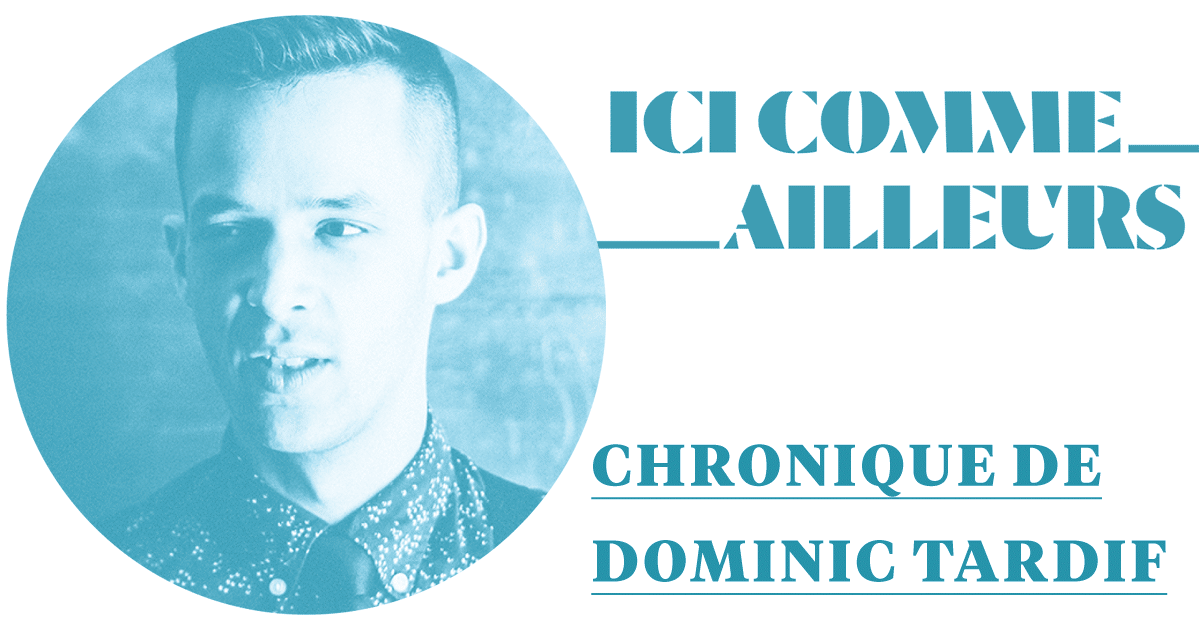Je me souviens d’avoir longtemps pensé que la lecture de romans représentait une pure perte de temps. Pourquoi lirais-je une histoire inventée quand je peux consacrer ce même temps à lire des livres d’histoire et des essais — la bibliothécaire de mon école secondaire avait gentiment accepté de commander quelques titres du catalogue de Lux. Je sais aujourd’hui que cette conception de ce qui constitue une bonne et une mauvaise lecture est profondément nounoune, mais c’est quand même ce que je pensais à l’époque.
Puis mon indignation, au cégep, s’est rapidement dissoute au contact de l’ennui que généraient en moi ces cours d’anthropologie durant lesquels il fallait identifier des crânes. Plutôt que de faire un effort, j’ai pris la direction du pavillon 4, celui des arts et des lettres, un sanctuaire pour quiconque cherche quelque chose sans savoir ce qu’il cherche exactement.
Quelques semaines plus tard, mon professeur Patrick Nicol plaçait entre mes mains — entre celles de tous ses étudiants — quelques romans que je refuse de relire tant je crains de ternir le souvenir précieux que j’en garde. Je me rappelle très bien le premier dimanche que j’ai consacré tout entier à la lecture — c’était un Dany Laferrière, celui avec le mot en n dans le titre, lu at one sitting, en une seule longue séance. Les gens qui comparent la lecture à une drogue me donnent souvent l’impression de n’avoir jamais même fumé un joint de leur vie, mais ce dimanche-là, c’était quand même un peu ça : quelque chose comme une transe.
Je commençais pour vrai ma vie de lecteur, j’avais 17 ans et beaucoup de temps à rattraper. Un petit sentiment de honte ne m’a jamais quitté en regard de mes lacunes en la matière et chaque fois qu’un écrivain me confie en entrevue l’émotion qui l’habitait quand il lisait Balzac à 11 ans, j’opine en faisant semblant qu’il n’y a rien de spécial là-dedans.
Je me suis inscrit en littérature à l’université parce que Patrick Nicol m’a dit que c’était une bonne idée et il n’avait pas tort. Après quelques années à écrire des textes dans un hebdo de Sherbrooke sur des groupes de musique obscurs, l’amie Alice m’a envoyé un courriel pour me demander si je souhaitais mener des entretiens avec des auteurs pour une revue qui s’appelait alors Le libraire, comme le roman de Gérard Bessette. C’était en octobre 2010.
J’ai écrit dans un de mes premiers papiers que l’écrivain Charles Dantzig ne se prenait pas pour un 7up, et Charles Dantzig m’a fait parvenir quelques semaines après la parution de l’article une lettre de remerciement, ce qui me laisse croire que l’expression « ne pas se prendre pour un 7up » n’est pas courante à Paris, ou que l’élégance de l’homme est inentamable, ou qu’il envoie systématiquement des lettres de remerciement à ceux qui parlent de ses livres. Merci, Charles.
En me voyant confier cette chronique en 2016, j’ai d’emblée pris le pari de parler de moi et de mon quotidien, parce que je ne suis jamais parvenu à concevoir autrement ma relation aux livres. Il m’arrive de ne plus savoir si ma vraie vie se situe dans l’appartement que j’habite avec ma fille et ma blonde, ou plutôt dans les livres que je lis, dans la musique que j’écoute. J’aime du moins penser que tout ce temps que je passe, immergé dans l’imaginaire des autres, fait de moi non pas un meilleur humain, ce serait trop facile, mais du moins quelqu’un de plus engagé. Après avoir lu, je reviens à la vraie vie avec de nouvelles soifs à étancher et une idée plus claire de ce à quoi je devrais consacrer mes heures.
Je choisis depuis maintenant plusieurs années de consacrer plusieurs de ces heures à écrire au sujet de mes lectures, non pas par altruisme, mais parce que le labeur heureux qui consiste à trouver les mots qui décrivent adéquatement mes enthousiasmes me permet de vivre une deuxième fois la joie de cette lecture. Il y a aussi que c’est la plupart du temps en écrivant que je découvre ce que je pense de quelque chose, et non l’inverse.
Parce que j’aime Maxime Catellier comme un grand frère (même si je ne le connais pas intimement), il allait de soi que je consacre ma dernière fois à son plus récent livre. Dans Le monde d’avant : L’autre moitié, l’écrivain se promène dans les souvenirs de son ancien quartier, le Centre-Sud de Montréal, avec au cœur une nostalgie à la fois douce et dangereuse. Une nostalgie qui tient moins à un désir de fixer le passé, qu’à la conscience aiguë que cette pile de souvenirs qui s’accumulent en nous, si elle est une richesse, nous permet aussi de prendre la mesure du nombre limité de bonheurs qu’il nous reste à goûter.
Catellier a le malheur et la félicité de n’avoir oublié aucun des visages de ces vieilles dames qui attendent l’autobus, aucun de ces plats avalés dans des petits restos tout croches, aucun de ces enfants qui crient en allant s’acheter des jujubes au dépanneur, aucune de ses promenades dans le ventre de la nuit. Et je me rappelle grâce à lui qu’on ne quitte jamais vraiment rien, que tout s’imprime en nous, que nous trimballons pour toujours tout ce que nous avons été.
« […] goodbye, c’est une manie de faire le chemin en sens inverse une fois qu’on a compris la malédiction, et il nous ramène au point de rupture où le passé bascule dans le présent et tout devient noir, goodbye, je ne vois plus rien, j’ai essayé de guérir mais je ne suis pas malade, je refuse d’être malade pour les autres, je veux d’abord revoir mes premiers mots, qui a rangé le film de ma vie dans le coffre fermé à clé de ma tête, goodbye, je ne sais plus qui je suis, j’ai souvenir encore mais je ne sais plus de qui, de plus en plus d’espaces s’effritent et je tiens l’abîme en joue, je connais son visage, ses moindres traits creusés dans la noirceur de cet instant, goodbye, il y aura peut-être une fois, lointaine et fulgurante, où je me réconcilierai avec la vie, mais pas de ce côté, pas dans ce monde, mais dans celui d’après. »
Merci. Salut. À la prochaine.
Parce qu’il travaille désormais au quotidien La Presse, Dominic Tardif signe ici sa dernière chronique dans Les libraires. Vous pouvez aussi le retrouver au micro de son balado Deviens-tu c’que t’as voulu?