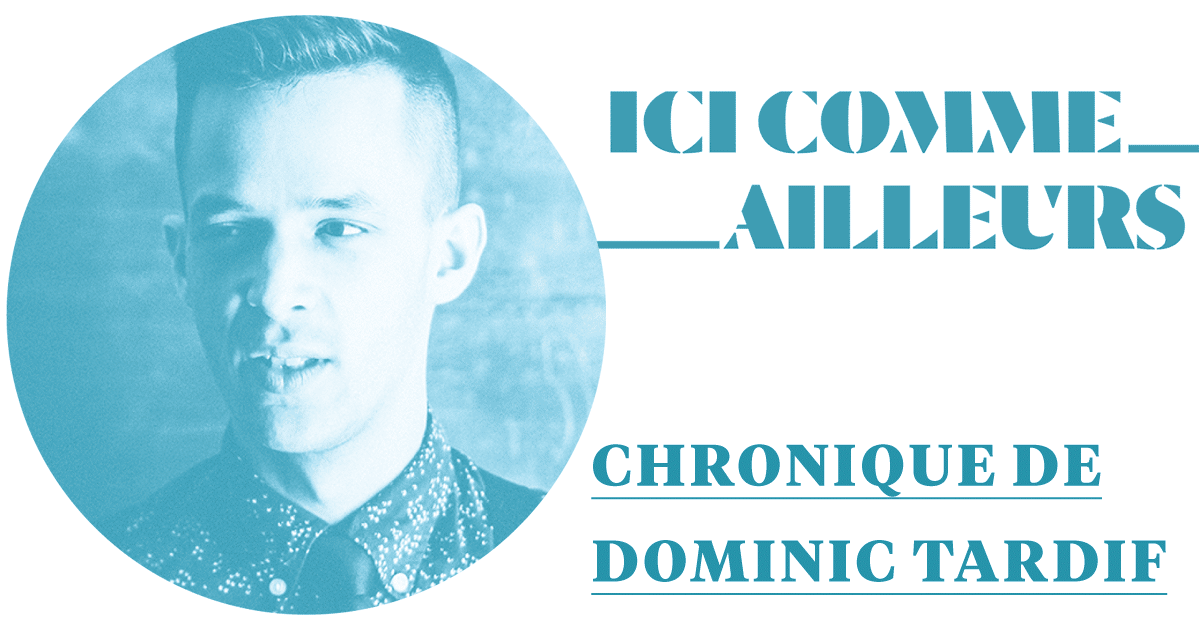Une femme que je connais un peu — pas beaucoup, mais j’ai néanmoins une grande affection pour elle — annonce sur les réseaux sociaux qu’elle est atteinte d’un cancer et, ce matin-là, malgré le flegme dans lequel je tente de me draper face à de pareilles nouvelles, ça me rentre dedans, presque comme si j’apprenais que mon propre cancer, celui que j’ai eu quand j’avais 14 ans, était de retour.
J’envoie un petit message à la femme en question afin de lui témoigner mon soutien, lui apprendre que j’ai en quelque sorte vécu la même chose qu’elle, il y a longtemps, bien qu’en sachant, évidemment, qu’aucun cancer n’est pareil. N’hésite surtout pas si je peux t’aider. Elle me répond quelques minutes plus tard qu’elle aimerait bien que je lui dise ce que j’aurais, moi, aimé savoir avant de m’engager dans une chimiothérapie. Et je fige. Pendant une heure, j’écris et efface des dizaines de phrases, trop crues ou trop euphémisantes, trop honnêtes ou pas assez.
Devrais-je vraiment lui confier que la chimio est une des choses les plus violentes que j’ai vécues, que j’ai eu l’impression pendant ces semaines d’avoir dû m’abriter dans un recoin de mon esprit, sorte de camp de fortune où je m’étais réfugié de mon corps — que c’est étrangement encore à ce jour ce à quoi je pense lorsque j’entends Gerry Boulet hurler les mots « immigré de l’intérieur » dans Ayoye?
J’aurais aimé savoir trouver des formules à la fois justes et consolatrices, tenir entre mes mains deux vérités qui semblent se contredire, mais qui sont pourtant indissociables. J’aurais aimé savoir lui dire qu’on ne se remet jamais vraiment d’un cancer et lui dire aussi qu’un jour, bientôt, si tout va bien, elle se réveillera un matin et s’étonnera de constater que le mot cancer n’est plus le premier à se saisir de sa pensée. J’aurais aimé savoir lui parler avec la même vertigineuse honnêteté que celle qu’embrasse Camille Paré-Poirier dans Dis merci, son premier livre, un récit versifié de la tumeur qui lui a poussé dans la moelle épinière quand elle n’avait que 12 ans.
Dans une langue sans détour, Camille Paré-Poirier raconte tout : la douleur stridente à travers laquelle la tumeur a annoncé son arrivée, la difficulté à recevoir un diagnostic, les visages courageux que se composaient tant bien que mal ses parents, les complications postopératoires et le retour à l’école, où elle sera pour le reste de son secondaire « cette fille-là », celle dont la colonne vertébrale se déploie tout croche et qui, pour que sa trajectoire se rétablisse, devra porter un corset plus qu’envahissant.
Dis merci est un livre souvent bouleversant, mais qui se tient à distance de toutes métaphores volontairement larmoyantes. Salutaire prudence : faire de la poésie à partir d’une maladie est un exercice périlleux, presque une mission impossible, tant toutes les figures de style semblent inadéquates pour traduire une expérience aussi singulière.
Sous ce titre, Dis merci, qui pourrait sembler se moquer des injonctions à la gratitude que l’on sert à ceux et celles qui survivent à de grandes épreuves, Camille Paré-Poirier esquisse néanmoins une sorte d’ode à la vie, d’une aveuglante lucidité, à laquelle il est aisé d’adhérer parce que son autrice ne gomme rien de la vérité. « La douleur / ça n’intéresse personne », écrit-elle, deux petits vers presque banals, mais qui encapsulent toute la richesse d’apprentissages, et de colère, que dépose en soi la souffrance physique. (J’en ai jamais autant appris au sujet de mon corps que lorsque je me suis trouvé dans des états extrêmes de douleur. Je n’ai jamais autant pensé que la vie était absurde que lorsque je me suis trouvé dans ces états extrêmes de douleur.)
Dis merci se conclut magnifiquement par un hommage à la mère, tour à tour « infirmière / chirurgienne / fée des dents / esthéticienne / psychologue / ventriloque / pusher / punching bag / sœur ». « Maman / c’est pas parfait / c’est rarement parfait / mais des fois / juste survivre / c’est beaucoup », lui dit sa fille. J’ouvre un courriel et j’écris précisément ceci à cette femme à qui je ne savais quoi répondre : « Sois indulgente envers toi-même. Juste survivre, c’est déjà beaucoup. »
Un livre sur la mort
Après avoir exploré l’envers du décor du monde de la thanatologie dans L’embaumeur, roman en forme d’enquête intime sur le métier de son père, Anne-Renée Caillé mène dans Voyances un reportage à la fois littéraire et très personnel sur l’univers intrigant des voyants. Elle multiplie, sans forcément y croire complètement, les visites chez des cartomanciens, des diseurs de bonne aventure, des médiums et des astrologues.
Loin d’une perspective qui tiendrait de la curiosité morbide, l’écrivaine emploie plutôt les récits et réponses que lui offrent ces devins afin de réfléchir à ce qui la garde du côté des vivants, ainsi qu’à ce en quoi elle croit, en se laissant traverser par cette langue étrange que parlent ses interlocuteurs, un jargon éthéré composé de psychopop, de philosophie, d’ésotérisme, de mensonges et d’empathie réelle.
Mais à l’évidence, et pour le meilleur, Voyances est, comme L’embaumeur, un (ensorcelant, onirique) livre sur la mort, ou plus précisément sur comment la conscience de notre finalité peut infléchir le quotidien. Pourquoi est-il si difficile d’être heureux lorsque l’on sait que le temps qui nous est imparti est limité?
Dans ce qui constitue le point d’orgue du roman, Anne-Renée Caillé dresse l’inventaire de toutes les petites culpabilités qui l’assaillent, nomme sa crainte de ne pas être « faite pour le sacrifice, le don », après être devenue mère. « J’aimerais que ces moments, cette colère, cette insatisfaction soient brûlés sur une plage par des milliers d’autres et effacés par les vagues », écrit-elle un jour à un astrologue américain, qui invitait ses abonnés à lui confier leurs secrets, qu’il carboniserait dans un rituel de purgation.
« Car quand la vie est aussi belle et douce dans les faits et que les faits ont des couleurs et des formes qui existent dans le temps, la plénitude est là, elle est tellement là que c’en est obscène, ce bonheur qui ne part jamais en réalité, à consommer à tout moment, et qu’on laisse cette vie être salie ainsi un jour d’orage, amoindrie sans vergogne, c’est une honte. »
Camille Paré-Poirier lui dirait sans doute que de juste survivre — à la journée, à la semaine, à la nuit — c’est déjà beaucoup, même si rien ne sera jamais parfait. Rien ne peut être parfait quand on sait que tout prend un jour fin.