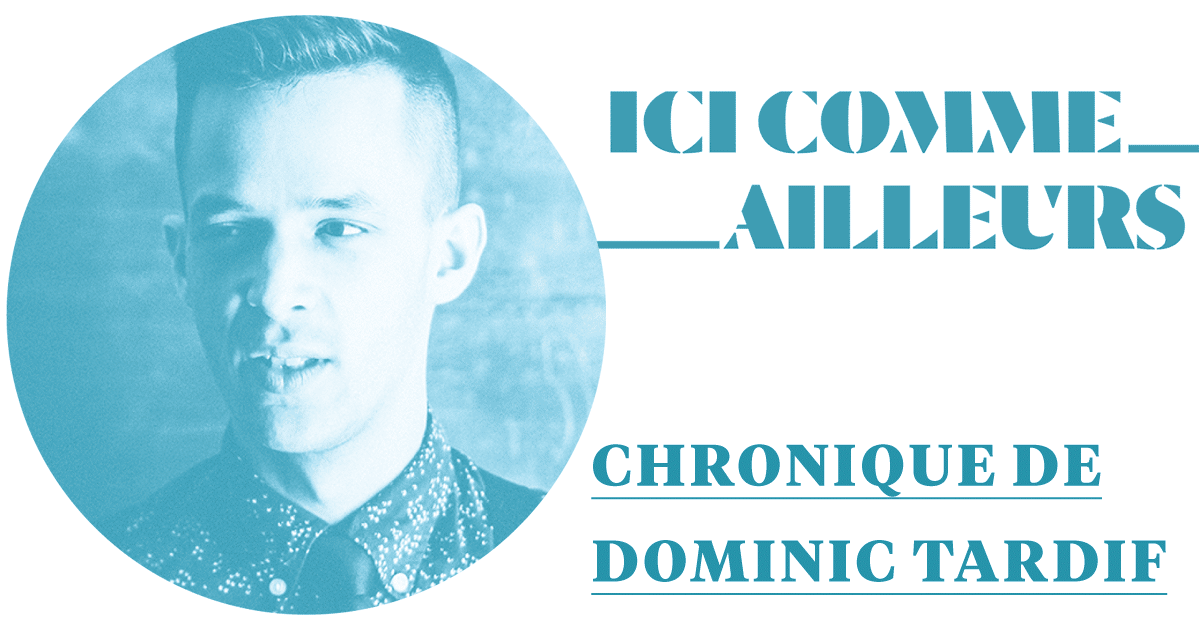Jusqu’à tout récemment, je ne m’étais jamais tellement projeté dans le temps, jamais pris à m’imaginer un jour avoir, 40, 50, 60 ans. Comprenez-moi bien : je n’ai jamais été de ces romantiques qui espèrent mourir jeunes, au terme d’une courte vie vécue trop furieusement. J’étais tout simplement incapable d’envisager un jour d’atteindre l’âge qu’ont présentement mes parents. C’était comme si cette éventualité demeurait trop abstraite pour que mon esprit puisse réellement l’admettre.
Comment la paternité t’a-t-elle changé? me demandent parfois mes amis et amies, depuis la naissance de ma fille. Je pourrais vous répondre sommeil, je pourrais vous répondre vulnérabilité — je pleurais à rien, c’est pire maintenant — mais aujourd’hui, je vous répondrai : temps. C’est mon rapport au temps qu’a profondément bouleversé la paternité. Au quotidien, d’abord, parce que les journées, depuis l’arrivée de l’enfant, parviennent étrangement à apparaître à la fois interminables et trop courtes.
Mais c’est surtout à l’échelle de mon âge, à l’échelle de ma vie entière, que mon rapport au temps n’est plus du tout le même. Banal calcul mathématique dans ma tête : ma fille aura un jour 10 ans, 20 ans, 30 ans, et j’espère avoir la chance de me tenir à ses côtés tout au long de ce voyage qui sera le sien. J’aurai alors 40, 50, 60 ans. Me voilà pris — il me faut bien me l’admettre — avec le dur désir de durer, une formule d’Éluard que j’ai d’abord entendue dans une chanson du groupe Octobre. Me voilà aussi pris avec le corollaire de ce désir : la crainte de m’encroûter, de mal vieillir. Durer, oui, mais comment? Vertige.
Vertige que j’apaise ces jours-ci en me plongeant dans l’œuvre de femmes qui ont su traverser les années sans rien abdiquer. Des femmes comme France Théoret, 78 ans, qui a publié plus d’une trentaine de livres — poésie, romans, théâtre, essais — et qui, dans La forêt des signes, se rappelle comment la lecture et l’écriture se sont impérativement imposées à elle.
Née au sein d’un milieu modeste, France Théoret, jeune femme, travaille comme une damnée dans l’hôtel de campagne de son père, une existence de sujétion, où lire est une activité suspecte et risible. « Il est inutile d’écrire si je ne désire pas la liberté. Ma nécessité s’appelle la liberté », explique-t-elle dans cet essai autobiographique en se souvenant comment cette entreprise de conquête de sa liberté n’aura pu s’accomplir que grâce à l’invention d’une langue contestant toutes les servitudes, tous les dogmes et tous les appels à faire de la littérature une chose utile, au sens où l’entend le marché.
C’est donc l’histoire d’une révolte que raconte France Théoret : d’une révolte contre ses origines, mais aussi contre les limites du langage, ainsi que contre toutes les violences dont sont victimes les femmes. On aimerait qu’elle adhère à ce qu’elle appelle « la vie douce », mais l’écrivaine résiste, comprend trop bien qu’on l’invite ainsi subtilement à cesser de ruer dans les brancards. J’entends personnellement, dans ce refus de se taire, une mise en garde : toujours se méfier de ce qui endort, toujours se méfier des réponses trop faciles.
Femme alerte, dans tous les sens du terme, France Théoret voit clair dans le jeu de ceux qui tentent de juguler sa colère, de la convaincre qu’elle exagère. Féministe parce qu’il le faut, elle demeure indignée face à l’absence de reconnaissance, voire au mépris, subi par ses sœurs, dont la regrettée Louky Bersianik. Son roman L’Euguélionne (1976) est rien de moins qu’un chef-d’œuvre, plaide-t-elle, alors pourquoi n’est-il pas plus largement considéré ainsi?
France Théorêt témoigne dans La forêt des signes de son engagement envers la littérature qui, chez elle, est indissociable de son engagement envers la vie. « Quand je renonce à l’écriture et à la recherche constante, le désastre survient. Il faut se tenir sur le qui-vive pour n’être pas dévorée par l’ordinaire ou le quotidien. Il y a une nécessaire lutte incessante pour se maintenir dans la réflexion et le geste d’écrire. Je suis l’objet, saisie par la dévoration, si je n’accepte pas la lutte continuelle devant l’existence. Le quotidien me rend amorphe, m’engloutit dans une matière inorganisée, un chaos visqueux. La léthargie entraîne à la déliquescence. J’ai l’obligation de rassembler la totalité de ma personne si je désire écrire. »
La mort n’a pas raison de tout
Dans Tout près, recueil d’abord paru en 1998, Louise Dupré donne voix à une femme ayant elle aussi subi la mise au silence d’une époque de grande noirceur. L’écrivaine — autrice de plus d’une vingtaine de recueils de poésie, de romans et d’essais — auscultait déjà à l’intérieur de ses poèmes en prose et en vers une des grandes questions de son œuvre qui, de titre en titre, soupèse le rôle même de l’espoir au cœur d’un monde sur lequel règne l’horreur (une réflexion qu’elle poursuivra dans Plus haut que les flammes en 2010 et La main hantée en 2015).
Livre habité par les fantômes nombreux d’êtres aimés, Tout près se range néanmoins — c’est en ce choix que se loge sa force — du côté de la vie. C’est parce que celle qui prend la parole possède une connaissance intime de ce que cela signifie de perdre quelqu’un qu’elle peut affirmer que l’obscurité, même vorace, n’avale pas tout, qu’un deuil n’entraîne pas dans son sillage la joie au grand complet. Il y a la vie partout dans ces textes comme il y a la vie partout dans un cimetière, par un après-midi de temps clair.
« Demain ce sera le jour dans son éternité, avec son poudroiement de brume avant le premier soleil et ses collines semblables à des images. Puis mes doutes éblouis de lumière. Plus rien ne tremblera. Je retrouverai ma voix nomade, cette petite goutte de voix qui émerge, certains matins bénis où la douceur de l’air nous laisse entrevoir que la mort n’a pas raison de tout. »
Il y a partout dans ce livre une sorte de foi païenne en la possibilité vivace de toujours renouveler ses vœux envers la vie, ainsi qu’envers sa propre capacité de s’émerveiller, de désirer, de croire en demain. Je lis Tout près et soudainement, malgré toute la douleur que ses phrases contiennent, je me permets de faire mien le mot espoir. Il est sans doute la meilleure arme pour qui souhaite rester debout, encore longtemps.