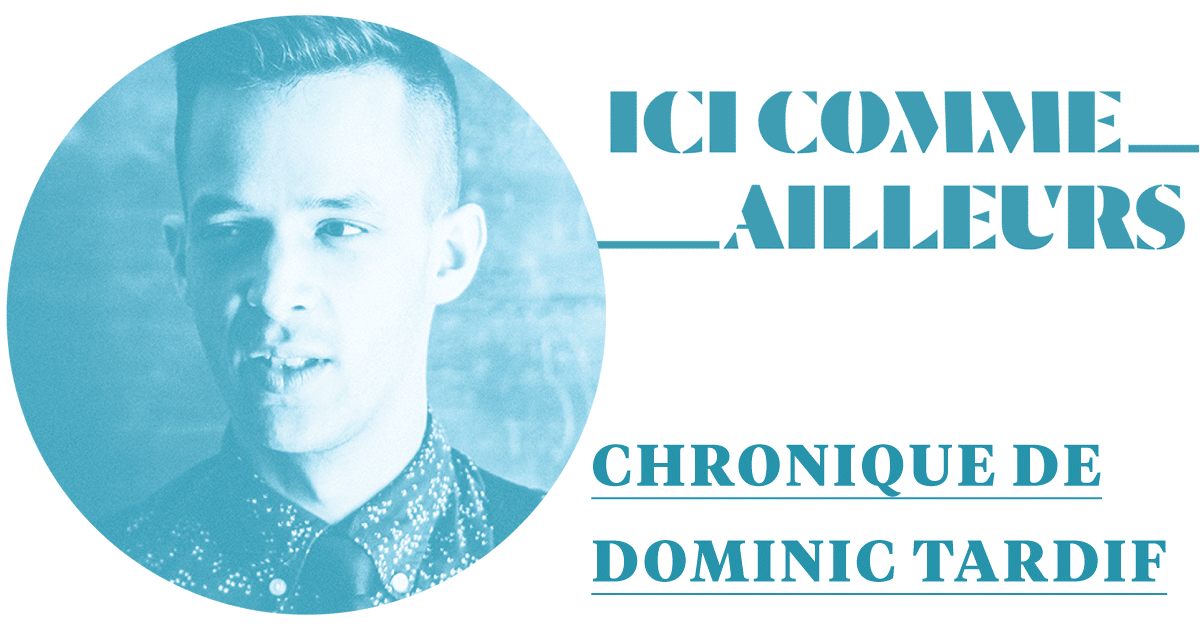Le marquant recueil de Fernand Durepos est enfin réédité grâce aux Éditions de l’Écrou.
En 2004, j’ai 18 ans et je ne suis sans doute pas en mesure de discourir très longuement si vous me demandez de vous parler de poésie, ou de littérature en général. Mais j’ai lu dans mes cours au cégep quelques livres grâce auxquels j’entrevois — enfin — que la littérature n’appartient pas qu’à ma mère — je t’aime maman! — et qu’il peut y avoir dans un livre autant d’électricité que dans une chanson que je veux réécouter chaque jour.
Comme beaucoup de gars de 18 ans qui se sont inscrits en arts et lettres au cégep malgré une absence quasi totale de connaissances littéraires, je porte fréquemment un t-shirt des Doors et adhère fougueusement, sans aucune espèce de distance critique, au mythe du poète maudit qu’incarne Jim Morrison jusqu’au bout de ses pantalons de cuir serrés.
La musicographie de Lucien Francœur m’apprend à la même époque qu’ici aussi, au Québec, des rebelles se sont démenés pour montrer qu’il est possible d’être poète sans porter la veste brune en corduroy, une bonne nouvelle qui tient de l’évidence pour quiconque connaît minimalement son histoire littéraire (peuplée de beaux indociles), mais qui ne m’était pas encore venue aux oreilles. J’écoute et je lis Francœur, ainsi que tous les livres écrits par ses potes de la contre-culture des années 70 sur lesquels je parviens à mettre la main.
Puisqu’on y est : même s’il est de bon ton dans certains cercles de se moquer de Francœur, et de cette caricature de lui-même qu’il incarne parfois en public, il faudra au moins un jour reconnaître qu’il aura été le catalyseur de bien des épiphanies chez des gars et des filles qui, comme moi, redoutaient cette chose à la réputation poussiéreuse qu’est la littérature.
C’est ainsi probablement grâce à Francœur — je ne vois pas autre chose — que j’apprends l’existence de l’œuvre de Fernand Durepos (Lucien a dû parler de son « chum Fernand » pendant une entrevue à la radio, ou sur son site Web). J’ai 18 ans, nous sommes en 2004, et Fernand Durepos vient tout juste de faire paraître Mourir m’arrive, de loin le plus poignant, le plus tendre, le plus grisant, le plus intraitable de ses recueils.
Mais qu’est-ce que je pouvais bien reconnaître, à 18 ans, entre les pages de ce livre exaltant une vision témérairement jusqu’au-boutiste — forcément magnifique — de l’amour? Qu’est-ce que je pouvais bien entendre dans ces poèmes ayant survécu à bien des nuits blanches et à bien des aurores brutales, moi qui ne savais rien pantoute des régals et des douleurs de la passion qui emporte tout?
Je me le demandais bien cette semaine en relisant Mourir m’arrive, un livre qui, visiblement, en avait bouleversé d’autres que moi : les Éditions de l’Écrou en offrent enfin une nouvelle édition, la première étant depuis trop longtemps impossible à trouver en librairie.
Le bréviaire de mes détresses
Avec une connaissance intime des paroxysmes et des abysses, des douceurs et des tortures, des merveilles et des commotions que permettent et que provoquent la rencontre de l’autre, Fernand Durepos parle dans Mourir m’arrive de l’amour comme d’une ultime façon de résister à toutes les violences que subissent ceux qui refusent de se conformer, mais aussi comme d’une brûlure qui ne cicatrisera jamais : « admettre/ne pouvoir la vivre/que totale//jusqu’à n’avoir en bouche/que souvenance de soufre//ses lèvres pour seule mémoire/de tout ce que fondre/aura voulu dire ».
Mais ce qui me frappe le plus en relisant ce livre culte, c’est ce déchirement qui court tout du long, en filigrane, comme si l’homme qui écrit les poèmes tentait de se convaincre, sans y parvenir, que même les plus fulgurantes ivresses ne justifient pas toute la douleur qui lui tombe dessus maintenant qu’il doit apprendre à s’en passer. Mais à quoi bon vivre, si c’est pour renoncer à l’irremplaçable intensité de ce qui ne peut exister qu’entre elle et lui? Le poète est bien conscient « qu’ivre de lui-même le mot amour peut aussi tuer en série » — c’est le titre d’un poème —, mais continue de prendre le beau risque de la douleur, inhérent à la vulnérabilité. Mourir m’arrive couve l’espoir d’une étreinte qui, enfin, abolirait toute souffrance.
Les titres à pentures des poèmes de ce recueil sont d’ailleurs déjà des programmes en soi, et savent encapsuler en quelques mots ces galaxies d’autres poèmes qu’il faudra continuer d’écrire au sujet de l’amour : La nuit où elle fut à elle seule l’intérieur de tous les orages, Désapprendre le froid du monde en s’embrassant agenouillés pyjamas ouverts contre la porte battante du réfrigérateur, Le don de magasiner dans l’univers et d’y empiler de pleins paniers d’astéroïdes n’est pas à la portée de n’importe qui.
Je prenais à la fin du mois d’août dernier une bière (OK, deux bières) avec les cofondateurs des Éditions de l’Écrou, Carl Bessette et Jean-Sébastien Larouche. Motif de notre rencontre : les 10 ans de leur maison, anniversaire à propos duquel j’écrivais un article. Jean-Sébastien en profite pour m’annoncer que cette réédition de Mourir m’arrive de Fernand Durepos verra le jour quelques mois plus tard.
Et je comprends alors, en voyant l’étincelle dans l’œil de mes interlocuteurs, que je ne suis pas le seul à avoir un jour fait de ce livre le bréviaire de mes nuits de détresse. À ce moment-là, quelque chose en moi comme un soulagement. Jean-Sébastien et Carl venaient de poser une autre pierre à l’édifice de ma foi en ce que tous les livres tristement méconnus finissent un jour par rencontrer leurs saints patrons, leurs sauveurs. C’est naïf, je le sais, mais permettez-moi d’y croire.
Levons donc notre verre aux Éditions de l’Écrou qui, à leur engagement envers la jeune poésie québé-coise, conjugueront désormais cet essentiel travail de remise en valeur d’un passé pas si lointain, en arrachant aux marges d’autres de ces classiques en puissance de la littérature québécoise. Il n’y a pas plus triste sort, pour un grand livre, que celui de l’oubli. Je n’aurais pu imaginer plus émouvant cadeau de Noël que cette résurrection de Mourir m’arrive.