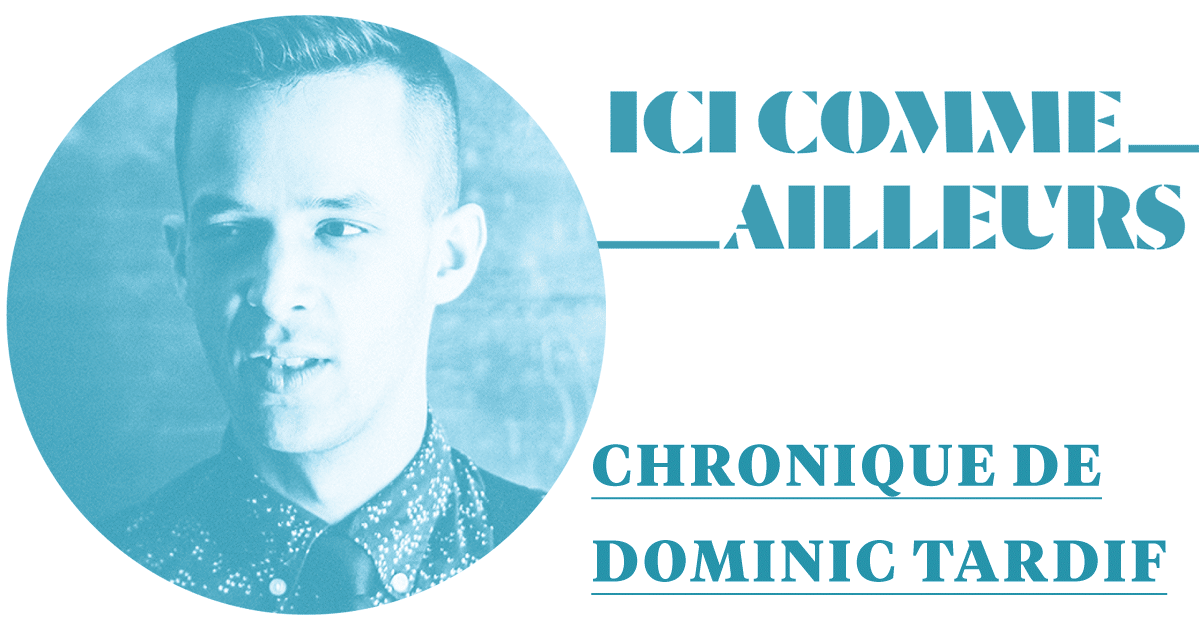Notre chroniqueur écrit une lettre à un vieil ami afin de lui parler du premier roman d’Antonin Marquis, Les cigales, réflexion lancinante sur le sale sort que le temps réserve aux idéaux et aux idéalistes.
Salut l’ami,
Comment ça va?
Moi, très bien. Ça aurait été cool de te voir à mon party d’anniversaire de 31 ans, mais je sais que t’es ben occupé. On a été obligés d’avoir du fun sans toi. J’espère que tu trouves un peu de temps pour ta blonde et pour le p’tit.
Tu m’as écrit l’autre fois pour me demander de te recommander un livre pour ton voyage à Tokyo cet automne. Ouain, bon, je ne sais pas si c’est exactement un bon livre de voyage – en fait, je suis sûr que c’est l’exact contraire de ce qu’on entend par un bon livre de voyage. Mais si le livre te fait le même effet qu’il a eu sur moi, tu ne pourras pas chasser les personnages de ta tête avant longtemps. Je m’excuse à l’avance. N’oublie pas de m’envoyer une carte postale.
Faque ça s’appelle Les cigales. C’est l’histoire de deux amis de longue date – un peu comme toi et moi – qui partent faire du camping aux États-Unis, pendant la grève étudiante du printemps 2012. Il y en a un qui s’appelle J-P. Il vient de Sherbrooke, mais il vit depuis trois ans dans Hochelaga. On sent tout de suite qu’il est généralement plus à l’aise que son ami pour négocier chacun des tournants de l’existence, mais comme c’est vraiment un roman intelligent dont je te parle, et que les romans intelligents ont la politesse d’éviter les simplifications outrancières, on comprend à un certain moment que J-P porte comme tout le monde son lot de tourments. Il étudie en arts plastiques à l’université.
Son ami s’appelle Dave. Lui vit encore à Sherbrooke, chez ses parents, où il fume une quantité anesthésiante de pot. On sent tout de suite que Dave est généralement à l’aise dans très exactement aucune situation, que le monde n’est rien d’autre pour lui qu’un lieu hostile, peuplé de visages à deux faces, d’esprits fourbes et de béotiens tout juste bons à gober ce que les médias de masse leur proposent. Il vomit constamment sur l’humanité son dégoût de tout. Pense à Kurt Cobain et aux narrateurs des romans de Thomas Bernhard.
C’est le début de l’été et Dave porte tout le temps les mauvais vêtements (pas question de mettre des shorts!), se moque du « scotch de bourgeois » que J-P a apporté, en lui reprochant de céder à un autre effet de mode, quand il ne le traite pas carrément de « hipster-se-projetant-idiotement-dans-l’image-de-lui-même-grâce-aux-réseaux sociaux. ». Il refuse comme de raison d’adhérer à Facebook, qui participerait à notre abrutissement collectif. Adorable bougre.
Tu ne tomberas pas en bas de ta chaise quand je vais te dire que Dave étudie en littérature, qu’il écrit de la poésie et qu’il crache son fiel sur les ennemis habituels de ce genre de personnages (le gouvernement, le pouvoir), mais aussi sur quiconque embrasse le kitsch sans le savoir. C’est là où ça fait le plus mal : dans une des scènes clés du roman, J-P et Dave aboutissent dans une ruelle touristique de Newport, devant une ribambelle de peintres de paysages comme on en trouve dans toutes les ruelles touristiques du monde. Commentaire cinglant de Dave, qui ne sait pas encore que son partenaire de voyage vient de se procurer une toile auprès d’un de ces inoffensifs artistes : « Ils ne se rendent même pas compte que c’est laid. Mais les pires, je sais pas si c’est ceux qui les font ou ceux qui les achètent. »
L’affaire, c’est que Dave n’a pas toujours exactement tort. Oui, J-P pense beaucoup à son image. Oui, il y a quelque chose d’un peu réac, d’un peu mononcle, au creux des fadaises qu’il déballe sur l’art contemporain, quand il dit : « Si je veux avoir un discours sur l’art, je vais pas faire une œuvre qu’il faut que j’explique à tout le monde pour qu’il comprenne que je conteste… l’immobilisme pis le cynisme, par la mise en représentation du silence, mettons. »
Mais le problème, c’est que l’intransigeance de Dave repousse tranquillement tous ceux qui se font du souci pour lui. La violence de son mépris pour tout ce qui l’entoure est une violence qu’il s’inflige d’abord et avant tout à lui-même.
J’ai un ami prof de littérature au cégep qui me raconte que ses étudiants, à qui il fait lire L’attrape-cœurs de J.D. Salinger, reprochent au narrateur Holden Caulfield de geindre sans arrêt. Avant, pourtant, les jeunes adultes se rangeaient spontanément du côté de Holden et de son regard suspicieux sur la vie et le monde. J’imagine que trop de lecteurs percevront le personnage de Dave comme les étudiants de mon ami perçoivent Holden Caulfield. Cesse de chialer et le bonheur resplendira peut-être sur tes jours, répète-t-on sans cesse de nos jours à ceux qui n’arrivent pas à trouver leur confort dans le proverbial moule, et qui peinent tout autant à imaginer une forme de moule qui leur permettrait de respirer à l’aise.
Qui a raison, qui a tort, entre celui qui refuse d’adhérer à Facebook, et s’isole ainsi forcément du monde, et celui qui y adhère en sachant qu’il participe à cette troublante époque de mise en scène de soi? Qui est le plus risible, entre celui qui se tient à distance des autres afin de protéger ses idéaux du choc de la réalité, et celui qui accepte le compromis et la banalité d’une vie normale dans l’espoir de goûter un peu à la douceur d’un bonheur simple et facile?
Qui s’illusionne le plus sur l’importance de sa contribution à notre société entre toi, qui défends des grandes compagnies dans des procès, parce qu’elles ont le droit d’être défendues, me dis-tu, et moi, qui parle de livres dans les médias? Il y a encore quelques années, la réponse me serait apparue sans équivoque. Je craignais jadis ceux qui ne pensent pas comme moi. Je crains désormais de plus en plus ceux qui n’ont à la bouche que des certitudes.
Le monde mérite-t-il vraiment qu’on tente de le transformer? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que je deviens ce que j’ai voulu? Je pense que la réponse la moins conne que je puisse offrir à ces questions, c’est que je n’en ai aucune maudite idée.
On s’en reparle.
Bonnes vacances.
Doum