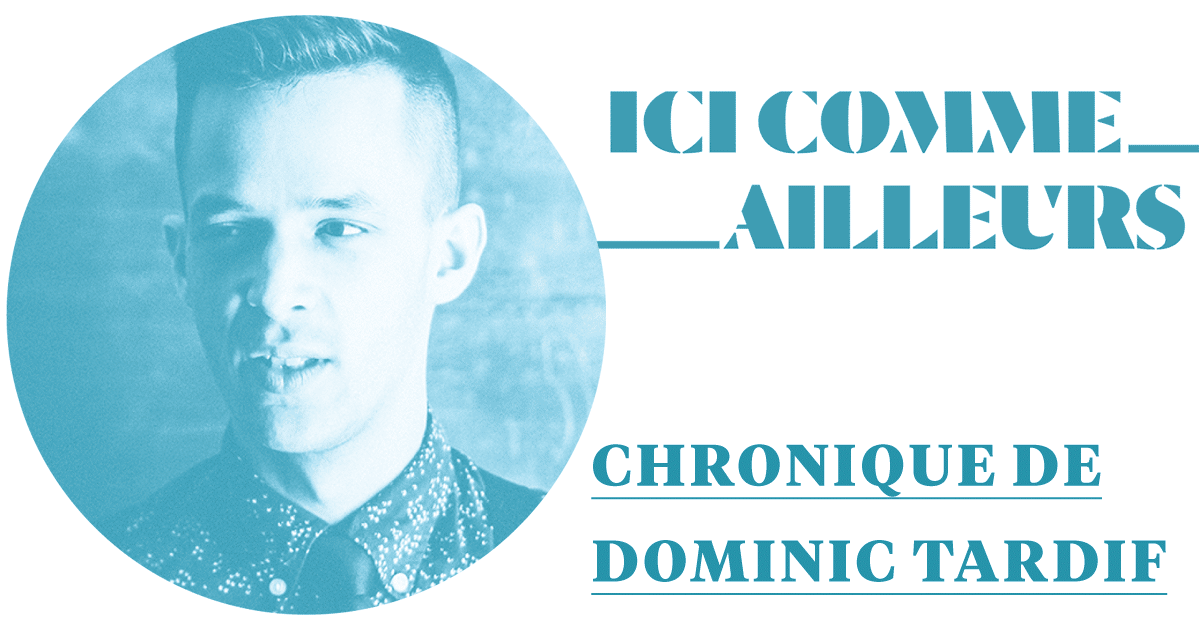Mission impossible que d’échapper à son corps, rappelle Catherine Voyer-Léger dans Prendre corps, fascinante auscultation de chacune des parties de ce qui nous compose.
Il est là – bedaine proéminente, teint huileux, yeux vitreux –, étendu dans un lit de cet hôpital où il flirtait avant-hier avec l’autre côté du miroir. Il est là, cet ami à qui je rends visite, afin de soigner une étrange infection à la jambe, qui le ramenait violemment à la réalité il y a quelques jours, celle des limites de son corps. Il est là, comme s’il avait étiré jusqu’à son point de rupture l’élastique de ses capacités physiques.
Il n’y a pas si longtemps que cet ami dont je vous parle franchissait la trentaine et, pourtant, son corps, aujourd’hui, semble déjà protester. Ce corps dont il repousse du revers de la main les sommations à ralentir, ce corps dont il exige beaucoup trop en travaillant douze heures par jour, ce corps dont il apaise les petits maux en s’envoyant chaque soir une vodka de trop, ce corps n’en pouvait visiblement plus.
Diagnostic simpliste, objecteraient sans doute les médecins. C’est peu importe celui que je tente de bienveillamment offrir à mon ami, qui multiplie les visites à l’hôpital au cours des derniers mois, bien qu’en refusant obstinément de transformer son quotidien et de considérer ces bobos plus ou moins gros comme la tape sur l’épaule que lui offre poliment une éventuelle plus grande tragédie. Il est si facile à 30 ans de s’accrocher à la conviction que l’on peut compter sur son corps, même quand plusieurs indices suggèrent le contraire.
J’ai beaucoup pensé à cet ami en parcourant Prendre corps de Catherine Voyer-Léger, une série de microrécits souvent coiffés d’un titre désignant une partie de l’anatomie de son auteure – flanc, ventre, lèvres, thorax, mamelon, poumons – comme pour bien signaler, sans inhibition, que c’est ce dont il sera ici question : du corps. Des joies qu’il procure parfois, mais surtout de ce qu’il freine, du boulet qu’il représente quand il se rebelle, quand il se détraque, ou plus simplement quand il ne correspond pas à une certaine idée de ce que devrait être un corps.
« J’évite les banquettes au restaurant, de plus en plus souvent. C’est devenu un réflexe. Je me tortille pour entrer et sortir d’une chaise Adirondack. Dans le train, j’essaie de me débrouiller sans avoir à baisser la tablette », écrit l’essayiste et chroniqueuse sous l’entrée Ventre 2, en inventoriant certaines de ces petites violences, réelles ou symboliques, que ce corps qui diffère de la norme doit sans cesse tolérer.
Ce que nous dit ici Catherine Voyer-Léger? Que les obstacles se dressant entre une personne en surpoids et son bonheur ne logent pas qu’entre ses deux oreilles. Qu’il ne suffit pas, pour elle, que de s’accepter, afin d’avancer en toute sérénité dans ce monde. Fin de l’entrée : « Une évidence : aucun designer obèse n’a conçu quoi que ce soit avec une tablette intégrée. »
Le corps et ses mystères
Mon ami avait beau paniquer en réfléchissant aux échéances à rencontrer et aux dossiers à livrer à la job; son agacement à être ainsi immobilisé ne pouvait que se heurter contre le mur implacable de la réalité. Sa capacité à travailler, à mettre à profit son esprit, serait un instant freinée par les objections de son corps.
Mais au-delà de la douleur physique que la morphine ne calmait pas complètement, sa colère semblait d’abord jaillir de ce que j’oserais appeler un choc philosophique. Mon ami mesurait pour la première fois dans son lit d’hôpital à quel point on ne connaît jamais réellement son corps, à quel point notre viande peut toujours nous réserver des surprises, à quel point le pire peut survenir.
Voilà pourquoi le corps est un sujet profondément littéraire : même l’être le plus connecté sur ses chakras ne pourra jamais pénétrer tous les mystères de cet éternel objet d’étrangeté. En se levant ce mardi matin là, il y a quelques semaines, mon ami n’avait aucune idée qu’une infection à la jambe lui provoquerait des vomissements tels qu’il faudrait, le soir venu, le plonger dans un coma.
« La visite chez le médecin, d’autant plus chez le nouveau médecin, est stressante », observe Catherine Voyer-Léger. « C’est comme rencontrer le notaire, le comptable ou même le garagiste. Tous ces gens savent des choses que nous ne savons pas. […] Mais le médecin, c’est différent. Il sait sur moi des choses que je ne sais pas. »
Du luxe de ne pas penser à son corps
Quelque part entre l’anecdote éclairante, l’indignation, la mémoire et la réflexion, Prendre corps est aussi un livre politique, rappelant que le type de corps dont nous héritons définit ce à quoi nous pouvons rêver. Hériter d’un sexe féminin, et des impératifs d’apparence soignée qui viennent avec, limite déjà les possibles. Se préoccuper de ses cernes, se préoccuper de ses cheveux, se préoccuper de ses fesses; c’est vivre avec l’angoisse constante de sa possible maladresse, de son prochain faux pas, de son éventuelle inadéquation. C’est vivre sans pouvoir jouir de la tranquillité d’esprit dont l’existence munit l’homme moyen.
« Le plus simple ce serait de ne pas avoir de corps d’être un pur esprit un cerveau une tête pleine », suggère Lynda Dion dans son plus récent roman, Grosse (Hamac), une phrase qui me revient souvent en tête ces temps-ci, la faute à une série de bobos pas tellement graves (je ne veux pas vous inquiéter), mais parfois assez accaparants pour me gâcher une journée au complet. Ne pas penser à son corps est un luxe, oui, un luxe équivalant d’une certaine manière à ne pas avoir de corps, dans la mesure où l’on ne pense pas constamment à quoi l’on peut se fier. Ce luxe en est évidemment un auquel les personnes malades, obèses ou handicapées ne goûtent que très rarement. D’abord à cause des inconforts accompagnant leurs conditions, mais aussi à cause d’une société refusant de représenter le corps autrement qu’en lisse modèle de perfection et de fiabilité.
Le corps dont nous parle Catherine Voyer-Léger, lui, est un corps qui sue et qui souffre, un corps qui pue et qui se répand en peaux mortes, un corps qui exulte parfois, mais qui fait mal souvent. Un corps que l’on dira différent, seulement parce qu’il jure avec celui que célèbre la publicité, la télé ou le système marchand en général.
Le corps dont nous parle Catherine Voyer-Léger est en fait un corps en vie. Et son livre, un miroir tendu à tous ceux qui, comme mon ami, ne savent concevoir le leur qu’en machine infaillible. Nier que notre corps est cerné de frontières n’a jamais permis d’abolir l’échéance de la mort. Au contraire.