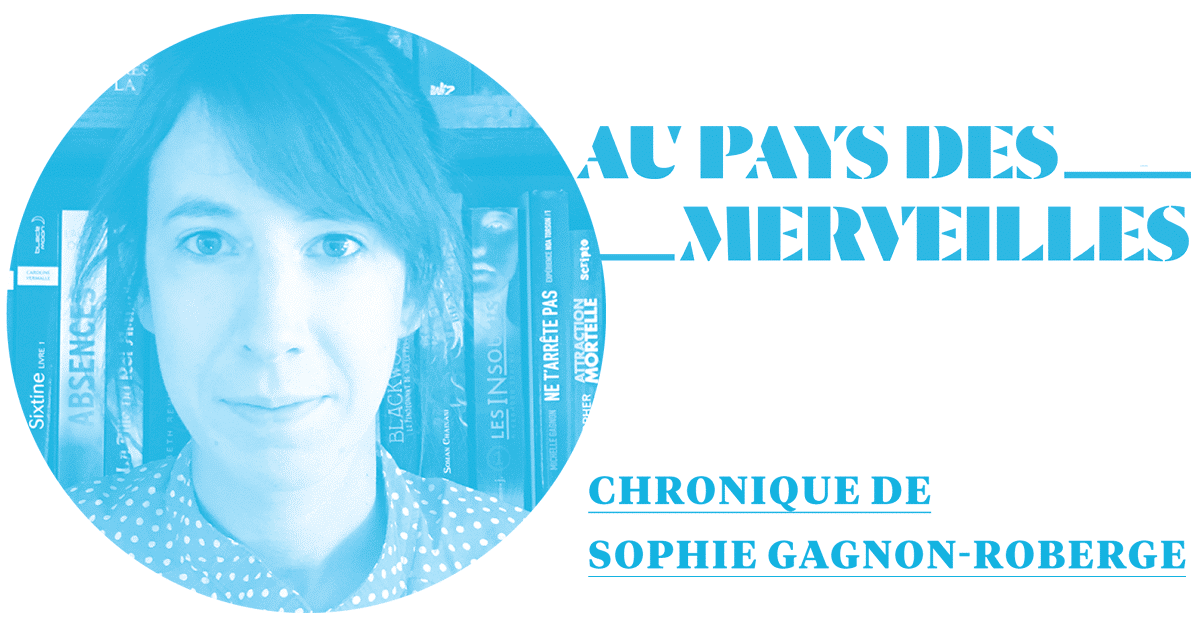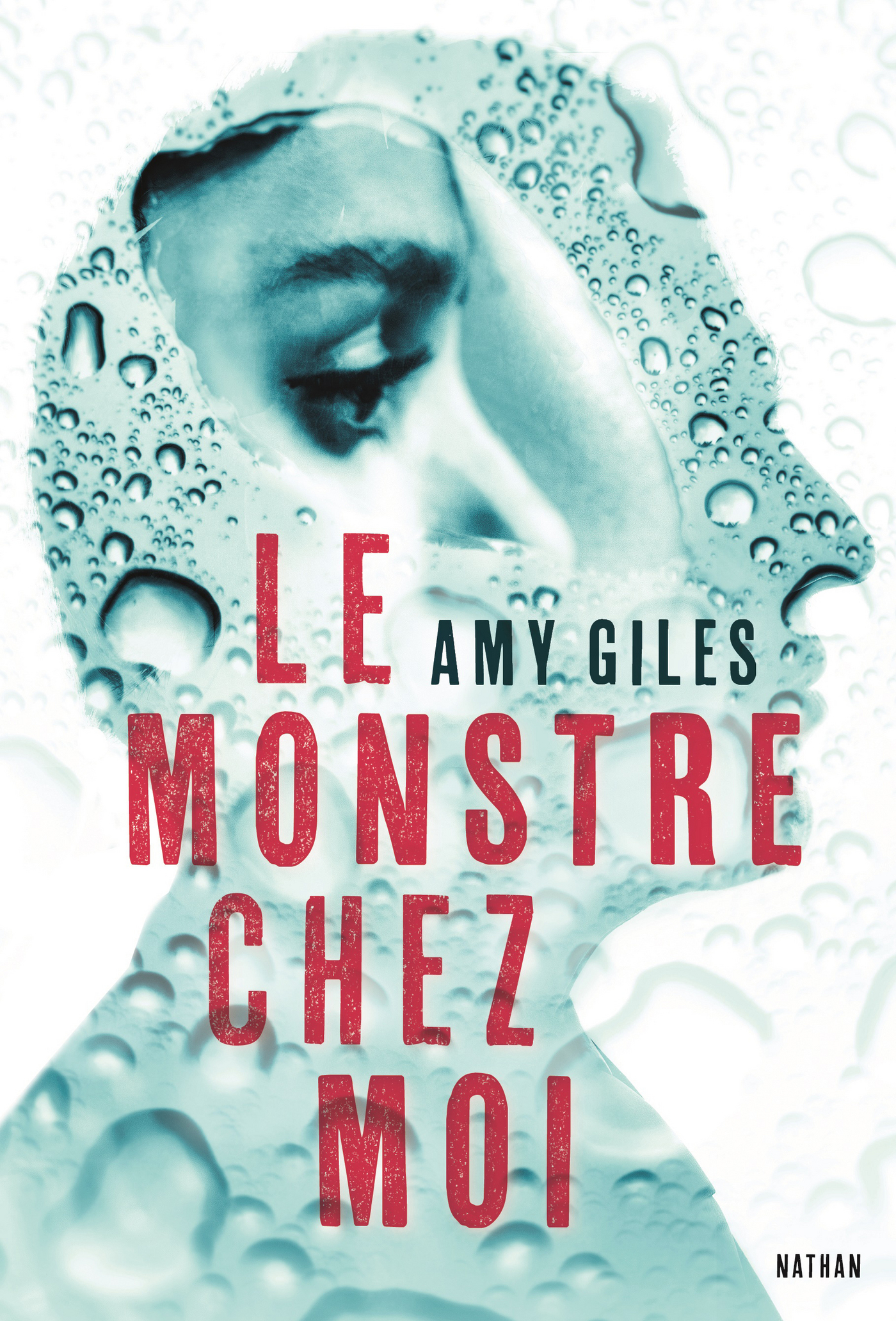C’est ce que fait très bien Magali Laurent dans L’antre du diable, alors qu’on rencontre Zachary, ses amis, son petit frère et ses parents, chasseurs de fantômes, dans un manoir nouvellement transformé en hôtel dont le passé sanglant est loin d’être une simple rumeur. Dès qu’ils arrivent, Zachary sent bien que les drames imprègnent les murs. Et si les propriétaires de l’hôtel ont promis des sensations fortes à leurs visiteurs le temps d’une journée remplie de zombies, les manifestations auxquelles assiste Zachary s’éloignent du plan initial.
Utilisant des éléments habituels de la culture de l’horreur, avec un trou de la forme d’un cercueil, la présence de masques et une étrange petite fille morte qui ne semble pas avoir choisi son camp, Magali Laurent fait de multiples clins d’œil à des films d’horreur tout au long de cette histoire qui suscite la peur grâce à un feu roulant de rebondissements et à des morts bien réelles. En effet, ce n’est pas ici un « vilain tour » qu’on essaie de jouer aux héros, mais bien l’œuvre d’un esprit tordu… et vengeur.
Paru dans la collection « Frissons », qui célèbre cette année ses 30 ans, L’antre du diable est aussi une des parutions de l’automne qui permettent à la collection de se réinventer. La maison d’édition a revu la maquette, délaissant les phrases en exergue, et offre désormais des œuvres plus costaudes, maintenant déclinées en quatre catégories, dont la dernière, « eXtrême », vise un public plus avisé.
Toujours dans cette collection, Art sauvage d’Olivier Descamps entraîne cette fois ses lecteurs dans un monde plus « adulte », avec Victor, un étudiant en art qui n’a jamais réussi à faire sa niche dans ce monde un peu fermé, mais qui tombe par hasard sur une œuvre d’art furtif. Fasciné par la mise en scène macabre, il la détaille sur son blogue, attirant immédiatement l’attention de l’artiste anonyme. Ainsi débute une étrange relation nourrie par les œuvres qui fleurissent dans la ville… et les morts qu’elles entraînent. En effet, Victor découvre rapidement que des noms se cachent dans les installations, et que ces noms correspondent à des hommes qui meurent dans des circonstances mystérieuses. Quand le critique hésite à aider la police, l’artiste, persuadé que Victor comprend vraiment sa démarche, va l’impliquer encore davantage dans son travail…
On est ici dans une intrigue touffue qui fait une large part à l’art, mais aussi à la littérature, les scènes macabres présentées dans le livre faisant référence à des scènes de la littérature classique : Frankenstein, Le meurtre de l’Orient-Express, etc. Il y a donc plusieurs niveaux de lecture possibles même si la trame principale est un thriller avec une montée dramatique efficace et un héros paranoïaque (avec raison). Si certains passages sont moins crédibles, l’ensemble fonctionne efficacement et est divertissant, tout en nous permettant de découvrir l’art furtif (d’ailleurs à mettre en lien avec le gagnant du Prix des libraires jeunesse Rivière-au-Cerf-Blanc, qui explorait quant à lui le Land Art).
Mais faut-il des meurtres et du sang pour frissonner? Pas toujours. Si Le monstre chez moi commence par un accident d’avion et deux morts, ce n’est pas le plus effrayant dans ce roman dont la structure narrative est créative.
« Ce n’est jamais la douleur, le pire. La douleur est vite oubliée. C’est la violence dont je me souviens toujours. La rage. La haine. »
Après l’accident d’avion, il y a la tentative de suicide de Hadley, seule survivante du drame. L’inspecteur affecté au dossier essaie de comprendre, mais rien dans les témoignages des proches de l’adolescente ne permet de fournir une explication suffisante à propos de ce qui a pu se passer. Hadley était une élève modèle. Une athlète accomplie. Sa petite sœur, une fillette épanouie. Sa mère, une femme impliquée dans de multiples associations. Et son père, un homme d’affaires généreux. Mais qui sait ce qui se tramait réellement dans cette famille?
Amy Giles manie la plume avec agilité, elle vogue habilement entre le suspense autour de ce qui s’est passé dans l’avion, les différentes entrevues de l’inspecteur avec les proches et les souvenirs de Hadley, distribués au compte-gouttes. Si on comprend rapidement que tout ce qui entourait la vie familiale était caché, Hadley ne montrant qu’une seule facette d’elle-même à l’extérieur, même avec ses amis les plus proches, on découvre peu à peu l’ampleur de l’horreur vécue par l’adolescente. Il y a la pression scolaire, les nombreux interdits, notamment le fait de fréquenter un garçon, les mécanismes mis en place par Hadley pour se protéger, mais aussi, voire surtout, pour soustraire sa petite sœur au joug de leur paternel. Puis il y a la violence. Verbale, d’abord, puis physique. Au fil des pages, l’autrice explore avec une grande finesse les rouages de la violence familiale, faisant comprendre à ses lecteurs comment le père a tissé sa toile, comment Hadley s’est érigée en protectrice, comment elle ne voit aucune issue positive possible à la poigne de ce père obsessionnel. Et quand elle ose s’ouvrir à Charlie, un personnage qui apporte une dose de douceur bienvenue au récit, elle se rend compte que tout ne peut qu’empirer. Qu’il n’existe finalement qu’une seule solution.
Peut-être y a-t-il donc différents types de frissons. Ceux que nous ressentons directement lors de la lecture d’un livre, quand une scène nous surprend, que la peur traverse les pages, mais aussi ceux qui viennent ensuite, quand nous comprenons la portée d’une histoire et que nous nous disons que cette fiction est malheureusement bien trop réelle pour certaines personnes.