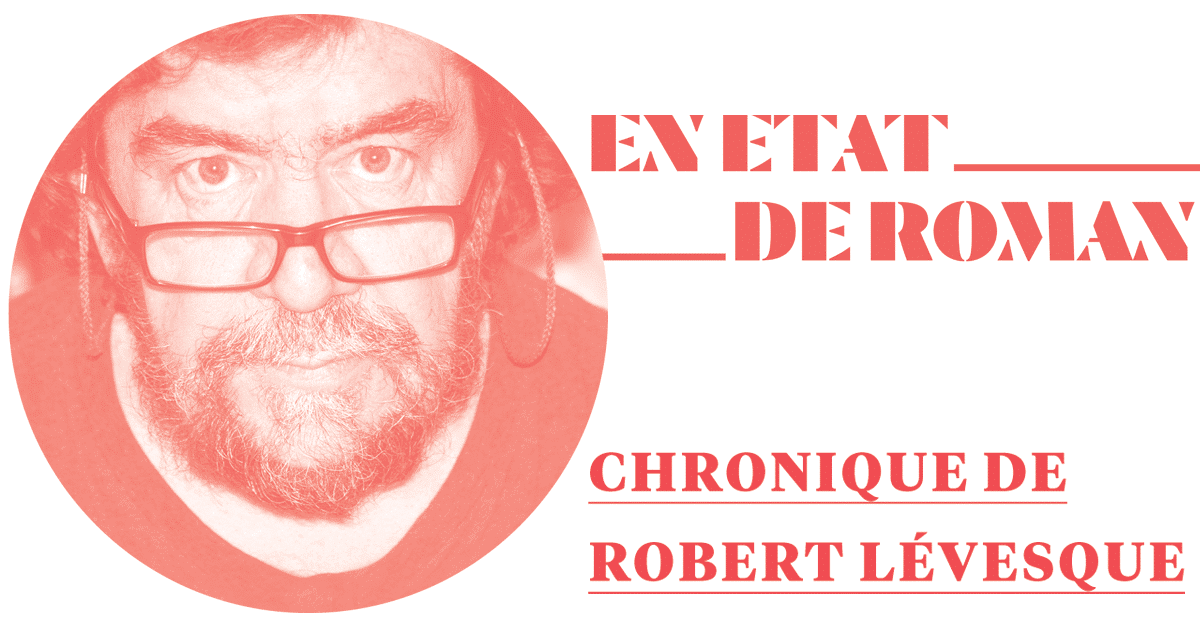L’homme, lui, était un cœur sec, antisémite de sa jeunesse jusqu’à son lit de mort, un de ces salauds que révélèrent la 39-45 au début de laquelle guerre — qu’il fit les yeux fermés mais bien au su de la Solution finale — il joua des coudes pour se ranger du bon bord, celui de Vichy, longeant les corridors des palaces vieillots où campait « l’État français » (autocratique et asservi au nazisme) pour y obtenir invitations, accréditations, nominations, jusqu’à devenir ministre de France (en 1943 à Budapest) puis ambassadeur (en 1944 à Berne), fonctions factices qu’il n’occupa que quarante-deux jours quand il fallait fuir la France et l’arrivée des Alliés (autrement dit sauver sa peau), mais fonctions qui lui offrirent le plaisir de se faire appeler « Excellence », ce qui grisait sa femme, Hélène Soutzo, une Grecque épousée pour son argent et son hôtel particulier, veuve d’un prince roumain et plus antisémite encore que son second mari — « Si les Allemands ne gagnent pas cette guerre et si les Juifs reviennent, je mourrai, dit Hélène », écrit Morand dans son Journal de guerre —, une princesse enragée, admiratrice d’Hitler, un personnage comme on en trouvera dans l’œuvre de Thomas Bernhard.
De cet homme aux trente-cinq voitures de luxe, aux innombrables maîtresses (la Soutzo ne fermant pas les yeux comptait les conquêtes), de cet homme de lettres qui fut un excellent auteur de nouvelles (plus que de romans), L’homme pressé, Ouvert la nuit, son contemporain Mauriac dira, la guerre passée, Morand en exil : « Il conduisait à toute vitesse le char de ses curiosités ; il a pris un bien mauvais tournant. » Sartre, dans Qu’est-ce que la littérature?, range Morand au rayon maudit d’« auteur bourgeois ». L’auteur de La nausée ajoutait : « Remplis de clinquant, de verroterie, de beaux noms étranges, les livres de Morand sonnent pourtant le glas de l’exotisme. »
Longtemps, dans les années 1920 et 1930, Morand fut un auteur à la mode. Dans ses romans qui respiraient l’air du temps les lecteurs roulaient, voyageaient, dansaient, achetaient, faisaient des affaires, descendaient dans des palaces, grimpaient dans des taxis, sautaient dans des trains vers Venise, vers Vladivostok, c’était au temps de la fée électricité et Cocteau, qui l’admirait sans voir en lui un rival, le trouvait « clair, rapide, sobre, riche comme Crésus et simple comme bonjour! ». La mode Morand, ou le mode Morand, fit son temps, son passage à Vichy et sa carrière (discrète mais avérée) dans la sale période de la Collaboration en tant que secrétaire du président Pierre Laval, protégé du maréchal Pétain, envoya tout ça, son style, son univers mondain, son snobisme, au grenier de la littérature, dans des boîtes en carton scotchées.
Étonnamment, cet homme a survécu à la honte, un sentiment qu’il ne possédait vraisemblablement pas. Resté en planque en Suisse à la fin de la guerre, son exil durera deux décennies durant lesquelles il reprit la plume et publia « chez des éditeurs acquis aux collaborationnistes en exil », comme l’indique Pauline Dreyfus dans la formidable biographie qu’elle lui consacre. Ce furent des romans n’osant plus respirer le présent mais tournés vers le passé, dans les délires érotiques d’une nymphomane africaine (Hécate et ses chiens) ou les aventures d’amoureuses étrangères aux noms tels que Escolastica ou Parfaite de Saligny… Morand a toujours écrit, jamais il n’aura renié son passé vichyste et au bout du compte, vous le verrez en lisant Pauline Dreyfus, il passa entre les mailles du filet, échappant à tout procès, tout internement, toute mesure infamante. Quand Céline jeté en cellule…, mais c’est une autre histoire, Céline, il n’a pas travaillé à Vichy, il a craché un antisémitisme de fou dans trois pamphlets d’avant-guerre mais il n’était pas foncièrement antisémite comme Morand. Et Céline le solitaire, médecin des pauvres, est un grand écrivain, capital, universel.
Lui, Morand, le doué si pressé qui rêvait d’entrer à l’Académie française dès le début des années 1920, quand Proust préfaçait (sans l’avoir lu) son premier livre (Tendres stocks), il y entra en 1968, à 80 ans, quand le général de Gaulle, magnanime, leva son véto empêchant le quai Conti de l’élire, quand ce printemps-là allait être chaud, que Paris serait ouvert la nuit à tous les débordements, haschich et barricades, que de Gaulle allait quitter la scène. Morand a été un Immortel huit ans, jusqu’à ce qu’il crève en 1976 d’un infarctus en sortant de sa séance de gym quotidienne à 88 ans.
Ceux qui s’intéresseraient à un tel phénomène que celui de Paul Morand doivent lire la biographie que vient de signer Pauline Dreyfus. Tout y est. Des potins aux archives, la biographe besogneuse dont la plume est claire, vive, détaille la vie, l’œuvre, la carrière, la conduite et l’insouciance de cet homme pressé de traverser la vie avec comme devise, comme il l’écrivit, « penser à rien, à vive allure », se fichant de tout, opportuniste, ingrat, amoral, mufle, déloyal, cynique, généreux de plume qu’avec ses lecteurs.
Ce qui fait maintenant l’actualité mordante de Morand c’est la publication du premier des deux tomes de son Journal de guerre dans lequel, sans qu’il ait cherché à faire de la littérature, il a tout noté de ses jours passés au service de l’État français créé par le maréchal pleins pouvoirs Pétain, les années Vichy, ses dîners dans la purée vichyste, dans les corridors d’une machine de mort haineuse au service du Troisième Reich. J’ai lu ces 1028 pages. J’en suis ressorti avec la nausée. Mais j’ai tenu, car je tenais à lire noir sur blanc comment un homme a pu écrire le 23 juillet 1942 (six jours après la rafle du Vel d’Hiv) : « L’opinion est choquée des mesures contre les Juifs. Mais ceux-ci une fois partis, personne n’y pensera plus. » Et le 23 octobre : « Quant aux Juifs il n’en reste presque plus. On dit à Vichy couramment qu’ils ont été gazés dans leurs baraquements. »
Dans leurs baraquements?!